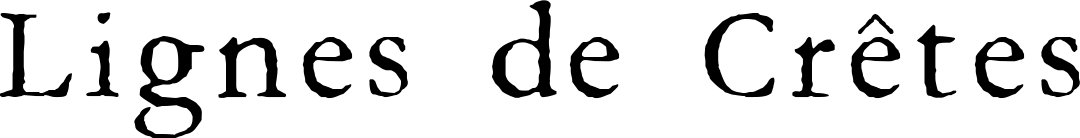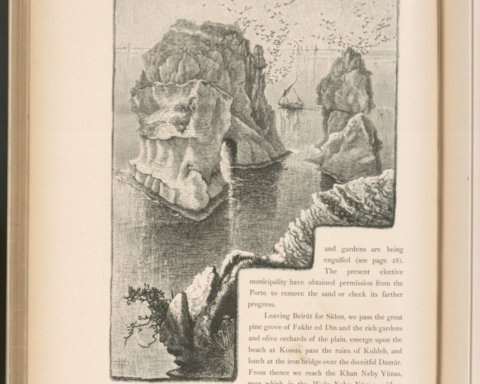Ma première manif, c’était un 1er mai, dans une ville de province, de taille moyenne, en France, il y a une vingtaine d’années. Je découvrais le militantisme, mais je n’étais dans aucune organisation. J’avais dessiné au marqueur un A cerclé sur mon sac. Le capitalisme, depuis les cours au collège sur le XIXème siècle, c’était clair pour moi que c’était un système à combattre. Mais le communisme, ça m’évoquait du gris, des gens obligés d’être tous pareils et d’aller à l’usine ou au bureau faire un boulot qu’ils n’aimaient pas forcément. L’anarchisme (où ai-je bien pu tomber sur ce mot, je ne sais plus), pour moi, c’était le collectif sans nier l’individu. Et donc, ce 1er mai-là, c’est la première fois que j’ai expérimenté le nous, ce sentiment d’être avec d’autres, d’être ensemble même si on ne se connaissait pas, de partager un but, une envie de changer les choses. Je ne connaissais aucune chanson révolutionnaire, mais je crois bien que j’ai chanté quand même.
Peu de temps après, je me suis retrouvée à Paris. Il y avait le mouvement des sans-papiers, depuis un an ou deux déjà. Je garde le souvenir de manifs joyeuses, parce que c’était dur (à quel point, je ne m’en rendais pas compte encore). Des manifs importantes, avec beaucoup de Français qui manifestaient leur solidarité. C’était la période des luttes des « sans » (je n’aime pas cette qualification, car c’était des mouvements qui avaient beaucoup à dire et à montrer), avec le mouvement des chômeurs de l’hiver 1997-98. J’ai découvert les squats et les autonomes et les « garantistes » (pour un revenu garanti pour tous, c’était il y a 20 ans, hein, Hamon n’existait pas encore), même si dans ce mouvement-là, il y avait aussi plein de précaires et mal adaptés socialement. Dans ce mouvement-là, les manifs, c’était parfois prendre la tête du cortège avec une banderole décalée (subversive ?). Mais c’était surtout avoir une action prévue à la fin de la manif, une occupation en général, ou une auto-réduction (aller faire ses courses en groupe sans payer, quoi, à l’époque les médias ne parlaient pas trop de pillage, me semble-t-il). Le plus souvent, je n’avais pas la moindre idée d’où on allait ni pourquoi précisément. On faisait quelque chose, et au début, ça me paraissait suffisant. C’était même plutôt exaltant.
Mais quand même, ce n’était pas si parfait. Il y avait le mépris des militants plus expérimentés (et pas toujours précaires eux-mêmes), genre « mais t’as pas compris qu’on va occuper Normale Sup ni pourquoi ? » Ben non, je ne savais quasiment pas que Normale Sup existait et que les étudiants y étaient rémunérés pendant leurs études. Par contre je savais que Bourdieu qui vient devant l’ENS occupée avec les journalistes et tourne le dos aux occupants pour faire son speech devant les caméras, ça n’était pas une consécration mais du mépris.
Il y a eu aussi les fois où ça a mal tourné, où il y a eu des interpellations, des procès, de la prison. Quand on a peu d’expérience, au début, on n’y pense même pas, on fait confiance aux plus anciens. Et là, quand c’est la merde et la répression, on apprend beaucoup. On apprend qu’il y a des militants qui s’en foutent des conséquences, non seulement pour eux mais pour tous ceux qui participent à leurs initiatives, qui n’ont pas le souci de partager leurs expériences ou d’engager une vraie réflexion collective. On rencontre aussi des camarades qui ont le souci des autres, de l’efficacité réelle (notamment ne pas finir en taule), de transmettre, d’expliquer. On commence à voir que dans les AG, tout le monde n’est pas à égalité, que l’absence de président ou de vote, ça n’est pas forcément plus démocratique, c’est aussi « les plus grandes gueules ou les plus habitués à parler ont toujours raison à la fin. »
Mais quand même, des manifs avec des rendez-vous d’action à la fin, quand on a des sujets précis à faire avancer, ben ça donne une autre ambiance à tout le défilé.
J’ai continué à militer, dans les luttes de précaires. A une poignée parfois, quelques dizaines voire une ou deux centaines pour certaines initiatives. Je n’ai pas fait beaucoup de manif pendant pas mal de temps. Quand on bosse toute la semaine à distribuer des tracts devant des ANPE, à faire des permanences, à étudier la règlementation de l’assurance chômage pour en savoir plus que l’agent en face quand on obligera l’administration à nous recevoir tout de suite pour un chômeur qui a des milliers d’euros de trop perçus, en fait on n’a plus guère le temps de regarder quand il y a des manifs. Quand les précaires de la Fonction Publique viennent en expliquant qu’ils ont bien essayé d’aller voir les syndicats mais que personne n’a voulu s’occuper d’eux, moi ça ne me donne pas trop envie d’aller aux manifs syndicales. Par contre, je garde un très bon souvenir de quelques manifs sauvages dans des quartiers où j’avais l’habitude de militer, où on défile au milieu des gens qui viendront peut-être à la prochaine réunion, où on connaît les manifestants, et où on a discuté avant de ce qu’on allait faire et comment, où on sait qu’il y aura du monde si jamais il y a un souci.
Bien sûr, quand on est organisateur de la manif, avec ou en l’absence de déclaration à la préfecture, on s’amuse un peu moins sur le moment. Il faut s’occuper de tellement de choses : avoir une banderole et des slogans. Discuter avec la police. Bloquer la circulation pour éviter qu’un véhicule force le passage. Et pourtant, à la fin, j’ai un sentiment d’accomplissement plus important que dans des manifs à des dizaines de milliers. Et là, je parle aussi bien de manifs syndicales que d’autres. Parce que quand il a bien fallu trouver un boulot parce que tenir éternellement au RMI ce n’était plus possible, quand j’ai signé un CDI à temps plein, ben je me suis dit que je voulais continuer à militer et qu’il y avait autant de choses à faire changer au boulot que pour les précaires à la CAF.
Et donc je me suis syndiquée. Et dans le cadre syndical, j’ai fait des bonnes et des mauvaises manifs. Des manifestations spontanées en réaction à des sanctions ou à un plan social, où ça se fait tout presque tout seul parce qu’on se connaît du boulot, mais où mes expériences passées ont aidé, où on sait pourquoi on manifeste, même si l’étape de le formuler clairement mérite d’en prendre le temps et d’en débattre, où l’un a ramené des vieux draps, un autre des bombes de peinture, d’autres cherché des slogans. Des manifestations de routine aussi, parce que c’est une journée d’action alors il faut y être. Ces manifestations-là, ça va tout seul aussi, mais là ce n’est pas une bonne chose : on ne se demande même plus où faire la manifestation pour qu’elle ait de l’impact, quels messages on a envie de mettre en lumière, comment toucher plus de monde… A l’inverse, des manifs à quelques dizaines, dans une ville où ce n’est pas habituel, ça se voit tout de suite que c’est un évènement : les bourgeois qui s’éloignent en se retournant, les salariés qui sortent sur le pas de la porte avec le sourire. Là, je me dis qu’on a montré que la lutte, ce n’était pas qu’à la télé, mais là, juste à côté, accessible à toutes et tous.
 Dans toutes les manifs (mais dans d’autres cadres collectifs aussi), j’ai aussi l’appréhension du slogan homophobe, du discours complotiste, de la banderole antisémite, de la pancarte sexiste (ça marche dans tous les sens). Parce que bien souvent, ils sont là. Et j’ai beau être avec des camarades, je ne trouve pas toujours du monde pour venir avec moi faire remarquer au type au micro que faire référence aux francs-maçons, ça ne le fait pas, ou pour aller prendre la tête, au choix (non exhaustif) aux manifestants avec leur drapeau bleu-blanc-rouge, au type qui diffuse Fakir ou le tract du Pardem… Ce n’est pas forcément que mes camarades sont en désaccord sur le fond avec moi, c’est juste que ça ne leur paraît pas si important ou c’est parfois un manque de sensibilité (ou de sensibilisation collective) à ces enjeux-là. Et puis, il y a la queue devant la camionnette qui vend du punch, et après il risque de ne plus y en avoir… Alors je balance un commentaire en passant, je fais exprès de bousculer le distributeur, mais bon, c’est pas vraiment satisfaisant.
Dans toutes les manifs (mais dans d’autres cadres collectifs aussi), j’ai aussi l’appréhension du slogan homophobe, du discours complotiste, de la banderole antisémite, de la pancarte sexiste (ça marche dans tous les sens). Parce que bien souvent, ils sont là. Et j’ai beau être avec des camarades, je ne trouve pas toujours du monde pour venir avec moi faire remarquer au type au micro que faire référence aux francs-maçons, ça ne le fait pas, ou pour aller prendre la tête, au choix (non exhaustif) aux manifestants avec leur drapeau bleu-blanc-rouge, au type qui diffuse Fakir ou le tract du Pardem… Ce n’est pas forcément que mes camarades sont en désaccord sur le fond avec moi, c’est juste que ça ne leur paraît pas si important ou c’est parfois un manque de sensibilité (ou de sensibilisation collective) à ces enjeux-là. Et puis, il y a la queue devant la camionnette qui vend du punch, et après il risque de ne plus y en avoir… Alors je balance un commentaire en passant, je fais exprès de bousculer le distributeur, mais bon, c’est pas vraiment satisfaisant.
Je n’aime pas les manifs. Sauf quand j’ai le sentiment d’être dans un « ensemble » plus grand que les gens que je connais, parce que chaque cortège n’est pas fermé sur lui-même, qu’il y a des banderoles vivantes, que sur le parcours on se salue entre manifestants et ceux qui regardent de leur fenêtre, ou qu’on s’adresse aux passants, qu’on se préoccupe de gens quand ça chauffe un peu, qu’après la manif on discute autrement, d’autres choses que d’habitude…
J’aime pas les manifs, si ça se résume à défiler, parce que j’aime tout ce qu’il devrait y avoir systématiquement autour, ce travail militant trop invisibilisé, distribuer des tracts, se creuser la tête sur comment on va faire pour gagner, quelles actions on va pouvoir mettre en place, proposer l’adhésion, avec les discussions devant une Caf ou en salle de pause ou en attendant le train avec des collègues. Ces discussions sont parfois terribles parce que c’est aussi se confronter au collègue qui suit Dieudonné et Soral ou à celle qui va à toutes les initiatives de « La manif pour tous ». Elles sont parfois géniales parce qu’on fait bouger les lignes, qu’il y a ce déclic chez la personne en face :
Et pourquoi pas ? pourquoi ne pas sortir de ma routine ? pourquoi ne pas tenter de faire changer les choses, dans ma vie et avec d’autres ?