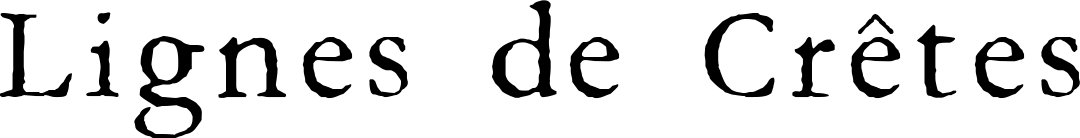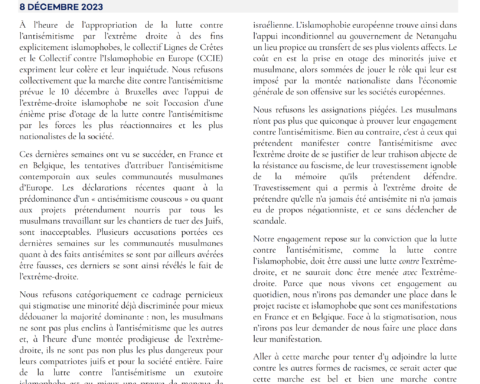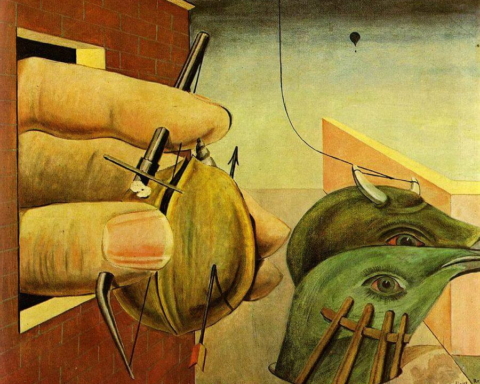Ce texte constitue la première partie de l’intervention de Frédérik Detue, lors de nos journées sur le négationnisme de gauche.
Au bonheur des négationnistes
(retour sur les pratiques du champ littéraire)
À Charlotte Lacoste
Première partie
Contre les historien·nes, le parti pris littéraire des négationnistes
Dans sa première édition en 1950, Le Mensonge d’Ulysse de Paul Rassinier se présente dans son sous-titre comme un « Regard sur la littérature concentrationnaire » et donc comme de la critique littéraire1. En préface, l’auteur, qui se fonde sur son autorité de rescapé, reçoit en outre la caution d’Albert Paraz, qui est un écrivain ami et ardent défenseur de Louis-Ferdinand Céline, édité grâce à celui-ci aux éditions Denoël avant et pendant la guerre. Maurice Bardèche, qui, dans ses pamphlets de 1948 et 19502, interprète littéralement la langue administrative nazie quand elle camoufle l’extermination des Juives et des Juifs, est aussi censé être un lecteur expert. Durant les années de guerre, il a fait carrière à l’université en conquérant « un statut, celui de premier spécialiste de l’œuvre de Balzac », puis il publie, de 1946 à 1951, « sa » Comédie humaine3. Quant à Robert Faurisson, la thèse de littérature qu’il a soutenue sur Lautréamont en 1972 lui vaut d’être publié la même année dans la collection « Les Essais » chez Gallimard aux côtés de Beauvoir, de Sartre et de Camus4. Dès l’année suivante, l’auteur, un célinien passionné qui a cherché à « faire signer à divers collègues [universitaires parisiens] une pétition pour que soit autorisée la réédition des écrits antisémites de Céline » et qui « aimerait fonder ou participer à un centre d’étude sur Céline »5, obtient un poste de maître de conférences en littérature française du XXe siècle à l’Université Lyon-II, grâce en particulier à des recommandations chaleureuses « d’éminents hommes de lettres parisiens », que l’on n’a pas voulu « désobliger »6.
Il ne s’agit ici que d’un bref panorama, mais d’autres faits, comme le cas de la thèse en littérature comparée soutenue par Henri Roques à l’Université de Nantes en 1985, corroborent la tendance qu’il dessine ; sauf quelques exceptions (comme Serge Thion ou David Irving), les négationnistes du génocide nazi ne font pas – et ne cherchent pas à faire – profession d’historiens, et il n’est donc tout simplement pas pertinent de leur en faire grief. Comme l’a observé Henry Rousso (qui a forgé le mot de « négationnisme » en 1987), il ne faudrait pas faire comme si les études sur la Shoah ne constituaient pas « depuis très longtemps un champ d’études interdisciplinaire où les littéraires et les philosophes ont autant de légitimité que les politistes ou les historiens, que ces derniers soient académiques ou amateurs »7.
Cela ne veut pas dire, bien entendu, que les négationnistes ne se soucient pas constamment que leur pseudo-enquête historienne soit reconnue. C’est bien la raison pour laquelle ils tentent pour certains de se faire une place à l’université, censée donner plus de crédit à leurs thèses. Et c’est ce qui explique aussi qu’ils se cherchent de façon récurrente une figure tutélaire en Jean Norton Cru, auteur en 1929 d’un ouvrage considérable sur les « souvenirs de combattants » de la Première Guerre mondiale8. Mais il faut bien observer que leur parti d’investir un autre champ que celui de la discipline historique s’oppose en réalité radicalement à l’entreprise de Cru. Dans son livre Témoins, Cru travaillait sincèrement à l’intention des historien·nes, auxquel·les il voulait préparer le terrain par sa critique des témoignages de combattants. L’enjeu était de mettre en valeur ce corpus de documents personnels de la troupe de sorte que les historien·nes s’en emparent enfin pour écrire l’histoire de la guerre, alors que jusque-là les seules sources en usage étaient les documents produits par les autorités militaires. Quant aux négationnistes, ils ont au contraire pour projet de discréditer les témoignages de victimes de façon systématique, comme du reste tous les autres documents relatifs au génocide nazi, de façon à contester leur validité en tant que sources historiques. La tentative d’annexion de l’œuvre de Norton Cru est ainsi à l’aune de tout le reste chez ces auteurs, une manipulation de faussaires, puisqu’il s’agit pour eux d’œuvrer, non pas pour, mais contre les historien·nes9. S’ils se positionnent très souvent hors du champ de la discipline historique, c’est bien précisément parce qu’ils veulent faire concurrence à celui-ci, en dénonçant constamment les « historiens officiels ».
Dès lors, plutôt que de reprocher aux négationnistes de ne pas être des historiens professionnels, il paraît plus intéressant d’étudier leur stratégie d’outsiders. En l’occurrence, c’est dans le champ littéraire, du côté d’institutions de la littérature telles que la critique, l’université et l’édition, qu’ils essaient souvent de se construire une légitimité. C’est en pratiquant le genre littéraire de l’essai et en tâchant de se doter d’une autorité philologique dans la « critique de textes et de documents » (comme Faurisson) qu’ils cherchent à faire croire à l’existence d’une « école révisionniste », qui serait qualifiée sur le plan scientifique pour contester les travaux des historien·nes. Il convient donc d’analyser l’intérêt tactique d’un tel parti pris littéraire.
Le dogme de l’autonomie artistique, ou l’occasion rêvée
Mon hypothèse, c’est que les pratiques et les croyances qui ont cours au sein du champ littéraire rendent cette option plus plausible que d’autres, alors qu’il s’agit de donner un vernis de scientificité – et donc un air de vérité – à une entreprise de falsification historique. Pour l’essentiel, parce que le champ littéraire – comme les autres champs artistiques, qu’il faut lui associer – est déterminé par un discours qui promeut l’autonomie comme un véritable dogme, et donc la liberté d’expression artistique.
Exemplairement, le dogme de l’autonomie littéraire, c’est ce qui est au principe du projet d’Antoine Gallimard, fin 2017, de rééditer les pamphlets antisémites et pronazis de Céline des années 1930 et 1940, comme si cela ne devait pas servir les intérêts d’un Faurisson qui pétitionnait pour une telle réédition au début des années 1970. Il s’agit de revendiquer un statut d’immunité littéraire pour des textes qui, n’ayant d’autre objet que l’incitation à la haine antisémite, tombent théoriquement sous le coup de la loi Pleven depuis le 1er juillet 1972. Pour cela, la consécration que l’écrivain a obtenue de son vivant après son amnistie de 1951 est utile. Il faut jouer sur l’image du Céline anticonformiste que Paraz a commencé de construire après-guerre, avant même le retour en France de l’auteur, dans le dessein de le réhabiliter10. C’est pourquoi le titre projeté par Gallimard pour sa réédition est celui d’Écrits polémiques, qui permet d’escamoter l’antisémite actif et zélé de la Collaboration au profit d’un Céline « politiquement incorrect ». Où la stratégie de la discrétion déjà mise en œuvre par l’auteur entre dans une nouvelle phase, des années après sa mort – comme dans le cas de Heidegger, dont il s’agit dans le même temps de montrer, tandis que l’on publie les Cahiers noirs négationnistes, « que la pensée philosophique […] n’est pas antisémite »11. Pour se blanchir, Céline a non seulement mis au placard les pamphlets mais il a encore fait paraître une trilogie romanesque négationniste dans laquelle il se représentait en victime du nazisme12. Au moment de rééditer les pamphlets, l’opération de blanchiment passe par le fait de séparer l’œuvre de l’histoire en faisant mine de croire qu’un tel objet esthétique, dans une maison d’édition prestigieuse, ne propagera pas l’antisémitisme13.
Il en va de l’antisémitisme mis au service du génocide nazi comme de la pédocriminalité, au demeurant. Le fabuleux destin éditorial de Gabriel Matzneff, qui a pu faire de l’apologie de la pédophilie une œuvre d’art avec la bénédiction des milieux littéraires pendant plus de quarante ans, procède du même dogme autonomiste. Et l’impunité pédocriminelle triomphante se vend, en quatrième de couverture chez Gallimard, sur le même ton anticonformiste (et avec le même mépris de classe), comme l’atteste la publication du journal de l’auteur des années 2009-2013, en 201514.
Mon projet dès lors n’est pas de critiquer la fausse monnaie culturelle elle-même, comme Charlotte Lacoste l’a fait avec beaucoup d’acuité dans Séductions du bourreau en 201015, mais de me tourner vers les instances de légitimation du champ littéraire, dont il convient d’interroger la responsabilité. Car le dogme de l’autonomie a pris corps dans des institutions, à commencer par celles de la critique et de l’enseignement. Je ne le sais que trop, puisqu’il m’a été inculqué au cours de ma formation en lettres et que ça a été tout un travail, à partir du doctorat, de l’identifier comme tel et de progressivement en mesurer – et en critiquer – les enjeux idéologiques. Or ce qui n’est pas indifférent par rapport au sujet qui m’occupe ici plus spécialement, c’est que cette prise de conscience et ce travail critique sont venus notamment de la fréquentation de corpus testimoniaux et de la rencontre avec l’œuvre critique de Jean Norton Cru16.
C’est donc en tant que spécialiste du témoignage en littérature, attentif à la fois aux pratiques testimoniales et à celles de la critique du témoignage, que je souhaite procéder à cet examen. Je voudrais montrer en quoi, dans ce champ de la critique en particulier, le discours littéraire de l’autonomie représente une véritable aubaine pour les négationnistes – et ce, quelles que soient les intentions, souvent louables, des protagonistes. Mon propos n’est pas alors de pointer du doigt tel·le ou tel·le mais de critiquer une idéologie littéraire et artistique qui est si fortement ancrée dans les esprits, si naturalisée, qu’elle se méconnaît elle-même dans sa propension à servir des intérêts négationnistes.
Ce n’est pourtant pas faute de lanceurs d’alerte, vu que la critique de la culture que je suggère ici a vu le jour déjà dans la première moitié du XXe siècle, non seulement dans les travaux de Cru sur le témoignage mais aussi, de façon plus théorique, dans les écrits que Walter Benjamin a produits dans les années 1930. Reste que telle est la réalité de la fausse conscience qui permet à une fausse monnaie culturelle de se diffuser, encore aujourd’hui, et à la fausse monnaie négationniste d’y prendre sa part depuis soixante-dix ans.
De l’esthétisation fasciste du travail historien : Hayden White
Le passage par la réflexion de Benjamin se justifie au commencement, d’une part pour préciser d’où vient le dogme de l’autonomie de l’art, d’autre part pour connaître la critique que l’auteur lui adresse. Car il ne suffit pas de mettre en cause la sacralisation de la figure de l’écrivain pour critiquer la réception complaisante des œuvres de Céline et de Matzneff. Comme Benjamin le détermine à « l’heure fatale de l’art » (en 1935, alors qu’il est un exilé juif allemand antifasciste à Paris), la critique doit viser plus spécialement le « concept d’art, tel que nous l’a légué le XIXe siècle »17. C’est en effet au seuil de la seconde modernité que s’opère la révolution culturelle qui donne naissance à la religion de l’art encore largement répandue aujourd’hui. Avec le premier romantisme allemand, la littérature annonce qu’elle prend le pouvoir : suite au constat d’échec de la philosophie dressé par Kant dans sa Critique de la raison pure, c’est désormais aux poètes qu’échoit le pouvoir de donner l’accès à l’absolu18. Or les champs littéraire et artistique se construisent au XIXe siècle sur la croyance en ce pouvoir inouï, qui doit permettre aux écrivain·es et aux artistes de révéler des vérités transcendantes.
Le problème de cet idéalisme littéraire et artistique, analyse Benjamin, c’est qu’il repose sur le concept faux de vérité intemporelle et qu’il est donc fondamentalement idéologique. Cela signifie qu’en tant que fantasmagorie, il comporte intrinsèquement le risque de l’esthétisation, et d’ailleurs pas seulement dans le champ des activités littéraires et artistiques. Au nom de la vérité idéale à révéler, on s’abstrait de la réalité des faits ; or, de là à ce que de tels impératifs esthétiques, au-dessus de tout, s’accommodent d’une forme d’indifférence sociale, il n’y a qu’un pas qui est vite franchi. Historiquement, on a ainsi eu affaire à l’esthétisation de l’art, dans l’art pour l’art et dans l’œuvre d’art totale, qui a conduit à l’élaboration de faits artistiques « dans un sens fasciste » ; par exemple, dans les œuvres du futuriste italien Marinetti et de l’écrivain allemand Ernst Jünger, où l’on est passé de l’éloge de l’art pour l’art à celui de la guerre pour la guerre19. Puis on a eu affaire en outre à l’« esthétisation de la politique », qui n’est autre, selon Benjamin, que le fascisme lui-même (dans une définition qui inclut le nazisme)20.
Face au négationnisme, c’est bien cette critique de l’esthétisation qu’il s’agit de mettre en pratique. Car que se passe-t-il si l’on esthétise au point de ne plus faire la distinction, en termes de véridiction, ni entre roman et témoignage, ni entre roman et histoire ?
Ce n’est évidemment pas incident que la théorie romantique soit d’abord une théorie du roman et que le roman devienne, à partir du XIXe siècle, l’expression littéraire par excellence. Pour que la vérité idéale puisse être révélée, la condition est que le don de vision de l’écrivain·e ne connaisse aucune limitation. La fiction romanesque apparaît alors comme l’art total le plus adéquat à un tel pouvoir d’imagination. Or ce prestige du genre dans le champ littéraire est tel que, d’Henri Barbusse à Imre Kertész, en passant par Alexandre Soljenitsyne, nombre d’auteurs et d’autrices qui ont vécu une violence politique au XXe siècle ont opté pour le roman afin d’en « témoigner »21, et que ce parti pris n’est quasiment jamais interrogé. Il faut vraiment être iconoclaste comme Jean Norton Cru pour oser dénoncer l’illusion qui consiste à revendiquer à la fois la vérité du témoin et la licence d’imagination de l’artiste. Bien qu’on ne jure jamais de dire « la vérité, toute la vérité et rien que la vérité » dans une fiction, la croyance en vigueur dans le champ autorise à confondre roman et témoignage.
Les avant-gardes théoriques des années 1960-1970 ont cependant proposé de réviser l’idéalisme absolu des romantiques, dont il convient de préciser qu’il est un subjectivisme. À l’instar de Friedrich Schlegel, selon qui « [c]haque poème, chaque œuvre doit signifier le tout, le signifier vraiment et effectivement et, grâce à la signification…, l’être vraiment et effectivement »22, les romantiques avaient une confiance illimitée dans le pouvoir d’expression de la littérature. Mais, si on la retrouve souvent intacte au sein des avant-gardes historiques des années 1910-1920, cette foi dans le pouvoir de l’art prend du plomb dans l’aile au XXe siècle.
Après 1945, en particulier, s’ouvre une ère du soupçon dans laquelle la religion de l’art romantique se décline sous la forme d’une théologie négative. Non sans rapport avec toute une mystique de l’indicible à propos des crimes du nazisme, la thèse énoncée par Jacques Lacan suivant laquelle « le réel, c’est l’impossible » tend à devenir un leitmotiv, à partir de 1964. L’idée s’impose que les mots, qui sont d’une autre nature que les choses, sont voués à les manquer. Or, dans cette perspective, il ne s’agit plus seulement de proclamer la supériorité du roman sur le témoignage, censée consacrer le grand art des « écrivains » garants de la littérature comme valeur, par opposition aux modestes pratiques d’écriture des « écrivants ». Ce partage demeure, mais il s’agit en outre de mettre en cause toute visée d’écriture documentaire, comme si une telle visée ne pouvait que déboucher malgré soi sur une production de fiction.
C’est très patent dans le texte que Roland Barthes consacre en 1967 au « discours de l’histoire » : l’auteur pose la question de savoir si l’effort linguistique de signifier les choses, et spécialement de les narrer, ne revient pas constamment à fictionner, et donc – l’objectivité des historien·nes n’étant jamais que le produit d’une « illusion référentielle » – « s’il est bien légitime d’opposer toujours […] le récit fictif au récit historique »23. Or ce type de questionnement caractéristique de ce qu’on appellera plus tard la « French Theory » trouve une résonance au sein de la discipline historique, confrontée au même moment au « Linguistic Turn » du fait de la prise de conscience que l’histoire s’écrit. C’est alors en effet que, citant l’article de Barthes24 et qualifiant l’écriture de l’histoire de « literary, that is to say fiction-making, operation »25, l’historien américain Hayden White met en doute la capacité de l’histoire à établir un savoir vrai.
Relativement à cette dernière confusion entre roman et histoire, la critique est venue notamment d’historiens concernés et/ou spécialistes de la Shoah et mobilisés contre l’offensive négationniste ; en particulier, Pierre Vidal-Naquet, Saul Friedländer et Carlo Ginzburg26. Dans un essai sur le négationnisme en 1987, Vidal-Naquet a dénoncé la mauvaise consécution qui porte à croire que, parce que l’histoire s’écrit et que cette écriture « se modèle sur les formes littéraires, voire sur les figures de rhétorique », la distinction entre fiction et histoire s’annule, comme si « le discours historique ne se rattachait pas, par autant d’intermédiaires qu’on le voudra, à ce que l’on appellera, faute de mieux, le réel »27. De fait, a poursuivi Carlo Ginzburg en 1991, s’il était vrai que « dans la documentation historique nous ne trouvons aucun élément qui nous conduise à en construire la signification dans un sens plutôt que dans un autre »28, alors nous ne disposerions d’aucun critère, quoi qu’en dise White, qui nous permette de dénoncer la falsification négationniste de l’histoire. En réalité, White est partisan d’un « scepticisme absolu » qui, en dernier ressort, ne valide une interprétation historique comme vraie qu’en fonction de son « efficacité » (effectiveness), c’est-à-dire de sa capacité à s’imposer comme une représentation sociale dominante, de sorte que, « si la narration de Faurisson devait un jour se révéler efficace, White n’hésiterait pas à la considérer comme vraie »29.
Il revient cependant à Ginzburg d’avoir souligné le fascisme inhérent à cette esthétisation de l’histoire, de la part d’un auteur qui « s’est de moins en moins intéressé à la construction d’une “science générale de la société”, et de plus en plus au “côté artistique de l’activité historiographique” »30. Au demeurant, White l’avait assumé en 1982, arguant qu’il fallait « nous garder des sentimentalismes qui nous amèneraient à repousser une conception de l’histoire simplement parce qu’elle a été associée aux idéologies fascistes »31. Mais, dans la réception de White en général, c’est comme si l’on ne prêtait foi qu’à son antipathie prétendue pour les régimes fascistes, tant il est vrai que le relativisme postmoderne dont il se réclame paraît incompatible avec l’intolérance fasciste. Ginzburg montre avec force où mène en réalité l’éloge implicite d’une conception de l’histoire telle que celle du fasciste Giovanni Gentile, pour qui l’histoire « ne doit pas être un présupposé de l’historiographie » : à une argumentation non-sentimentale sur l’efficacité en matière de vérité historique qui « rappelle inévitablement […] le jugement de Gentile sur la matraque comme force morale », en contradiction totale avec le pseudo-plaidoyer de White en faveur de la tolérance.
Frédérik Detue
1 Paul Rassinier, Le Mensonge d’Ulysse. Regard sur la littérature concentrationnaire, préface d’Albert Paraz, Bourg-en-Bresse, Éditions bressanes, 1950.
2 Respectivement Nuremberg, ou la Terre promise (Paris, Les sept couleurs, 1948) et Nuremberg II ou les Faux monnayeurs (Paris, Les sept couleurs, 1950).
3 Sur le fait que « l’interprète de Balzac et le pamphlétaire fasciste sont bien le même écrivain », voir Anne Simonin, « On peut guérir de ses blessures. Bardèche, Balzac et la Seconde Guerre mondiale », dans Marc Dambre (dir.), Mémoires occupées, Paris, Presses Sorbonne nouvelle, coll. « Fiction/Non fiction XXI », 2013, p. 19-28, URL : https://books.openedition.org/psn/365.
4 Robert Faurisson, A-t-on lu Lautréamont ?, Paris, Gallimard, coll. « Les Essais », 1972. Voir Valérie Igounet, Robert Faurisson. Portrait d’un négationniste, Paris, Denoël, coll. « Médiations », 2012, p. 133.
5 Valérie Igounet, Robert Faurisson, op. cit., respectivement p. 135 et 139.
6 Ibid., p. 140. Voir aussi le rapport d’Henry Rousso cité dans la note suivante, p. 90.
7 Henry Rousso, Rapport sur le racisme et le négationnisme à Lyon-III, septembre 2004, p. 82, disponible en version PDF sur le site du Ministère de l’Éducation nationale : https://bit.ly/39rgwRD. Voir aussi cette idée reprise par l’auteur dans son article « Les racines du négationnisme en France », Cités, n° 36, 2008/4, p. 61, URL : https://bit.ly/2Hk0kpy. Quant à la création du « barbarisme […] de “négationnisme” » et à la justification de son emploi, voir, du même auteur, Le Syndrome de Vichy [1987], Paris, Le Seuil, coll. « Points Histoire », 1990, p. 176.
8 Jean Norton Cru, Témoins. Essai d’analyse et de critique des souvenirs de combattants édités en français de 1915 à 1928 (1929), Nancy, Presses universitaires de Nancy, coll. « Histoire contemporaine », 2006.
9 De façon très discutable, Christophe Prochasson a cherché à justifier la récupération idéologique de Cru par les négationnistes français. Outre qu’il croit reconnaître chez Cru un profil social analogue à celui de Rassinier, il distingue « une même conception réaliste de l’histoire » (« les mots doivent renvoyer aux choses »), dont il découle « un attachement analogue à la “science”, à l’“exactitude”, à la précision et à la minutie » (« Témoignages et expériences : les usages du “vrai” et du “faux” de Jean Norton Cru à Paul Rassinier », dans C. Prochasson, Anne Rasmussen (dir.), Vrai et faux dans la Grande Guerre, Paris, La Découverte, coll. « L’espace de l’histoire », 2004, p. 315). Frédéric Rousseau a justement critiqué ces réflexions « passablement inquiétantes » qui « paraissent valider la caution abusivement revendiquée par Rassinier et consorts » (voir Le Procès des témoins de la Grande guerre. L’affaire Norton Cru, Paris, Le Seuil, 2003, p. 264-270).
10 Voir Albert Paraz, Le Gala des vaches, Paris, les Éditions de l’élan, 1948.
11 Marie-Laure Delorme, « Antoine Gallimard au JDD : “Je n’ai pas renoncé aux pamphlets de Céline” », Journal du Dimanche, 03.03.2018, URL : https://bit.ly/32TM1BT.
12 Voir, à ce sujet, le texte de Marie Hartmann que Charlotte Lacoste et moi avons édité dans Europe : « Négation et détournement des témoignages concentrationnaires : la trilogie allemande de Louis-Ferdinand Céline », Europe. Témoigner en littérature, n° 1041-1042, janv.-fév. 2016, p. 99-114.
13 « Aujourd’hui, l’antisémitisme n’est plus du côté des chrétiens mais des musulmans, et ils ne vont pas lire les textes de Céline », soutient notamment l’éditeur dans un élan de mépris classiste et raciste (Nicole Vulser, Florent Georgesco, « Gallimard renonce à publier les pamphlets de Céline », Le Monde, 12.01.2018, URL : https://bit.ly/39pSCGE).
14 Voir la quatrième de couverture de Mais la musique soudain s’est tue. Journal 2009-2013 (Paris, Gallimard, collection blanche, 2015), dont voici le premier paragraphe : « Avec ses journaux intimes aux titres flamboyants, provocateurs […], Gabriel Matzneff s’est depuis sa jeunesse attiré une fâcheuse réputation de libertin, de mauvais sujet. Trop beau, trop libre, trop heureux, trop insolent, trop de lycéennes dans son lit, ça indispose les honnêtes gens. » Voir également l’excellente enquête sur la complaisance des milieux littéraires de Raphaëlle Bacqué et Ariane Chemin, « Gabriel Matzneff, questions sur un prix Renaudot », Le Monde, 06.01.2020, URL : https://bit.ly/2PUeXV0.
15 Charlotte Lacoste, Séductions du bourreau. Négation des victimes, Paris, PUF, coll. « Intervention philosophique », 2010.
16 Voir mon article « Pour en finir avec l’autonomie de la littérature, Jean Norton Cru (éloge d’un anticonformiste) », En Jeu. Histoire et mémoires vivantes, n° 6, décembre 2015, p. 63-74. Cet article, qui a été édité par Charlotte Lacoste, est disponible en ligne sur Academia.edu : https://bit.ly/2uZbMEl.
17 Walter Benjamin, compléments à « L’œuvre d’art à l’époque de sa reproduction mécanisée » (1936), Écrits français, Paris, Gallimard, coll. « Folio/Essais », 2003, p. 237.
18 L’absolu, à comprendre à la fois au sens ontologique d’être premier au principe de tout et au sens gnoséologique de fondateur ultime de la connaissance.
19 Je relie ici deux articles de Benjamin : « Théories du fascisme allemand » (1930), dans lequel Benjamin critique « l’ouvrage collectif Guerre et Guerriers, publié sous la direction d’Ernst Jünger » ; et « L’œuvre d’art à l’ère de sa reproductibilité technique (première version, 1935) », dans lequel Benjamin critique notamment « le manifeste de Marinetti sur la guerre d’Éthiopie » (Œuvres, t. III, trad. de l’allemand par M. de Gandillac, R. Rochlitz et P. Rusch, Paris, Gallimard, coll. « Folio/Essais », 2000, p. 111-112).
20 Voir W. Benjamin, « L’œuvre d’art à l’ère de sa reproductibilité technique », art. cité, p. 113.
21 Je me réfère ici au Feu (1916) de Barbusse, à Une Journée d’Ivan Denissovitch (1962) de Soljenitsyne et à Être sans destin (1975) de Kertész.
22 Friedrich Schlegel est une figure éminente du premier romantisme allemand. Pour cette citation en traduction française, voir W. Benjamin, Appendice : « La théorie esthétique des premiers romantiques et de Goethe », Le Concept de critique esthétique dans le romantisme allemand, trad. de l’allemand par Ph. Lacoue-Labarthe et A.-M. Lang, Paris, Flammarion, coll. « Champs », 2002, p. 171.
23 Roland Barthes, « Le discours de l’histoire » (1967), Œuvres complètes, t. 2, Paris, Le Seuil, 1994, p. 417 ; pour la critique de la prétention historienne à l’objectivité, voir p. 420.
24 L’épigraphe au recueil The Content of the Form de Hayden White est une citation de « Le discours de l’histoire » de Barthes : « Le fait n’a jamais qu’une existence linguistique. » (The Content of the Form. Narrative Discourse and Historical Representation, Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 1987, p. ii).
25 H. White, Tropics of Discourse. Essays in Cultural Criticism, Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 1978, p. 85.
26 Saul Friedländer a organisé, à l’Université de Californie à Los Angeles en 1991, un grand colloque dont les enjeux étaient relatifs à l’« approche postmoderne de l’histoire » de White (« Introduction », Probing the Limits of Representation. Nazism and the “Final Solution”, Cambridge (Mass.), Harvard Univ. Press, 1992, p. 6). C’est dans ce colloque que Carlo Ginzburg a prononcé la conférence « Just One Witness » que je cite plus bas d’après une version italienne révisée par l’auteur.
27 Pierre Vidal-Naquet, « Les assassins de la mémoire » (1987), Les Assassins de la mémoire, Paris, La Découverte, coll. « Cahiers libres », 1987, p. 148. Dans ce paragraphe que je cite, la note 39 renvoie aux travaux de White. Roger Chartier a prolongé cette critique : « Même s’il écrit dans une forme “littéraire”, l’historien ne fait pas de la littérature, et ce, du fait de sa double dépendance. Dépendance par rapport à l’archive, donc par rapport au passé dont celle-ci est la trace. […] Dépendance, ensuite, par rapport aux critères de scientificité et aux opérations techniques qui sont ceux de son “métier”. » (Au bord de l’histoire. L’histoire entre certitudes et inquiétude [1998], Paris, Albin Michel, coll. « Bibl. de l’évolution de l’humanité », 2009, p. 120-121).
28 H. White, « The Politics of Historical Interpretation: Discipline and De-Sublimation », Critical Inquiry, vol. 9, n° 1, 1982, p. 130 : « when it comes to the historical record, there are no grounds to be found in the record itself for preferring one way of construing its meaning rather than another ». Pour la traduction, voir Carlo Ginzburg, « Unus testis. L’extermination des Juifs et le principe de réalité », trad. française d’Élise Montel, Un Seul témoin, Paris, Bayard Éditions / Vacarme, 2007, p. 55.
29 C. Ginzburg, « Unus testis », Un Seul témoin, op. cit., p. 58. Quant au développement sur l’interprétation historique efficace, voir H. White, « The Politics of Historical Interpretation », art. cité, p. 135.
30 C. Ginzburg, « Unus testis », Un Seul témoin, op. cit., p. 36-37.
31 H. White, « The Politics of Historical Interpretation », art. cité, p. 130 : « In the politics of contemporary discussions of historical interpretation, the kind of perspective on history which I have been implicitly praising is conventionally associated with the ideologies of fascist regimes. Something like Schiller’s notion of the historical sublime or Nietzsche’s version of it is certainly present in the thought of such philosophers as Heidegger and Gentile as well as in the intuitions of Hitler and Mussolini. But having granted as much, we must guard against a sentimentalism that would lead us to write off such a conception of history simply because it has been associated with fascist ideologies. »