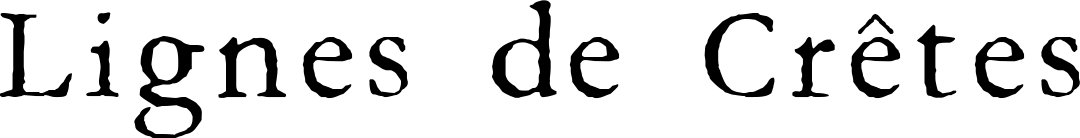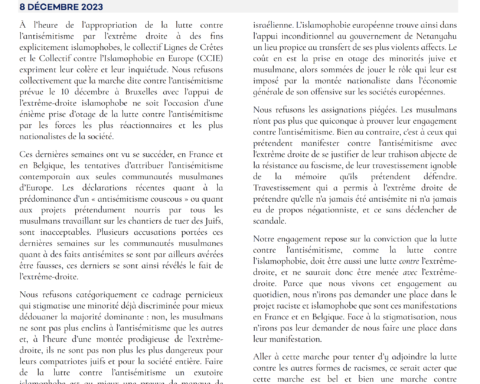Première partie ici
Deuxième partie ici
Au bonheur des négationnistes
(retour sur les pratiques du champ littéraire)
Troisième partie
La critique littéraire contre le « réalisme historien » : le déni du document littéraire
Évidemment, Nichanian ne peut tout de même pas faire comme s’il ignorait que le génocide nazi est amplement documenté. Mais c’est ici qu’intervient l’argumentaire antiréférentiel de White, appliqué spécialement aux écrits dans lesquels des victimes ont entrepris de témoigner. Pour le spécialiste des littératures arméniennes du XXe siècle, la question du « statut du témoignage » est en effet au cœur du débat suscité par les travaux de White, comme l’atteste au demeurant le fait que Carlo Ginzburg ait « construit sa critique dévastatrice de la position » de White « autour d’une idée indestructible du témoignage »[1]. L’enjeu est alors d’opposer à Ginzburg une conception du témoignage qualifiée de « moderne » – et prêtée à Renato Serra malgré l’auteur de « Just One Witness » – selon laquelle il « cess[e] d’être un document pour l’histoire et prév[aut] pour lui-même en tant que fait »[2].
C’est à cette conception autonomiste du témoignage que la critique littéraire contemporaine est sensible au premier chef. Mais ce qui est intéressant à observer à travers cette étude de cas, c’est le rapport de nécessité entre cette conception autonomiste et la métaphysique idéaliste d’après Auschwitz que j’ai exposée dans la partie précédente.
Il est entendu que « [l]e relativisme permet de ne se trouver nulle part au moment même où l’on prétend être équitablement partout », dans « un refus d’assumer la responsabilité d’une enquête critique »[3]. Mais les discussions autour de « Just One Witness » de C. Ginzburg, qui concernent le relativisme lui-même, obligent néanmoins à se positionner clairement sur le plan théorique. Le concernant, l’auteur de La Perversion historiographique livre un indice sur le site de son éditeur en prenant soin de rappeler qu’il a été l’« élève de Philippe Lacoue-Labarthe et Jean-Luc Nancy »[4]. De fait, c’est bien à l’aune de la tradition phénoménologique d’obédience heideggérienne dont Nichanian se revendique – dans un dialogue avec des œuvres de Blanchot, de Derrida, de Lyotard et d’Agamben – que l’« on mesure l’intérêt [de sa] démarche », selon Jean-Louis Jeannelle[5]. Or il apparaît que cet intérêt, de la part de la critique littéraire, participe d’une lutte de champs disciplinaires. Car il réside spécialement, par rapport au témoignage en littérature, dans le combat que Nichanian mène contre « le règne sans partage qu’exerce l’histoire comme discipline sur les œuvres littéraires consacrées aux res factae »[6].
Le moins que l’on puisse dire, pourtant, est que Nichanian ne fait pas dans la nuance lorsqu’il récuse en bloc la discipline historique pour cause de « réalisme », à entendre dans cet emploi au sens de « positivisme ». On ne saurait marquer son opposition philosophique aux sciences sociales de façon plus caricaturale. Même un historien critique du positivisme comme Carlo Ginzburg se voit reconduit à celui-ci en raison de sa « prise de position antirelativiste »[7]. Parce que celle-ci lui ferait répéter sans cesse que « [c]e n’est pas le discours qui crée les faits » et lui interdirait en conséquence toute « réflexion sur la possible destruction du fait »[8]. Quelle naïveté insigne de l’historien, en effet, que d’ignorer que « [l]’histoire est un complot »[9] !
Mais telle est la communauté de destin entre critique littéraire et idéalisme, dessinée depuis le romantisme, que cette condamnation du « réalisme historien » reçoit une approbation au nom de la littérature. En aucun cas il ne s’agit de voir dans cette récusation de la discipline historique en elle-même un fier service rendu aux négationnistes. Averti des préventions que l’on peut nourrir à cet égard, Jean-Louis Jeannelle exonère Nichanian d’une telle responsabilité[10], de la même façon que, selon Catherine Coquio, Nichanian lui-même « a […] raison de discuter l’affiliation de White au négationnisme et au fascisme »[11]. Il n’est dès lors pas étonnant que cette dernière renchérisse sur l’accusation de positivisme historien portée contre Ginzburg. N’ayant « pas fait de la Shoah son domaine d’étude », l’auteur de « Just One Witness » est « tomb[é] dans l’écueil qui avait fait trébucher White lui-même » par méconnaissance de la nature disruptive de l’événement génocidaire. Contrairement à White, pourtant, Ginzburg a lu le propos de Lyotard sur le « signe » d’Auschwitz, puisqu’il le cite, mais il ne l’a pas lu « jusqu’au bout : sans se confronter au fait de la destruction des traces, ou sans vouloir y voir une “destruction de la réalité” inédite. En refusant le signe, il oubliait le fait »[12].
C’est parce qu’il n’a pas lu Lyotard « jusqu’au bout » que Ginzburg peut penser réfuter White sur la base d’« une idée indestructible du témoignage ». Sinon, il saurait, ainsi que l’expose Nichanian, que « [c]e n’est pas de l’événement comme fait, [que] c’est de l’événement comme signe, que témoigne le témoignage »[13]. Et, suggère C. Coquio, il ne chercherait pas à « annex[er] » Si c’est un homme de Primo Levi en « sembl[ant] ignorer son irréductibilité à la preuve », alors que ce témoignage « n’était pas fait pour valider l’événement » mais pour « partager l’effort d’en comprendre l’énigme »[14].
Il s’agit bien ici de plaider – dans le sens des travaux de White, de Lyotard et d’Agamben, précise Nichanian – pour une « approche non historisante du témoignage », en cohérence avec un « traitement “irréaliste” mais “signifiant” de la réalité »[15]. Du point de vue de la critique littéraire, la possibilité d’une telle approche est fondatrice, en ce qu’elle détermine « la nature spécifiquement littéraire » des témoignages[16].
Cette critique reconnaît bien en fait que les écrits des témoins procèdent en règle générale d’une visée documentaire. C’est pourquoi elle juge, avec Gérard Genette, que la littérarité de ces écrits relève du conditionnel : parce que, compte tenu de cette visée documentaire, « leur caractère intentionnellement esthétique n’est pas garanti », et du même coup leur statut d’« œuvres »[17]. Dans cette perspective, des corpus presque entiers d’écrits testimoniaux sont considérés comme indignes d’une attention critique. Mais donc, telle est la magie de l’autonomie artistique que l’attribution d’une valeur esthétique à quelques témoignages triés sur le volet les destitue de leur valeur documentaire.
Catherine Coquio l’exposait dans un article paru en 2006 où elle se référait déjà au livre de Nichanian. Selon l’autrice, le témoignage littéraire du camp, dont elle traite dans ce texte, vise bien une « vérité » (avec guillemets). Mais, puisqu’elle se situe du côté de l’événement comme signe et non comme fait, « cette “vérité” visée par le “témoignage” ne saurait se rabattre sur la “réalité” des “faits” »[18]. Il faut donc comprendre que le témoignage se construit comme littérature contre la vocation documentaire à attester les faits :
« Le propos de l’écrivain n’est pas d’attester ces faits – même si la violence du déni lui tend constamment ce piège : à l’instant où il y tombe, le témoin se replace dans “l’horizon de l’archive” propre au positivisme historien, et cesse d’être écrivain. […] Le témoignage littéraire n’est évidemment pas un “document” de faits où puiserait l’historien […] mais un matériau essentiel pour tenter de penser, au-delà de la logique des faits attestés, la “vérité” humaine de tels événements destructeurs. »[19]
Réarticulant cette réflexion dans un livre de 2015 dédié aux « écritures de la Shoah », l’autrice concède désormais que le témoignage peut avoir une fonction d’attestation. Mais c’est une fonction facultative : tel Imre Kertész, les témoins peuvent y « renonc[er] […] pour dire vrai » dans une « fiction testimoniale »[20]. Du moment que fiction et témoignage sont conciliables, la vérité à dire en littérature se situe bien toujours « au-delà de la logique des faits attestés » – dans « le questionnement infini de l’attesté et du non-attestable », dans « le trajet de l’attestation à la véridiction […] qui fait aller du fait au sens sans quitter le serment »[21].
Paradoxe négationniste et mystique du témoignage : Giorgio Agamben, 1
Qu’il s’agisse du fait historique génocidaire en lui-même ou des témoignages qui en portent la trace, le sol se dérobe. Il n’est question ni de nier l’événement ni, pour ce faire, de disqualifier les écrits des témoins en tant que faux témoignages. Mais il est question en revanche – « en deça de l’histoire »[22], précise Nichanian – de contester les conditions de possibilité de l’affirmation du fait historique. Dans l’introduction de son livre d’inspiration derridienne, C. Coquio note ainsi que « du mal de vérité issu de la destruction du réel naît une vérité sans autorité, défendue par une science et un droit discutés à leur tour, portée par des témoignages qui ne sont pas des preuves », de sorte que, contrairement à ce que suggérait Vidal-Naquet, « [l]a vérité ici ne “triomphe” jamais »[23].
Or qu’une telle position rende bien service à ceux qui nient la vérité historique du génocide, c’est ce qui apparaît clairement quand on se demande ce qui reste aux témoins une fois qu’on les a dépossédé·es du pouvoir de la preuve.
Il y a deux manières de critiquer ce geste de dépossession comme illégitime. La première manière est de montrer qu’il entre en contradiction avec le pouvoir que les témoins eux-mêmes revendiquent de toutes leurs forces et que la critique du témoignage, de Marc Bloch et Jean Norton Cru à Carlo Ginzburg et Renaud Dulong, en passant par Michel Borwicz et Georges Perec, leur reconnaît de diverses façons[24]. En introduction d’un numéro de la revue Europe en 2016, Charlotte Lacoste et moi avons étudié dans ce sens ce que la production, la publication et la circulation de livres conçus comme des actes judiciaires ont fait à la littérature[25]. La deuxième manière est de pousser la thèse adverse dans ses derniers retranchements de façon à mieux encore en diagnostiquer les faiblesses. C’est cette deuxième manière qui me paraît ici la plus pertinente pour poursuivre mon propos.
Afin de soutenir l’idée que « la destruction de l’archive comme événement » a laissé place « au règne et à la puissance de l’archive autodévorante, par conséquent au changement radical de statut du témoin dans le temps postcatastrophique », Nichanian se fonde sur les « plus belles pages, à vingt ans d’intervalle » de « deux philosophes, Lyotard et Agamben »[26]. C’est ainsi que l’œuvre de White est revue et corrigée à la lumière de « ce maître-livre qu’est Le Différend », qui est lui-même interprété d’après Ce qui reste d’Auschwitz (1998).
On apprend alors que témoigner de l’événement comme signe revient à « témoigner de l’impossibilité de témoigner » et que ce paradoxe, attribué par Agamben à Primo Levi, « contient l’unique réfutation possible de tous les arguments négationnistes »[27].
Cette « belle page » d’Agamben, qui contient assurément la thèse la plus kitsch qu’on ait jamais imaginé d’avancer contre le négationnisme, était certes bien faite pour séduire un auteur comme Nichanian. C. Coquio valide également cette « idéale résolution », au nom de « l’expérience des survivants »[28]. Or il convient d’en préciser tous les tenants et aboutissants afin d’en mesurer le caractère insoutenable. On avait rarement repris à son compte autant de pseudo-arguments négationnistes tout en prétendant les réfuter, en effet.
On le sait, dans Ce qui reste d’Auschwitz, Agamben fonde sa réflexion consacrée au témoignage sur une lecture de l’œuvre de Primo Levi, et plus particulièrement du dernier livre paru du vivant de cet auteur, Les Naufragés et les Rescapés. Levi y revient sur cette figure connue de tou·tes les détenu·es concentrationnaires et qui était désignée, dans l’argot du camp d’Auschwitz-III Monowitz où se trouvait Levi, par le terme de « Muselmann » ; « c’est ainsi que les anciens du camp surnommaient, j’ignore pourquoi, les faibles, les inadaptés, ceux qui étaient voués à la sélection », précisait l’auteur dans une note de Si c’est un homme[29]. Quarante ans après Auschwitz, il lui apparaît que « ce sont eux, les “musulmans” [“mussulmani”], les engloutis, les témoins intégraux, ceux dont la déposition aurait eu une signification générale »[30].
On reconnaît dans ce passage l’éthique poignante du témoin soucieux de ne pas concentrer l’attention sur les rescapés et de prendre la parole pour les « engloutis », « par délégation », afin de décrire les violences subies les plus représentatives du sort commun. N’ayant pas vécu, comme c’était pourtant « la règle », « [l]a destruction menée à son terme », Levi a l’honnêteté de préciser qu’il ne peut témoigner de celle-ci qu’imparfaitement, à « compte de tiers »[31].
Mais un tel sens de la mesure, caractéristique de l’art testimonial, ne convient pas à Agamben, qui tire de cette réflexion de Levi un prétendu paradoxe logique composé de « deux propositions contradictoires : 1. “Le musulman est le non-homme, celui qui ne peut en aucun cas témoigner.” 2. “Celui qui ne peut témoigner est le vrai témoin, le témoin absolu.” »[32]
Comme l’a justement remarqué Carlo Ginzburg, « [l]e “témoin absolu” d’Agamben ne correspond pas au “témoin intégral” de Levi – la notion d’absolu étant aussi éloignée que possible de l’esprit de ce dernier »[33]. De fait, le « paradoxe de Levi » suivant Agamben n’est qu’une variante, dans Ce qui reste d’Auschwitz, du paradoxe de Faurisson tel qu’il est exposé « ironiquement » par Lyotard dans Le Différend :
« Avoir “réellement vu de ses propres yeux” une chambre à gaz serait la condition qui donne l’autorité de dire qu’elle existe et de persuader l’incrédule. Encore faut-il prouver qu’elle tuait au moment où on l’a vue. La seule preuve recevable qu’elle tuait est qu’on en est mort. Mais, si l’on est mort, on ne peut témoigner que c’est du fait de la chambre à gaz. »[34]
Et le « paradoxe logique » dans ses deux déclinaisons justifie « une définition de la shoah comme “événement sans témoin” », ainsi que l’ont proposé Shoshana Felman et Dori Laub, puisqu’« il est impossible d’en témoigner de l’intérieur […] comme de l’extérieur »[35].
Il est piquant d’observer la peine que se donne Agamben de critiquer la rhétorique de l’indicible, censée « conférer à l’extermination le prestige de la mystique »[36], dans un livre qu’il dédie lui-même tout entier à une mystique du témoignage, construite autour d’une figure de « témoin absolu » qui personnifie l’« intémoignable », « l’impossibilité de témoigner »[37]. Cependant, malgré le « signe » d’Auschwitz, il se détourne des victimes exemplaires de l’extermination (le peuple juif assassiné dans le centre de mise à mort de Birkenau) pour se focaliser exclusivement sur les victimes, juives et non-juives, exemplaires de l’univers concentrationnaire (les « Muselmänner », appelés autrement dans le jargon d’autres camps nazis en Europe[38]). Alors que « 80 % des Juifs acheminés à destination d’Auschwitz-Birkenau n’ont pas eu à subir la rigueur du climat silésien, leur mort intervenant dans les heures suivant leur arrivée »[39], il soutient sur un ton péremptoire :
« Avant même d’être le camp de la mort, Auschwitz est le théâtre d’une expérimentation toujours impensée, dans laquelle, au-delà de la vie et de la mort, le juif se transforme en musulman, l’homme en non-homme. Et nous n’aurons compris Auschwitz que lorsque nous aurons compris qui est, ou ce qu’est le musulman […]. »[40]
Contre le constat du survivant Jean Améry, selon qui « [c]e qui se produisait d’abord [à Auschwitz], c’était l’effondrement total de la représentation esthétique de la mort »[41], l’esthétisation du témoignage passe alors, à travers l’image sensationnelle de « cadavre ambulant » qu’offre le « Muselmann », par une esthétisation de la mort d’inspiration heideggérienne – qui consiste pour Agamben à se demander, en dialogue avec son maître d’autrefois, si l’on mourait vraiment à Auschwitz[42].
Au demeurant, l’esthétisation du témoignage à l’œuvre dans le livre est elle-même d’inspiration heideggérienne, comme l’a encore analysé Carlo Ginzburg[43]. C’est ce qui intéresse beaucoup Nichanian, lorsqu’il présente « le paradoxe de Primo Levi » selon Agamben comme « une réfutation de l’archive ».
Témoigner « par délégation » pour les « Muselmänner », selon Levi, c’est concevoir son témoignage « comme un acte judiciaire » en décrivant et en donnant à comprendre la mort des autres au « Lager » telle qu’elle a été programmée et organisée par l’« impitoyable processus de sélection »[44] du système concentrationnaire nazi ; c’est l’objet en particulier du neuvième chapitre de Si c’est un homme. Dans un passage de son premier chapitre où il qualifie les rescapés de « pseudo-témoins », Agamben donne un sens opposé à la délégation. Malgré Levi, il n’est pas question de témoigner « pour la vérité et pour la justice », puisque « le témoignage vaut ici essentiellement pour ce qui lui manque » : « cet “intémoignable” [qu’il porte en son cœur et] qui prive les rescapés de toute autorité ». D’ailleurs, « parler par délégation n’a ici guère de sens : les engloutis n’ont rien à dire, aucune instruction ou mémoire à transmettre »[45].
Comme « les engloutis n’ont rien à dire », « l’autorité du témoignage ne dépend pas d’une vérité factuelle, de la conformité entre la parole et les faits, la mémoire et le passé »[46]. C’est l’objet du quatrième chapitre de Ce qui reste d’Auschwitz, en effet, de définir ontologiquement le témoignage par « son extériorité par rapport à l’archive », non comme un acte de parole mais comme une propriété de la langue, et donc en rapport avec une pure puissance de dire sans sujet. L’autorité du témoignage dépend alors « de la relation immémoriale entre dicible et indicible, entre dedans et dehors de la langue »[47]. C’est dans cette définition faisant du témoignage un événement transcendantal – un pur acte de langage qui se produit dans un « a priori historique » – que gît un héritage heideggérien qu’Agamben a toujours assumé ouvertement[48].
On a affaire ici à une définition du témoignage qui l’autonomise tellement par rapport à la notion de preuve que le témoin n’a même pas besoin d’avoir vécu ni vu une réalité pour en témoigner. C’est bien pourquoi « le témoin par excellence » d’Auschwitz dans le livre d’Agamben n’est pas Levi, dont l’idéal de sobriété élaboré sur le modèle de la déposition en justice répugne naturellement à l’auteur, mais Paul Celan, qui est rescapé de l’extermination en Roumanie mais qui, contrairement à ses parents, a échappé à la déportation dans un camp nazi de Transnistrie : le « langage manchot et obscur » de la poésie de Celan, qui effraie Levi « comme le râle d’un moribond », est de fait plus crédible en tant qu’expression du « témoin absolu »[49].
Cette autonomisation n’est pas une difficulté, car c’est bien en « témoignant pour (les “Muselmänner”) » et non en « témoignant de (Auschwitz) » que les rescapés, « pseudo-témoins », sont censés faire pièce aux « arguments négationnistes » :
« Si le rescapé témoigne, non des chambres à gaz ou d’Auschwitz, mais pour le musulman, s’il parle seulement à partir d’une impossibilité de parler, alors son témoignage est indéniable. Auschwitz – ce dont il est impossible de témoigner – est prouvé de façon absolue et irréfutable. »[50]
« Conclusion dérisoire, et pourtant rendue inévitable par la démarche qui l’a précédée », comme le diagnostique C. Ginzburg : « une réfutation tirée de la nature intrinsèque du langage ne pourra jamais réfuter le mensonge du négationnisme »[51].
L’idée d’une « preuve absolue et irréfutable » d’Auschwitz mérite cependant de retenir notre attention. Car, si elle est récusée par Agamben dans ses emplois historique et juridique, la notion de preuve se trouve soudain convoquée ici dans un emploi théologique. C’est pourquoi je parlais plus haut de mystique du témoignage. Nous avons affaire précisément à une preuve absolue d’Auschwitz d’après la réfutation par Kant des preuves de l’existence de Dieu.
La phrase qui précède la conclusion dérisoire que je viens de citer énonce ceci : « Chez le musulman, l’impossibilité de témoigner n’est plus, en effet, une simple privation ; elle est devenue réelle, elle existe comme telle »[52]. Suivant une tradition idéaliste issue du romantisme, la preuve absolue procède ainsi d’abord d’une ontologie poétique : dès lors que, témoignant par délégation pour le « Muselmann », le rescapé parle à partir d’une impossibilité de parler, le « Muselmann » est. « L’expérience centrale de la poiesis, exposait Agamben dans un jargon heideggérien en 1970, [est] la pro-duction dans la présence, […] le fait que [dans l’œuvre] quelque chose advienne à l’être à partir du non-être, ouvrant ainsi l’espace de la vérité (ά-λήθεία) et édifiant un monde pour l’habitation de l’homme sur terre »[53].
C’est parce que le rescapé fait advenir le « Muselmann » poétiquement qu’Auschwitz est « prouvé de façon absolue et irréfutable ». Agamben, qui emprunte le « concept théologico-messianique » de « reste » à saint Paul pour définir « les témoins », fait clairement ici coïncider l’idée d’œuvre d’art selon Heidegger avec l’idée chrétienne de témoignage, telle qu’on la trouve entre autres chez l’apôtre de Jésus Christ[54]. De même que, suivant Paul, les apôtres « témoignent par la proclamation de l’Évangile », que par eux « le témoignage du Christ a pris fermeté »[55], – de même, suivant Agamben, les rescapés témoignent en proclamant « l’intémoigné » du « témoin absolu » qu’est « le musulman »[56]. Et de même que, suivant Paul, le Christ est, en tant que Verbe fait pleinement chair sur la Croix, le témoin de Dieu[57], – de même, suivant Agamben, le « musulman » est, en tant que « sans-parole » fait pleinement chair au Lager, le témoin d’Auschwitz.
Or il convient de mesurer pour finir ce qui est en jeu dans cette religion du témoignage. Comme le suggère sans ambiguïté la remotivation par Agamben du concept paulinien de reste, l’enjeu est le salut du peuple juif, dans le temps messianique ouvert par l’événement d’Auschwitz – dans ce qui reste entre les naufragés et les rescapés[58]. C’est de cette façon que l’auteur parvient à justifier, « dans la situation extrême du camp », « le principe hölderlinien que Heidegger invoque souvent – “là où est le danger, là surgit ce qui sauve” », en concevant « une appropriation et un rachat possibles »[59]. Dans ce sens, il faut bien comprendre que la négativité d’Auschwitz est dialectique. Il est très significatif à cet égard que, tandis que Levi se remémorait des vers de l’Enfer de Dante à Auschwitz, Agamben convoque Dante pour comparer Auschwitz au paradis :
« L’espace du camp […] se laisse même représenter comme une série de cercles concentriques qui, telle une onde, frôlent continuellement un non-lieu central où se tient le musulman. […] Toute la population du camp n’est en fait qu’un immense tourbillon tournant obstinément autour d’un centre sans visage. Mais ce vortex anonyme, comme la rose mystique du paradis de Dante, est “peint à notre image” et porte en lui-même l’image véritable de l’homme. »[60]
Dans son œuvre antisémite Le Judaïsme dans la musique (1850), Richard Wagner avait imaginé pour les Juifs et Juives allemand·es une « œuvre de rédemption où la destruction régénère » : « réfléchissez qu’il existe un seul moyen de conjurer la malédiction qui pèse sur vous : la rédemption d’Ahasvarus, – l’anéantissement [der Untergang] », leur suggérait-il[61]. Commentant ce passage, Adorno observait que l’antisémitisme wagnérien se distinguait du moins de « sa postérité idéologique » en ceci que, pour Wagner, « l’extermination signifiait le salut »[62]. Pour Agamben, cependant, l’extermination nazie signifie encore le salut.
Esthétisation fasciste du génocide nazi et disqualification des témoins : Giorgio Agamben, 2
Voilà où conduit dans cette œuvre le déni du document : à une esthétisation de la politique. À défaut de pouvoir témoigner d’Auschwitz « pour la vérité et pour la justice », les rescapé·es peuvent du moins témoigner par délégation pour le salut. Or, d’une conception du témoignage à l’autre, il convient de noter que le problème de la culpabilité ne concerne plus les criminel·les nazi·es – mais les victimes juives[63].
Au demeurant, on comprend bien que le parti de dénier au témoignage une fonction d’attestation des faits lui ôte son statut de déposition contre les criminel·les. Mais, comme les autres auteurs que j’ai abordés précédemment, Agamben ne se contente pas de réfuter cette destination du témoignage par une « lacune » intrinsèque à sa nature linguistique. Il s’agit encore de soutenir que l’impossibilité de juger les criminel·les est inhérente à l’événement lui-même.
Après avoir abondé dans le sens de Lyotard au sujet de « la non-coïncidence des faits et de la vérité, du constat et de la compréhension » qui fait que « l’aporie d’Auschwitz est l’aporie même de la connaissance historique », Agamben nous avertit que son livre « n’est pas un livre d’histoire, mais une recherche sur l’éthique et le témoignage »[64]. Cependant, il apparaît au premier chapitre que l’enjeu de penser Auschwitz comme une « terre neuve éthique »[65] ne vise pas directement à récuser la compétence historique mais d’abord à récuser la compétence juridique.
Le livre tout entier se fonde sur deux horribles déformations de l’œuvre de Primo Levi corrélées entre elles. Comme nous l’avons vu, la première concerne l’expression de « témoins intégraux » employée par Levi à propos des « Muselmänner » dans Les Naufragés et les Rescapés. Agamben conçoit un faux « paradoxe de Levi », qui procède d’une logique négationniste, afin de promouvoir le témoignage religieux contre le témoignage juridique. Or cette manipulation est soutenue dans le livre par une seconde malversation au sujet du concept de « zone grise » forgé par Levi dans le même livre. Où il s’agit donc cette fois de promouvoir une approche « éthique » d’Auschwitz contre une approche juridique – étant entendu qu’« [i]l y a une consistance non juridique de la vérité »[66]. C’est ainsi la falsification du concept de « zone grise » qui donne la clé de compréhension du salut testimonial selon Agamben.
L’auteur crédite Levi d’avoir fait, avec ce qu’il a nommé « zone grise » pour éclairer un aspect du phénomène Lager, la « découverte inouïe » d’« un nouvel élément éthique »[67]. Pour Agamben, ce « nouvel élément éthique » est « un matériau réfractaire à tout établissement d’une responsabilité », de sorte que la « zone grise » de Levi peut être définie comme une « zone infâme d’irresponsabilité » où « se grave la leçon de “la terrible, l’indicible, l’impensable banalité du mal” »[68]. Voici l’extrait où il justifie cette interprétation :
« il [Levi] semble ne s’intéresser qu’à ce qui rend le jugement impossible, cette “zone grise” où victimes et bourreaux échangent leurs rôles. C’est surtout sur ce point que les rescapés sont d’accord : “Un groupe n’était pas plus humain qu’un autre” (p. 232). “Victime et bourreau sont également ignobles, et la leçon des camps, c’est la fraternité dans l’abjection.” (Rousset, cité par Levi, 1, p. 216.) »[69]
La dernière citation ressemble à ces citations arrachées aux vaincus pour composer le butin des vainqueurs dont parle Walter Benjamin dans son dernier écrit. Elle est extraite du roman Les Jours de notre mort (1947) de David Rousset, rescapé de sa détention comme prisonnier politique au camp de concentration de Buchenwald. Or 1) elle est tout sauf une intervention d’auteur dans ce roman concentrationnaire et ne peut donc pas être attribuée à Rousset en tant que discours de rescapé ; 2) elle n’est pas citée par Levi mais par son intervieweur Marco Vigevani au cours d’un entretien en 1984 – et Levi la traite aussitôt de « déclaration épouvantable » digne « de Liliana Cavani »[70], autrice du film Portier de nuit en 1974 ; 3) elle est citée en revanche – plus longuement – par Rassinier comme un des « moments de sincérité »[71] de Rousset, et elle sert si bien le projet de l’auteur négationniste qu’il la place en épigraphe du récit de sa propre déportation.
En aucun cas la « zone grise » de Levi ne « rend le jugement impossible », et l’auteur le précise « avec une prudence extrême » dans le chapitre qu’il lui a consacré aussi bien que dans la réponse qu’il a faite à Marco Vigevani. Il concède d’abord qu’au Lager, étant donné qu’il existait une catégorie de « prisonniers privilégiés » qui ont collaboré avec les nazis, « la ligne qui sépare la victime du bourreau s’“estompait” », qu’« il n’y avait pas la séparation nette qu’on imagine ». Mais il récuse, « naturellement », le « jugement moral » qui englobe le bourreau et la victime sous la marque d’une même ignominie, arguant « que le bourreau est un bourreau, et la victime une victime »[72]. Chacun·e sa place dans l’histoire.
L’analyse de la « zone grise » est accablante pour le dispositif criminel qui prévoit de compromettre les victimes dans le crime. Ne pas laisser d’autre choix à une victime, si elle veut espérer survivre, que de se rendre complice du crime est d’une perversité sans nom. À propos de l’affectation aux crématoires d’équipes de Sonderkommandos, Levi parle ainsi du « crime le plus démoniaque du national-socialisme »[73]. Dès lors, la complication du jugement, qui n’est d’ailleurs pas une impossibilité de juger, ne concerne certainement pas les criminel·les, dont la faute est au contraire aggravée par un tel dispositif. Elle concerne les seules victimes, sachant que « [l]a condition d’offensé n’exclut pas la faute » mais que « les erreurs et les défaillances des prisonniers ne suffisent pas pour qu’on les mette sur le même rang que leurs gardiens »[74].
Le jugement moral qui vise néanmoins à mettre sur le même rang victimes et criminel·les est d’autant plus intolérable, pour Levi, que le négationnisme est devenu un phénomène de société préoccupant. C’est pourquoi il ne décolère pas face à l’esthétisation du nazisme à laquelle l’autrice de Portier de nuit se livre exemplairement : « confondre [les assassins] avec leurs victimes est une maladie morale ou une coquetterie esthétique ou un signe sinistre de complicité ; c’est surtout un précieux service rendu (volontairement ou non) à ceux qui nient la vérité »[75].
Agamben se moque de l’avertissement, cependant. Ce faisant, il confond la réflexion de Levi sur le « sujet délicat » de la zone grise avec le discours fascisant d’un personnage de « Kapo » aussi compromis que possible dans la collaboration avec les nazis, dont le mépris de l’humanité est tel qu’il s’est taillé « une réputation assez sinistre parmi le commun des détenus » et qui se justifie sa violence à lui-même en arguant d’une disponibilité naturelle de l’homme à devenir un ignoble criminel dans un camp nazi[76].
Tandis que Rousset construisait son roman contre ce discours de son personnage, Rassinier se saisissait de celui-ci pour clamer « la leçon des camps » qu’il contient contre les « fades images d’Épinal » « invent[ées] » après-coup par « les rescapés »[77]. Agamben s’en saisit pour sa part dans le but de justifier moralement le besoin de témoigner pour les « Muselmänner » par le sentiment de culpabilité des rescapés.
D’abord, l’interprétation falsifiée de la « zone grise » à travers ce discours amène logiquement Agamben à évacuer le problème de la culpabilité des criminel·les. Avec la « zone grise », expose-t-il, nous sommes confronté·es à un problème éthique « tellement énorme qu’il met en cause le droit lui-même, qu’il le mène à la ruine »[78]. Il s’agit à cet égard de critiquer l’action de la justice pénale internationale d’après Nuremberg, car elle a faussement « accrédité l’idée que le problème était réglé » et ainsi contribué à « cette confusion des esprits qui pendant plusieurs décennies empêcha de penser Auschwitz ».
Cette critique du droit international des droits humains est certes cohérente avec le refus du témoignage juridique – et on n’en attendait pas moins de la part de l’auteur d’Homo Sacer pour qui l’idée de droits de l’homme n’est qu’une fiction juridique qui a servi à légitimer la violence souveraine de l’État-Nation[79]. Mais il est plus surprenant, peut-être, de découvrir que l’éthique telle que la conçoit l’auteur légitime quant à elle la ligne générale de défense des criminel·les nazi·es, en toute circonstance et en particulier lors des procès où ils/elles ont comparu en tant qu’accusé·es.
Dans les « Notes sur le geste », en 1992, Agamben écrivait que le geste, en tant qu’il consiste à assumer la responsabilité d’une action, « ouvre la sphère de l’èthos comme sphère la plus propre de l’homme »[80]. Mais c’est apparemment un propos tenu avant d’avoir imaginé un « nouvel élément éthique » à partir de l’œuvre de Levi. Dans Ce qui reste d’Auschwitz, en 1998, Agamben soutient désormais que « [l]e geste d’assumer une responsabilité est […] foncièrement juridique, et non éthique » et qu’en fait, « l’éthique est la sphère qui ne connaît ni faute ni responsabilité »[81]. Or voyons comment cela revient à donner raison à la stratégie d’Adolf Eichmann à Jérusalem, à celle de Franz Stangl à Düsseldorf ou encore – dans le cas d’un autre génocide – à celle de Duch à Phnom Penh.
Gitta Sereny, qui s’est entretenu avec Stangl, commandant du centre de mise à mort nazi de Treblinka, et Rithy Panh, qui s’est entretenu avec Duch, directeur du centre de torture et d’exécution khmer rouge Tuol Sleng (connu sous le nom de code de S21), ont été longuement confrontés à la stratégie d’un homme qui « cherche l’innocence dans l’horreur » en faisant comme si, « même acteur du crime, [il était] innocent »[82]. Bien qu’il ne conteste pas les faits, Stangl dit exemplairement : « J’ai la conscience nette de tout ce que j’ai fait moi-même »[83]. Pour qu’on ait « affaire à un crime punissable », expose-t-il encore, il faut quatre éléments : « un sujet, un objet, une action, une intention »[84] ; il se convainc que dans son cas manque tantôt l’action (« je suis présent, mais je ne fais rien à personne »[85]), tantôt l’intention, qu’il appelle « libre volonté » (« Ce que j’ai fait sans ou contre ma libre volonté, de cela je n’ai pas à répondre »[86]) : il libère sa conscience en arguant tantôt qu’il n’exécute pas lui-même les basses œuvres de l’extermination, tantôt qu’il ne fait qu’obéir aux ordres de ses supérieurs.
De façon générale, c’est une attitude qui conduit à déclarer tout uniment la justice humaine incompétente pour juger la nature de la culpabilité des accusés. C’est pourquoi, avant de faire appel du jugement lors de son procès, Stangl a demandé la « compréhension » de ses juges en concluant sa défense par les mots suivants : « Le Seigneur me connaît et ma conscience ne me condamne pas »[87]. Se déclarer « coupable devant Dieu et non devant la loi » – comme Eichmann l’avait fait à Jérusalem par la voix de son avocat le Dr Servatius –, c’est une façon de chercher la rédemption. Ce n’est donc pas contradictoire avec le fait de juger juste avant sa mort – comme Stangl – que « [s]a faute est d’être encore là »[88] ou de proposer – comme Eichmann – de « [s]e pendre en public […] pour contribuer à l’allégement du poids de la culpabilité qui pèse sur la jeunesse allemande »[89].
À Duch qui lit la Bible tous les jours dans sa prison et qui adopte aussi une posture factice de victime sacrificielle, Rithy Panh répond : « Monsieur Duch, vous endossez trop »[90]. À l’inverse, Agamben a beau ironiser sur le recours des bourreaux au modèle tragique de la « faute innocente » – reste qu’il justifie théoriquement la posture en invoquant « une responsabilité infiniment plus grande que celle que nous serons jamais capables d’assumer », soit une responsabilité telle qu’elle équivaut à une « non-responsabilité »[91].
L’enjeu d’un livre « où victimes et bourreaux échangent leurs rôles », cependant, est de montrer que les rescapé·es sont condamné·es à se débattre avec les mêmes problèmes moraux que les criminel·les. L’ironie à propos du recours au « noble masque de la faute innocente » vise d’ailleurs aussi bien – à quelques lignes d’intervalle – le rescapé Bruno Bettelheim que le criminel Eichmann. Il ne peut en aller autrement à partir du moment où l’auteur étend le concept arendtien de « banalité du mal » aux victimes. « La sphère qui ne connaît ni faute ni responsabilité », mais qui est déterminée à Auschwitz par une « zone grise » qualifiée d’« infâme », est ainsi le lieu d’un transfert de culpabilité des criminel·les vers leurs victimes. C’est pourquoi la grande affaire des rescapé·es est « la honte » (que le rescapé Levi a eu tort de « rabattre hâtivement sur la culpabilité » mais que Heidegger – cité par Levi comme un exemple d’intellectuel « complice du pouvoir » sous le nazisme – a défini correctement comme « une espèce de sentiment ontologique » dans son cours sur Parménide de l’hiver 1942-1943[92]).
Le sens du salut testimonial imaginé par Agamben se dévoile enfin. L’auteur retient contre les témoins rescapés le constat dressé par Levi qu’ils ont « tous, d’une manière ou d’une autre, joui d’un privilège »[93]. Si la « zone grise » provoque chez les rescapés un sentiment de honte dont ils ne peuvent jamais venir à bout, c’est, selon lui, parce que la solidarité entre victimes et bourreaux les concernait spécialement, eux, en tant que prisonniers « privilégiés » – et que cette solidarité s’est édifiée aux dépens des « Muselmänner ». Le besoin que les rescapés éprouvent de témoigner pour les engloutis trouve ainsi sa source dans « la honte inouïe des rescapés devant les engloutis »[94] – ces « détenu[s] qui cessai[ent] de lutter et que les camarades laissaient tomber » ; dont « [p]ersonne n’avait pitié » et qui « ne pouvai[ent] compter sur la sympathie de personne » ; que même « personne ne v[oulait] voir », suivant différents écrits de rescapés cités de façon suggestive par l’auteur[95].
Afin que nous ne doutions pas de la disqualification morale des rescapés ici à l’œuvre, Agamben se charge de l’expliciter par un nouveau paradoxe spectaculaire. Nous avons pu observer plus haut qu’il aime désigner le « Muselmann » par le vocable « non-homme », qui trouve sa source en particulier dans le chapitre 9 de Si c’est un homme. Mais c’est sans compter sur le fait que, de même que celui qui ne peut témoigner est le « témoin absolu », le non-homme « sans visage » offre en réalité « l’image véritable de l’homme ». C’est ce que « Levi nous révèle lorsqu’il écrit que “ce sont eux, les “musulmans”, les engloutis, les témoins intégraux” : “l’homme est le non-homme ; est véritablement humain celui dont l’humanité fut intégralement détruite” »[96].
Si les détenus concentrationnaires qui continuent de lutter pour la survie se détournent des « Muselmänner », ce n’est pas comme ils le disent parce qu’ils sont terrifiés à l’idée de suivre la même pente, mais parce qu’ils « se reconnaissent dans [leur] visage biffé »[97]. C’est eux-mêmes qui deviennent véritablement inhumains en continuant, en tant que « privilégiés », d’appartenir à la même humanité que les bourreaux. Ceux qui, suivant la règle impitoyable du camp, se déshumanisent et perdent toute dignité sont « ceux que leurs vertus ont rendus moins adaptés » – et leur manque de dignité humaine est donc le signe de leur appartenance à la véritable humanité :
« Car telle est l’aporie éthique propre à Auschwitz : un lieu où il est indécent de rester décent, où ceux qui ont cru conserver leur dignité et leur respect de soi n’éprouvent que honte devant ceux qui les ont sur-le-champ perdus. »[98]
Frédérik Detue
(Quatrième partie conclusive à suivre)
[1] M. Nichanian, La Perversion historiographique, op. cit., p. 107.
[2] Ibid., p. 133.
[3] Donna Haraway, « Situated Knowledge » (1988), cité par C. Ginzburg, Introduction, Rapports de force. Histoire, rhétorique, preuve, trad. de l’italien par Jean-Pierre Bardos, Paris, Gallimard / Le Seuil, coll. « Hautes études », 2003, p. 30.
[4] Comme le précise la fiche biobibliographique de l’auteur sur le site des éditions Lignes qui ont édité La Perversion historiographique : https://www.editions-lignes.com/_Nichanian-Marc_.html.
[5] J.-L. Jeannelle, « Marc Nichanian : le témoignage malgré tout », art. cité, p. 206 : selon l’auteur, l’entreprise de Nichanian « prolonge les interrogations de Maurice Blanchot (La Folie du jour, 1949), de Jean-François Lyotard (Le Différend, 1983), de Jacques Derrida (Demeure, 1998), ou de Giorgio Agamben (Ce qui reste d’Auschwitz, 1999) sur la possibilité même de témoigner, tout en en infléchissant le propos. Aux références qui précèdent, on mesure l’intérêt d’une telle démarche mais aussi le risque pour celle-ci d’aboutir à une forme d’apophatisme », prévient l’auteur – mais la conclusion de l’article lave Nichanian de ce soupçon de théologie négative au nom de sa poétique du témoignage (ibid., p. 219).
[6] Ibid., p. 207.
[7] M. Nichanian, La Perversion historiographique, op. cit., p. 132. Selon l’auteur, Renato Serra « va aussi loin qu’il est possible d’aller dans la mise en question entre le fait et le témoignage » ; or, « malgré cette attitude fortement critique envers tout positivisme historique et tout discours péremptoire sur la réalité des faits, il n’en reste pas moins que, pour Ginzburg, “reality […] exists” » (ibid., p. 131-132).
[8] Ibid., p. 137. C’est l’auteur qui souligne.
[9] C’est le titre d’un développement de Nichanian : ibid., p. 122-129. C’est par ce mot de complot que Nichanian propose de traduire le terme d’« emplotment » employé par White et ordinairement assimilé en français au concept de « mise en intrigue » forgé par Paul Ricœur. En bon heideggérien, Nichanian précise que « [l]e complot est une catégorie existentielle, au sens de Sein und Zeit » (ibid., p. 125). Autrefois élève de Heidegger, Giorgio Agamben, qui parle de « l’invention d’une épidémie » en 2020, soutient pareillement « qu’il y a des conspirations pour ainsi dire objectives » (« Giorgio Agamben : “L’épidémie montre clairement que l’état d’exception est devenu la condition normale” », propos recueillis par Nicolas Truong, Le Monde, 24.03.2020, URL : https://bit.ly/2SpIQOo).
[10] Voir J.-L. Jeannelle, « Marc Nichanian : le témoignage malgré tout », art. cité, p. 207 : « l’entreprise critique menée ici avec virulence ne favorise en réalité ni le scepticisme ni le révisionnisme (encore moins le négationnisme) ».
[11] C. Coquio, Chap. « La destruction du réel et sa réfutation » (« Phénoménologie du survivant »), Le Mal de vérité ou l’utopie de la mémoire, op. cit.
[12] Chap. « La destruction du réel et sa réfutation » (« Le “mal au réel” et la “perversion historiographique” (Rancière, Ginzburg, Nichanian) »), ibid.
[13] M. Nichanian, La Perversion historiographique, op. cit., p. 149. C’est l’auteur qui souligne.
[14] C. Coquio, Chap. « La destruction du réel et sa réfutation » (« Le “mal au réel”… »), Le Mal de vérité ou l’utopie de la mémoire, op. cit.
[15] M. Nichanian, La Perversion historiographique, op. cit., p. 148, n. 27.
[16] J.-L. Jeannelle, « Marc Nichanian : le témoignage malgré tout », art. cité, p. 207 : l’intérêt de l’entreprise critique de Nichanian est « de mettre en valeur la nature spécifiquement littéraire de tels textes [testimoniaux] ».
[17] Gérard Genette, Fiction et Diction, Paris, Le Seuil, coll. « Points Essais », 2004 [1re éd. : 1991], p. 116-117.
[18] C. Coquio, « La “vérité” du témoin comme schisme littéraire », dans Daniel Dobbels, Dominique Moncond’huy (dir.), Les Camps et la littérature. Une littérature du XXe siècle, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2006, coll. « La Licorne », p. 79.
[19] Ibid., p. 79 et 91.
[20] C. Coquio, La Littérature en suspens. Écritures de la Shoah : le témoignage et les œuvres, Paris, L’Arachnéen, 2015, p. 194.
[21] Ibid., p. 179 et 194.
[22] M. Nichanian, La Perversion historiographique, op. cit., p. 129.
[23] C. Coquio, Introduction (« La vérité divisée »), Le Mal de vérité ou l’utopie de la mémoire, op. cit. Dans « Un Eichmann de papier » (1980), P. Vidal-Naquet affirmait que, quand le temps vient de « la transformation de la mémoire en histoire, […] “la guerre est finie” » (Les Assassins de la mémoire, Paris, La Découverte, 1987, p. 81). C. Coquio s’accorde ici avec White et Nichanian qui considèrent quant à eux que « la guerre n’est jamais finie » (M. Nichanian, La Perversion historiographique, op. cit., p. 115). Pour White, la décision que « la guerre est finie » ne relève pas du pouvoir des historiens mais « émane des centres du pouvoir politique établi et de l’autorité sociale » (« The Politics of Interpretation », art. cité, p. 137).
[24] Quant aux auteurs que je n’ai pas déjà cités : Marc Bloch, « Critique historique et critique du témoignage » (1914), Annales. Économies, sociétés, civilisations, 5e année, n° 1, janvier-mars 1950, p. 1-8, URL : https://bit.ly/3cFxM7J. Michel Borwicz, Écrits des condamnés à mort sous l’occupation nazie (1939-1945), Paris, Gallimard, coll. « Folio histoire », 1996 [1re éd. : 1954]. Georges Perec, « Robert Antelme ou la vérité de la littérature » (1963), L.G. Une aventure des années soixante, Paris, Le Seuil, coll. « La Librairie du xxe siècle », 1992, p. 87-114. Renaud Dulong, Le Témoin oculaire. Les conditions sociales de l’attestation personnelle, Paris, Éd. de l’EHESS, coll. « Recherches d’histoire et de sciences sociales », 1998.
[25] F. Detue, Ch. Lacoste, « Ce que le témoignage fait à la littérature », Europe. Témoigner en littérature, n° 1041-1042, janv.-fév. 2016, p. 3-15, disponible en ligne : https://bit.ly/2JByPue. Une version remaniée de ce texte paraîtra en anglais à l’automne prochain dans Synthesis. An Anglophone Journal of Comparative Literary Studies, n° 13, 2020. Primo Levi disait de Si c’est un homme : « Je voyais ce livre comme un acte judiciaire. J’avais envie de témoigner. » (P. Levi, Œuvres, trad. collective, Paris, R. Laffont, coll. « Bouquins », 2005, p. 992).
[26] M. Nichanian, La Perversion historiographique, op. cit., p. 147.
[27] Giorgio Agamben, Ce qui reste d’Auschwitz. L’archive et le témoin. Homo Sacer III, trad. de l’italien par Pierre Alferi, Paris, Payot & Rivages, coll. « Rivages poche/Petite bibliothèque », 2003 [1re éd. italienne : 1998], p. 178.
[28] C. Coquio, Chap. « La destruction du réel et sa réfutation » (« Phénoménologie du survivant »), Le Mal de vérité ou l’utopie de la mémoire, op. cit.
[29] P. Levi, Si c’est un homme, trad. de l’italien par M. Schruoffeneger [à partir du texte remanié de la rééd. de Se questo è un uomo en 1958], Pocket, coll. « Presses Pocket », 2003, p. 135.
[30] P. Levi, Les Naufragés et les Rescapés, op. cit., p. 82. Levi traduit ici l’argot du camp « Muselmänner » par « mussulmani », mais il n’est pas certain que les anciens du camp qui ont forgé la Lagersprache aient songé aux adeptes de l’Islam. Plusieurs auteurs mentionnent d’ailleurs le fait que Levi émet aussi l’hypothèse d’une contraction de « Muschelmann », qui signifierait « homme-coquille » en référence à l’état de prostration de ces hommes qui ont « touché le fond ». Sur cette question, voir la note d’éditeur de Tal Bruttmann dans le chapitre « Qui étaient les Häftlinge ? » de l’ouvrage Qu’est-ce qu’un déporté ? Histoire et mémoires des déportations de la Seconde guerre mondiale, Paris, CNRS éd., 2009, p. 59, n. 82 ; voir également Claudine Kahan, Philippe Mesnard, Giorgio Agamben à l’épreuve d’Auschwitz. Témoignages / interprétations, Paris, Kimé, 2001, p. 42 sq.
[31] P. Levi, Les Naufragés et les Rescapés, op. cit., p. 82-83.
[32] G. Agamben, Ce qui reste d’Auschwitz, op. cit., p. 164.
[33] C. Ginzburg, « La preuve, la mémoire et l’oubli », texte inédit en français généreusement transmis par l’auteur. Prononcé lors d’une conférence au Colloque international « La négation de la Shoah » (Bruxelles, 8-10 novembre 1998), il a été publié en traduction allemande : « Beweis, Gedächtnis, Vergessen », Werkstattgeschichte, n° 30, 2002, p. 50-60.
[34] J.-F. Lyotard, Le Différend, op. cit., § 1, cité par G. Agamben, Ce qui reste d’Auschwitz, op. cit., p. 37. Lyotard glose dans ce passage la lettre que Faurisson a adressée au Monde le 16 janvier 1979 sous le titre « La rumeur d’Auschwitz (suite) ».
[35] G. Agamben, Ce qui reste d’Auschwitz, op. cit., p. 37-38. Agamben se réfère aux travaux de Shoshana Felman et Dori Laub qui ont mené à la publication de Testimony. Crises of Witnessing in Literature, Psychoanalysis, and History (New York, Routledge, 1992) ; il cite en outre l’article de S. Felman, « In an Era of Testimony. Claude Lanzmann’s Shoah », Yale French Studies, n° 79, 1991, p. 39-81.
[36] Ibid., p. 34.
[37] Ibid., p. 36. C’est à l’aune de « l’intémoignable » que l’on peut parler d’« indicible » à propos d’Auschwitz, nous dit l’auteur : voir ibid., p. 170.
[38] Voir la citation de L’Organisation de la terreur de Wolfgang Sofsky, ibid., p. 46.
[39] T. Bruttmann, « La centralité d’Auschwitz-Birkenau dans les représentations de la Shoah », Les Cahiers Irice, n° 7, 2011/1, p. 98, URL : https://bit.ly/35vHNBW.
[40] G. Agamben, Ce qui reste d’Auschwitz, op. cit., p. 55. On appréciera ici l’effet que produit l’emploi de « musulman » sans guillemets – déjà dans le texte italien original. Au demeurant, même quand il s’efforce, dans le même fragment, de donner une précision historique, Agamben falsifie la réalité. Il parle en effet, avec beaucoup d’ignorance, « [d]es Lager comme Auschwitz, où camp de concentration et camp d’extermination se confondent » (ibid., p. 54). D’une part, dans l’histoire de la criminalité nazie, le camp d’Auschwitz est le seul où ont été mises en œuvre sur un même site géographique les politiques concentrationnaire et génocidaire. D’autre part, ces politiques ne s’y confondent pas du tout : elles se jouxtent – le centre de mise à mort de Birkenau se situant hors du périmètre du camp d’Auschwitz-II. Sur la confusion due à « [l]a centralité d’Auschwitz-Birkenau dans les représentations de la Shoah », voir l’article de T. Bruttmann cité dans la note précédente.
[41] Jean Améry, Par-delà le crime et le châtiment. Essai pour surmonter l’insurmontable, trad. de l’allemand par F. Wuilmart, Arles, Actes Sud, coll. Babel, 2005, p. 50.
[42] Voir G. Agamben, Ce qui reste d’Auschwitz, op. cit., p. 79-82. Ce questionnement chez Heidegger a été justement qualifié de « négationnisme ontologique » par Emmanuel Faye au cours d’une émission de France Culture en août 2005. Si pour Heidegger les victimes juives demeurent « épouvantablement non mortes », c’est en effet que, sans Dasein historique, elles sont sans rapport à l’Être et donc à la mort des héros. L’émission de radio a été transcrite sur une page du blog Le Laborynthe en 2006 : https://bit.ly/3d9yNVE. Voir également François Rastier, « Heidegger aujourd’hui – ou le Mouvement réaffirmé », Labyrinthe, n° 33, 2009/2, URL : https://bit.ly/3d98i2x.
[43] C. Ginzburg, « La preuve, la mémoire et l’oubli », art. inédit cité.
[44] P. Levi, Si c’est un homme, op. cit., p. 137.
[45] G. Agamben, Ce qui reste d’Auschwitz, op. cit., p. 36.
[46] Ibid., p. 171.
[47] Ibid., p. 171-172.
[48] En 1977, son livre Stanze édité chez Einaudi s’ouvrait sur la dédicace « Martin Heidegger in memoriam ». Quant au livre Le Langage et la mort, dont l’original a paru chez le même éditeur en 1982, il est issu d’un « séminaire sur le lieu de la négativité » entièrement construit sur une confrontation entre Hegel et Heidegger. Il est ainsi juste de dire, avec Judith Revel, que « la confrontation permanente avec la pensée heideggérienne fait fonction de matrice » dans cette œuvre (« Lire Foucault à l’ombre de Heidegger », Critique, n° 836-837, 2017/1, p. 54).
[49] Voir G. Agamben, Ce qui reste d’Auschwitz, op. cit., p. 39-41. Dans son ouvrage Witnessness (2010), le comparatiste américain Robert Harvey va plus loin encore en faisant de Samuel Beckett celui qui témoigne mieux que Levi pour le « musulman ». Voir ma critique de cet ouvrage lors de sa parution en traduction française en 2015 : « Le témoin imaginaire », Europe, n° 1044, avril 2016, p. 270-279, disponible en ligne sur Academia.edu : https://bit.ly/2W5Tz2Q.
[50] G. Agamben, Ce qui reste d’Auschwitz, op. cit., p. 179.
[51] C. Ginzburg, « La preuve, la mémoire et l’oubli », art. inédit cité.
[52] G. Agamben, Ce qui reste d’Auschwitz, op. cit., p. 179.
[53] G. Agamben, L’homme sans contenu, trad. de l’italien par Carole Walter, Saulxures, Circé, 1996 [1re éd. italienne : 1970], p. 113. Le premier ouvrage d’Agamben est clairement sous influence heideggérienne, alors que l’auteur a suivi les séminaires de Thor, en Provence, en 1966 et 1968.
[54] Sur le concept paulinien de reste, voir G. Agamben, Ce qui reste d’Auschwitz, op. cit., p. 177-178. Le livre d’Agamben qui suit Ce qui reste d’Auschwitz est consacré à saint Paul : Le temps qui reste. Un commentaire de l’Épître aux Romains, trad. de l’italien par Judith Revel, Paris, Payot et Rivages, coll. « Bibliothèque Rivages », 2000 [1re éd. italienne : 2000]. L’héritage heideggérien y est encore patent.
[55] Bernard Moreau, « La notion d’évangélisation chez saint Paul », Laval théologique et philosophique, vol. 24, n° 2, 1968, p. 264-265, URL : https://bit.ly/2WBynki. L’auteur de l’article s’appuie, dans le Nouveau Testament, sur la Première Épître de Paul aux Corinthiens.
[56] Sur « l’intémoigné », voir G. Agamben, Ce qui reste d’Auschwitz, op. cit., p. 41. Quant à l’emploi du singulier qui esssentialise le « musulman », c’est une constante dans le livre d’Agamben (124 occurrences du singulier, pour 40 occurrences du pluriel).
[57] « Jésus témoigne de Dieu sous Ponce Pilate (1 Tm 6, 13), en se livrant en rançon pour tous (1 Tm 2, 6). » (B. Moreau, « La notion d’évangélisation chez saint Paul », art. cité, p. 264). L’auteur de l’article s’appuie ici, dans le Nouveau Testament, sur la Première Épître de Paul à Timothée.
[58] Voir G. Agamben, Ce qui reste d’Auschwitz, op. cit., p. 178.
[59] Ibid., p. 81.
[60] Ibid., p. 54-55.
[61] Richard Wagner, Le Judaïsme dans la musique, dans Œuvres en prose, t. VII, trad. de l’allemand par J.-G. Prod’homme et F. Caillé, Plan de la Tour, Éd. d’Aujourd’hui, coll. « Les introuvables », 1976, p. 122-123. Le mot d’« Untergang » serait sans doute plus justement traduit par « disparition », ou « engloutissement » ; il ne doit en tout état de cause pas être confondu avec le mot nazi de « Vernichtung » qui désigne l’extermination. Wagner tire cependant une leçon inquiétante de l’exemple d’un Juif qui dut « cesser d’être Juif » (i. e. se déjudaïser) afin de « devenir homme » (i. e. s’assimiler à la nation allemande).
[62] T. W. Adorno, Essai sur Wagner, op. cit., p. 28-29.
[63] La réflexion menée dans ce dernier développement doit pour partie à ma lecture de F. Rastier, Ulysse à Auschwitz. Primo Levi, le survivant, Paris, Le Cerf, coll. « Passages », 2005. Voir notamment les pages 152 à 165 du chap. XII, entièrement consacrées à Ce qui reste d’Auschwitz. Le propos a été repris par l’auteur sous forme de recension disponible en ligne : F. Rastier, « La Rose mystique d’Auschwitz » [recension de Ce qui reste d’Auschwitz], EC. Rivista on-line dell’AISS, 02.05.2012, URL : https://bit.ly/2T2XDyL.
[64] G. Agamben, Ce qui reste d’Auschwitz, op. cit., p. 11.
[65] Ibid., p. 12.
[66] Ibid., p. 18.
[67] Ibid., p. 22.
[68] Ibid., p. 21-22. Agamben cite Eichmann à Jérusalem d’Hannah Arendt.
[69] Ibid., p. 17. Les deux références de page entre parenthèses renvoient à P. Levi, Conversazioni e interviste, Turin, Einaudi, 1997.
[70] P. Levi, Conversations et entretiens : 1963-1987 (« Les mots, le souvenir, l’espoir », par M. Vigevani), dans Œuvres, op. cit., p. 1045.
[71] P. Rassinier, Le Mensonge d’Ulysse, Paris, La Vieille taupe, 1979, p. 247-248.
[72] P. Levi, Conversations et entretiens : 1963-1987 (« Les mots, le souvenir, l’espoir », par M. Vigevani), dans Œuvres, op. cit., p. 1045-1046.
[73] P. Levi, Les Naufragés et les Rescapés, op. cit., p. 53.
[74] Ibid., p. 44 et 49.
[75] Ibid., p. 48.
[76] David Rousset, Les Jours de notre mort [1947], Paris, Hachette Littératures, coll. « Pluriel », 2005, p. 742.
[77] Après avoir énoncé sa « leçon des camps », le personnage de Rousset poursuit : « Qui le croira ? D’autant que les rescapés ne le sauront plus. Ils inventeront, eux aussi, des images d’Épinal. De fades héros en carton pâte. La misère de centaines de milliers de morts servira de tabou à ces estampes. » (ibid.). Le roman s’achève par la proclamation en contrepoint d’« une foi absolue en [le] triomphe [de la vie] » : « Nous n’avons jamais cru au désastre final de l’humanité » (ibid., p. 959).
[78] G. Agamben, Ce qui reste d’Auschwitz, op. cit., p. 20.
[79] Voir G. Agamben, Homo Sacer. Le pouvoir souverain et la vie nue, trad. de l’italien par Marilène Raiola, Paris, Le Seuil, coll. « L’ordre philosophique », 1997.
[80] G. Agamben, « Notes sur le geste » (1992), Moyens sans fins. Notes sur la politique, Paris, Payot & Rivages, coll. « Bibliothèque Rivages », 1995, p. 68.
[81] G. Agamben, Ce qui reste d’Auschwitz, op. cit., p. 23 et 25.
[82] Rithy Panh (avec Christophe Bataille), L’Élimination, Paris, Grasset, 2011, p. 248.
[83] Gitta Sereny, Au fond des ténèbres. Un bourreau parle : Franz Stangl, commandant de Treblinka, trad. de l’anglais par C. Audry, Paris, Tallandier, coll. « Texto. Le goût de l’histoire », 2013, p. 537.
[84] Ibid., p. 234.
[85] Ibid., p. 196.
[86] Ibid., p. 334. Ou encore : « Je n’ai jamais fait de mal à personne volontairement, moi-même » (ibid., p. 537).
[87] Jean Wetz, « Franz Stangl, le “bourreau de Treblinka”, est condamné à la détention à vie », Le Monde, 24.12.1970, URL : https://bit.ly/3cwTg70. De la même façon, Stangl a répété à Gitta Sereny : « je ne suis responsable que vis-à-vis de moi et de mon Dieu. Moi seul, je sais ce que j’ai fait de ma libre volonté. Et de cela je peux répondre devant mon Dieu. » (Au fond des ténèbres, op. cit., p. 334).
[88] G. Sereny, Au fond des ténèbres, op. cit., p. 538.
[89] Cité dans Hannah Arendt, Eichmann à Jérusalem. Rapport sur la banalité du mal, trad. de l’américain par A. Guérin, revue par M.-I. Brudny-de Launay puis par M. Leibovici, dans Les Origines du totalitarisme, suivi d’Eichmann à Jérusalem, Paris, Gallimard, coll. « Quarto », 2002, respectivement p. 1039 et 1253.
[90] R. Panh (avec C. Bataille), L’Élimination, op. cit., p. 27-28. Les mots qui précèdent cette réponse sont les suivants : « Duch veut croire que la rédemption s’achète avec des mots. Il conteste la vérité historique ; puis il affirme endosser toute la responsabilité. Autrement dit : je nie ce que vous affirmez, mais je porterai le fardeau de votre vérité. »
[91] G. Agamben, Ce qui reste d’Auschwitz, op. cit., p. 21. Sur l’ironie à propos du recours au modèle tragique, voir ibid., p. 105-106.
[92] Ibid., respectivement p. 96 et 114-115. Quant au mot de Levi au sujet de Heidegger, voir Les Naufragés et les Rescapés, op. cit., p. 142.
[93] Cité dans G. Agamben, Ce qui reste d’Auschwitz, op. cit., p. 35. Le propos de Levi est extrait d’un entretien. Voir aussi le propos plus précis de Levi sur ce sujet dans Les Naufragés et les Rescapés, op. cit., p. 17 et 40-41.
[94] G. Agamben, Ce qui reste d’Auschwitz, op. cit., p. 66.
[95] Ibid., respectivement p. 43, 45 et 53.
[96] Ibid., p. 146.
[97] Ibid., p. 55.
[98] Ibid., p. 64.