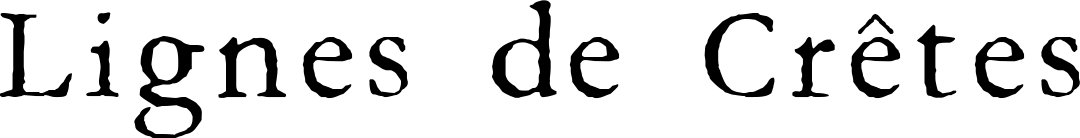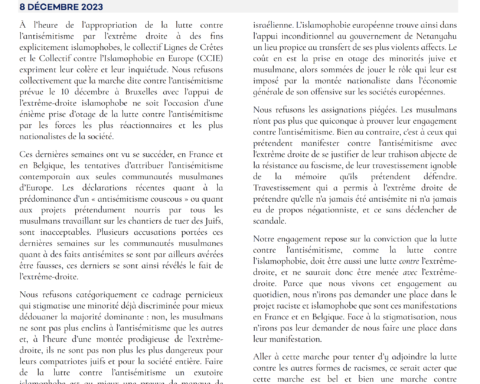A. me dit : “tu es racisée parce que tu es juive, et d’ailleurs tu n’es pas blanche.”
l’injonction actuelle à l’assignation identitaire de « race » pour dénoncer le racisme social ne me convient pas. Je ne parle que pour moi, pas pour lui. Lui étant juif métis descendant d’esclaves avec ses cheveux frisés, crépus qui évoquent l’Afrique, lui dont tous les adultes jeunes ou vieux de ma famille ou d’ailleurs voulaient toucher les cheveux lorsqu’il était enfant et l’embrasser même si lui comme tous les enfants redoutait ce contact imposé, je comprends qu’il se dise racisé et pas blanc. Mais moi ?
Je suis née juste après la guerre, juive je l’étais parce que mes parents l’étaient et tous mes ancêtres aussi, mais toute ma famille était laïque et assimilée depuis longtemps et s’il n’y avait eu la Shoah notre judéité aurait probablement disparu ou presque.
Mais il y eut les années trente, le nazisme, la guerre la déportation et l’extermination des juifs d’Europe et ma famille, mes parents furent eux aussi pris dans la tourmente. Heureusement bien que résistants ils survécurent. Chacun repris sa vie, les uns, mes grands parents restèrent en exil aux Etats Unis où ils s’étaient réfugiés dès 1941, mes parents se séparèrent après ma naissance et je fus élevée comme tous les enfants de ma génération juifs ou non, enfants de résistants, de collabos, ou simplement de bons français qui s’étaient contentés de subir l’occupation sans réagir outre mesure, nous, ceux que l’on appela les baby boomers, dans une chape de silence, de déni et de culpabilité qu’il nous fallut briser vingt ans plus tard en mai 68.
A la maternelle dans les années 50 les enfants me demandèrent : tu es catholique ou protestante ? Ne comprenant pas la question je demandai à ma mère. « Tu leur diras que tu es israélite », sans plus d’explication. D’accord ! Cela n’avait aucun sens pour moi sinon que je voyais mes petites camarades aller plus tard au « catéchisme » s’échanger quelques images de la Vierge Marie ou autres saints et faire quelques « retraites » avant la communion. Dans ma classe en primaire en plein Paris bourgeois du VIIe arrondissement, l’immense majorité des filles (l’école n’était pas mixte) se disaient catholiques et, comme nous étions encore au temps d’avant le Concile Vatican II, certaines, sortant du cours de « caté » me disaient innocemment : « tu as tué Jésus ! ». Peut-être pas si innocemment quand j’y pense. Je ne comprenais rien, pourquoi aurais-je tué ce Jésus qui apparemment était un saint homme si bon, si beau, si malheureux ?
A. me dit : « tu vois bien qu’elles étaient antisémites. »
Je lui réponds, « elles étaient judéophobes » ; mais je me rends compte que ma réponse fait partie du déni de ce temps là. Il n’y avait plus d’israélites, mais des juifs; il n’y avait plus de judéophobie mais des antisémites. Nous n’étions plus avant guerre mais après, et pourtant malgré la catastrophe le discours antisémite refoulé surgissait parfois dans ce lourd silence gêné.
Mon père, totalement athée profondément meurtri par l’antisémitisme d’avant guerre, le vichysme le nationalisme fasciste et la collaboration, s’était engagé dans la Résistance pour sauver la démocratie, l’Europe et la France de la destruction totale, plus que par judéité, disait-il et même s’il admettait cette composante de lui même de son appartenance familiale, il préférait proclamer son attachement à la France qui l’avait cependant rejeté. Ma mère ne parlait d’antisémitisme qu’à mots couverts ou par allusion et ne connaissait rien à la religion juive, même si elle assistait parfois à quelques cérémonies du Kippour chez ses amis pour être de la fête sans plus.
Cependant pour nous, elle redoutait toujours le danger de l’exclusion, de la mise à l’écart de la stigmatisation: elle voulait que nous soyons jolies, policées, bien habillées, que nous n’ayons ni les pieds plats ni un trop grand nez ni les oreilles décollées ni l’air trop angoissées ou névrosées, stigmates antisémites du juif d’avant guerre. Je n’ai compris que bien plus tard cette obsession de ma mère et sa terreur que nous puissions avoir « l’air juif ». Mes frères qui avaient connu la guerre la fuite en Suisse très dangereuse et l’exil étant enfants professaient un athéisme et une haine des religions radicales et tremblaient et n’évoquaient jamais leur judéité.
Suis-je racisée ? Ce qualificatif me dérange car pour moi il me ramènerait à une position de victime, que j’ai toujours refusée de toutes mes forces, en tant que femme plus encore peut-être. Je suis privilégiée c’est vrai et cela est certainement plus facile pour moi d’adopter cette posture mais, aussi bien dans mon éducation familiale qui incitait à ne jamais se plaindre, que politique plus tard dans les années 70, le mot d’ordre de lutte contre les injustices interdisait de mettre en avant sa propre subjectivité. Les femmes se sont organisées pour combattre le sexisme virulent dans les organisations militantes comme partout ailleurs dans la société et ont fondé le MLF, sans se poser en victimes elles mêmes personnellement sinon dans la sphère privée.
Mais les temps ont changé et le regard de nos sociétés sur les oppressions individuelles et la subjectivité de ceux qui les subissent, leur histoire propre et leurs souffrances, s’est transformé au cours des dernières décennies. En outre dans les années 70 les études postcoloniales et les réflexions sur les effets de la colonisation de la décolonisation et sur l’empreinte individuelle subjective ou collective du racisme n’avaient pas encore été élaborés comme ils le furent plus tard et jusqu’à aujourd’hui. Nous étions encore dans un cadre de lutte anticoloniale antiraciste et universaliste occidental qui fut depuis largement déconstruit et critiqué.
Suis je racisée pour autant ou bien ce concept reste-t-il trop éloigné de ma subjectivité ?
Les juifs ne sont pas une race ni les sémites qui n’existent pas ni les aryens même si les théoriciens de la race au XIXe et au XXe ont déliré gravement puis criminellement sur ces fictions. Les juifs se sont fondus dans les populations ou les ethnies parmi lesquelles ils vivaient au cours des siècles et d’ailleurs un des fondements essentiels de l’antisémitisme social et politique venait du fait qu’ils disparaissaient dans une population qu’il devenait difficile voire impossible de les reconnaître et comme le disaient Drumont et les autres antisémites, ils se disséminaient comme un virus et ils « étaient partout ».
Et pourtant la matrice du racisme est l’antisémitisme : l’exclusion d’un groupe social, sa discrimination, sa persécution voire son extermination génocidaire. Alors comment affirmer qu’étant juive même dans une société démocratique au XXIe siècle, où le racisme n’a décidément pas disparu, je ne me sentes pas racisée, c’est à dire, si je comprends, vue par certains comme faisant partie d’une race, quel que soit le fantasme ?
Ce qui est difficile et pour nous tous reste la question identitaire, l’objectivation du regard haineux de l’autre sous la forme de cette détermination reste douloureuse et négative, excluante. A moins qu’elle ne signifie implicitement le refus, la révolte, la solidarité antiraciste, antidiscriminatoire, antisexiste, en ce cas cela devient possible de l’assumer.
A. me dit : tu n’es pas blanche.
Faut-il se déterminer en fonction de la couleur de sa peau ?
Oui disent les militants postcoloniaux, les antiracistes intersectionnels et nombre de sociologues engagés. Ceux et celles de ma génération qui avons combattu, comme nous le pouvions, le colonialisme et la domination impérialiste comme nous le disions dans nos critères d’avant la chute du mur, sommes nous de vieux réactionnaires, des pauvres OK boomers s’il nous est difficile de définir notre identité ainsi ? Et pourtant en tant que femmes il était évident que nous devions nous organiser dans des réunions ou des groupes non mixtes. Alors je l’admets et l’accepte volontiers mais pour moi qui suis blanche avec les privilèges de cette « blanchité » puis-je sous prétexte d’antisémitisme me dire « non blanche » ? Cela devient vraiment de plus en plus difficile.
Est ce qu’il veut me dire d’être lucide sur l’échec de la promesse révolutionnaire, de l’assimilation universaliste des juifs au XIXe siècle avec l’essor des mouvements et des ligues antisémites, puis l’affaire Dreyfus, et enfin la collaboration vichyste, la perte de la citoyenneté et de tous droits civiques et humains ?
Pour les racistes, c’est vrai, les juifs avaient une sale couleur et une sale tête, leur blanchité ne leur accordait à l’époque aucun privilège. Mais maintenant, porterons nous encore ces stigmates, et pour tous ceux qui sous prétexte d’antisionisme considèrent tous les juifs comme des blancs privilégiés et arrogants, leur dire qu’ils se trompent : non nous ne sommes pas blancs, est ce la bonne réponse ?
Voilà pourquoi je reste perplexe et troublée devant ces affirmations de A., et il a peut-être raison qui sait ?