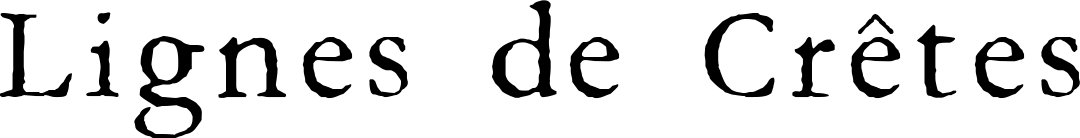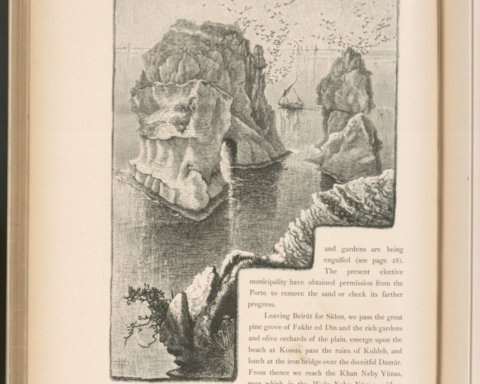Le chef d’un État arabe et socialiste – probablement Saddam Hussein – se rend dans un village pauvre de son pays. Il en réunit les habitants et demande, du ton compatissant du père de la nation, qu’ils lui présentent leurs doléances. Nul n’ose prendre la parole sauf Hassan, qui crie le coût du pain et la sécheresse de la terre, la matraque du gendarme et la corruption des potentats féodaux. Ému, le chef d’État écrase une larme et remercie celui qui parmi ses enfants a eu le courage de la vérité.
Un an plus tard, le chef d’État retourne au village. La scène est rejouée mais personne ne répond plus à la question paternelle. Tout juste entend-on l’un dire d’une voix faible et mal assurée : « tout va bien dans le meilleur des mondes, mais où est mon ami Hassan ?¹ ».
***
Sherine Abu Akl est morte assassinée – probablement ciblée par un sniper de l’armée israélienne. Elle était l’une des plus fameuses journalistes palestiniennes et arabes : sa voix – et sa célèbre signature : Sherine Abu Akl, al-Jazeera, Ramallah – avait accompagné des générations de locuteurs arabophones. Jeune reporter durant la seconde intifada, elle n’avait eu de cesse lors des vingt années suivantes de documenter la colonisation de la Cisjordanie.
***
On rappellera, à raison, que Sherine Abu Akl n’est guère la première journaliste arabe que l’on assassine – tant s’en faut. En Syrie, Bachar al-Assad revendique l’élimination physique des intellectuels (Bassel Shahada, Khaled al-Issa, Razan Zaïtouneh, Samira al-Khalil² etc.) comme politique opposée à la révolution qui a saisi le pays ; au Liban, son allié le Hezbollah a probablement commandité le meurtre de Lokman Slim ; à Istanbul, les services saoudiens ont fait disparaître Jamal Khashoggi dans les circonstances que l’on connait. Au-delà du monde arabe, Hrank Dink – conscience arménienne de la Turquie – fut abattu à bout portant, peu de temps après qu’Anna Politkovskaya paya de sa vie la révélation des crimes de l’État russe en Tchétchénie et ailleurs.
À la litanie de l’effacement, on répondra – de nouveau à raison – que les intellectuels et les journalistes n’ont guère le privilège de l’assassinat : d’autres meurent, bien plus nombreux, sans que leur mort soit moins scandaleuse que celle des noms que l’on égrène.
***
Il faut pourtant tenter de dénouer l’énigme d’une émotion collective. On pleure Sherine Abu Akl, comme l’on a pleuré chacun des noms qui l’ont précédée. Pour une part, ceux-ci étaient nés des révolutions arabes : leur disparition redoublait la défaite radicale d’un élan collectif historique³.
Sherine Abu Akl était cependant palestinienne, c’est-à-dire issue d’une société qui ne fut que peu saisie par l’expérience politique de 2011 : les révolutions arabes mettaient à bas l’illusion d’une émancipation par le nationalisme anticolonial, ce qui n’était guère raisonnablement envisageable là où l’occupation persistait. Peut-être est-ce précisément cela que l’on pleure avec Sherine Abu Akl : l’implacable fermeture de l’horizon par quelque angle depuis lequel on le scrute. Au-delà des situations historiques singulières – il importe finalement peu que l’on soit colonisé ou postcolonisé –, l’impasse demeure.
***
Il y a peut-être un autre sens à l’émotion. Si les intellectuels ont pour rôle de porter la parole du collectif, leur mort en indique la non-contemporanéité : ainsi leur expression ne parvient-elle plus à faire signe vers une expérience partagée. Sherine Abu Akl n’était pourtant pas de ces « islamistes » que l’on exclut de la trame contemporaine d’un revers de main. Journaliste vedette d’une chaîne de télévision à diffusion globale, chrétienne et détentrice de la nationalité américaine, la liste de ses titres – hérités ou acquis, qu’importe – aurait dû suffire, si ce n’est à ouvrir la possibilité d’une réception, tout du moins à lui garantir la vie sauve.
Mais l’assassinat de Sherine Abu Akl a bel et bien eu lieu. Aussi ceux qui la pleurent comprennent-ils la singulière actualité de sa mort : par-delà l’effacement, leur parole n’est désormais plus affectée de la moindre signification pour le « concert des nations » auquel ils savent ne pas appartenir. La fin de la modernité arabe est ainsi celle de son accueil4, si bien que la rupture d’intelligibilité entraîne la mort probable de ceux et celles qui avaient été chargés de transmettre le message.
Avec qui pleure, il nous reste à demander d’une voix faible et mal assurée où sont nos amis disparus.
***
¹ Cette histoire est narrée par l’Iraqien Ahmad Matar dans son poème « où est mon ami Hassan ? ».
² Razan Zaïtouneh et Samira al-Khalil, lourdement menacées par le régime syrien, ont probablement été enlevées par l’État islamique.
³ Au Maroc, en Algérie, en Tunisie ou en Égypte, le néonationalisme a depuis lors été (re)constitué comme forme exclusive de la vie collective ; au Yémen et en Lybie, une guerre confuse finit de désagréger les appartenances ; en Syrie, la réponse du régime de Bachar al-Assad a été de rare honnêteté : « al-Assad ou nous brûlons le pays », continuent de chanter les miliciens loyalistes.
4 L’impossibilité de l’accueil s’atteste également parmi ceux et celles qui, projetant sur le monde arabe la variété de leurs luttes nationales, s’en affirment les défenseurs au sein de l’ordre des parlants.
[L’illustration utilisée pour cet article est un dessin de l’artiste irakien Dia al-Azzawi, dont on peut retrouver les travaux ici]