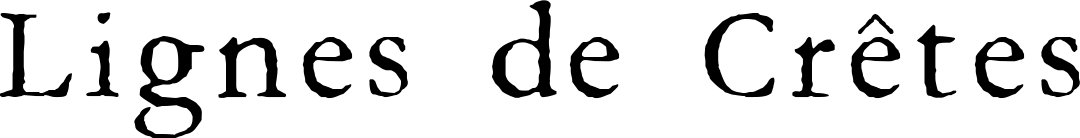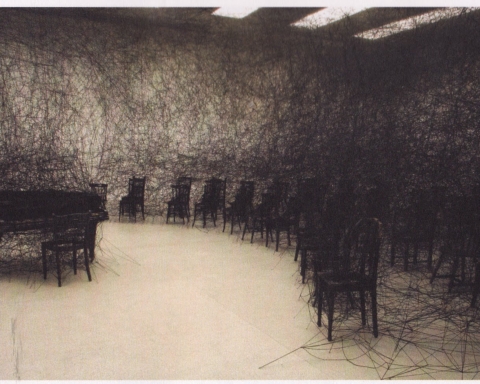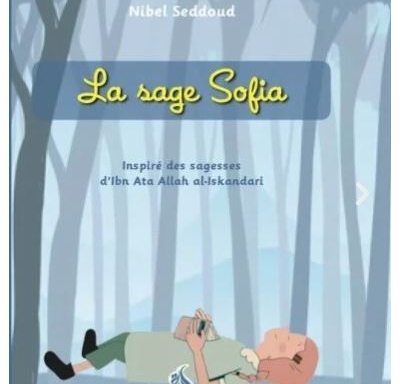J’ai rédigé ce long récit début juillet 2020. Puis alors que le déni s’installait sur la poursuite de la pandémie, il m’a semblé inutile, redondant, paranoïaque, exagéré. Peut-être l’est-il, le témoignage subjectif sur cette pandémie ne pourra être validé que bien plus tard, lorsque les historiens feront leur travail. En attendant, alors que ce qui est appelé “deuxième vague” est enfin reconnu par les autorités et une grande partie de la population, sans que cela change quoi que ce soit à une politique sanitaire désastreuse, ce retour dans le futur proche de l’école publique sera là comme trace parmi des milliers d’autres.
Merci à toutEs les collègues, et à toutEs les élèves pour le courage, la solidarité, l’espoir .
________________________
Je vais commencer par la fin. Je suis AESH, accompagnante d’élèves en situation de handicap et si j’ai décidé que, finalement, raconter cette période avait un intérêt, c’est parce qu’elle s’est terminée de manière tristement prévisible.
Un matin de la dernière semaine avant les vacances d’été, nous avons appris qu’un élève de ma classe avait été testé positif. L’élève avait juste des nausées et il était donc absent depuis quelques jours.
Ce matin là, finalement l’école a quand même ouvert. Des parents et des enfants attendaient devant la porte, et nous n’avions aucune consigne. En attendant, les élèves sont donc montés dans la classe comme à l’accoutumée. Puis une personne de la médecine scolaire est arrivée et s’est entretenue très longtemps avec l’enseignante. Un interrogatoire avec tableaux Excel, plus qu’un entretien.
A 11h05, il fallait prendre une décision, car une partie des enfants ne mangeait pas à la cantine, et la journée d’école était terminée. Le mercredi, certains vont chez leurs grand-parents, d’autres participent à des activités collectives. Après une année chaotique et traumatisante, les enfants ont donc appris en quelques minutes que le Virus, ce monstre qui avait interrompu le cours normal de la vie des adultes était entré dans leur classe. Les larmes, les peurs, le choc ont du se gérer en moins d’une demi-heure. Pendant ce temps, l’ARS et le rectorat décidaient que les enseignantEs, les salariéEs n’étaient pas des cas contact, pas de test, pas d’arrêt maladie, pas de soutien. L’école restait ouverte, sans vérifications , seule la classe concernée fermait.
Cette situation absurde marqua donc la fin d’une période terrible, . Elle a commencé au retour des vacances de février.
Enfin, en réalité un tout petit peu avant. Dans les médias, après les vacances de Noël, la pandémie a commencé à devenir un sujet, mais cela ne s’appelait pas comme cela, c’était le virus « chinois ».
A l’école, où des élèves d’origine asiatique sont présents, la première chose que nous avons eu à gérer, ce sont les conséquences du prétendu humour des adultes. C’est à dire surveiller les « blagues » sur la nourriture chinoise, ou les surnoms racistes attribués aux copains.
Quelques jours avant les vacances d’hiver, qui commencent le 8 février en région parisienne, nous avons eu une première consigne du Ministère. Il fallait sans alarmer quiconque, ni élèves, ni parents, rappeler les règles du lavage des mains au moyen d’une affichette qui devait également être glissée dans le cahier de liaison des enfants. On nous a bien précisé qu’il ne fallait pas parler du virus qui sévissait en Chine, mais des virus en général. Comme beaucoup de consignes du Ministère, c’était un peu ridicule, car les élèves savaient bien qu’on ne fait pas ce rappel d’habitude, et également qu’une épidémie était en cours en Chine.
C’est d’ailleurs très étrange de confronter ses souvenirs avec la chronologie de la pandémie. A la veille des vacances , donc aux environs du 8 février, Wuhan est confiné totalement. Le 24 janvier, un premier cas a été signalé en France. Le 30, l’OMS a qualifié l’épidémie d’urgence de santé mondiale. On savait déjà que la contagion était possible même quand une personne positive n’avait pas de symptômes et était en période d’incubation. Pour ma part, j’avais vu les vidéos des dissidents chinois de Wuhan, terrorisés, qui, en héros , ont alerté le monde entier.
Pourtant, cette affichette et l’atelier qui suit ne me laissent aucun souvenir d’inquiétude particulière. Tout bêtement, personne à la télé ou chez les politiques ne semblait inquiet et les réseaux sociaux si alarmistes s’alarmaient d’autre chose.
Quinze jours plus tard, le 24 février, à la rentrée, l’ambiance avait un peu changé. La pandémie était arrivée en Europe, à ce moment là, elle commençait à sévir en Lombardie.
Le premier mort français, un enseignant est décédé le 25 février. Dans l’Oise, où de nombreux travailleurs parisiens vivent. Le virus devenait donc un horizon brusquement plus proche.
Les enfants pour certains, avaient du gel hydroalcoolique. Il y en avait même à la fraise. Mais la pénurie a démarré très rapidement, et les petites bouteilles sont devenues précieuses, délimitant, déjà, une petite barrière sociale, ceux qui avaient été prévoyants, ceux qui regardaient les rayons vides des pharmacies et des supermarchés avec inquiétude.
La première rupture officielle du quotidien scolaire est arrivée le mardi. Ce jour là, nous avons su que les élèves faisant état de vacances en Italie ou dans les pays d’Asie du Sud devaient être renvoyés chez eux pour quatorze jours.
Mais ceci ne devait pas passer par une lettre aux parents seulement par une affiche sur le tableau extérieur de l’école. Dans mon école, deux familles ont été concernées, c’est à dire qu’elles se sont manifestées. Mais déjà, cette mesure, dans sa formulation a inquiété la communauté éducative. Demander à des élèves de manquer l’école quatorze jours, c’est le signe d’un problème grave et d’un danger important et imminent. Mais dans ce cas, pourquoi se contentait-on d’une affiche, alors que tous les parents ne les lisent pas quotidiennement, que certains ne sont pas francophones, que les élèves les plus grands rentrent chez eux seuls ? Pourquoi avoir attendu le mardi pour que cette circulaire parvienne dans certains établissements, ce qui a eu pour conséquence le retour de certains élèves pour 24 heures ?
Nous n’avons pas eu beaucoup de temps pour y penser car le 29 février, la France est passée en «stade 2 ». C’était le vocabulaire de ce moment là, le gouvernement venait de reconnaître que l’épidémie circulait en France, et dans l’Oise les premières mesures d’isolement avaient été prises dans le premier « cluster » appelé ainsi. Mais dans notre école, cela s’est traduit par une décision paradoxale. On nous a dit que les élèves de retour de zones à risques n’avaient pas besoin de finir leur quatorzaine .
Sur le terrain, commençait donc la grande valse absurde des décisions contradictoires et inexplicables qui allait marquer les semaines jusqu’à la décision de la fermeture des écoles. Pourquoi interrompait-on une quatorzaine considérée urgente quelques jours auparavant, que changeait le fait qu’il y ait désormais plus de cas, ce qui aurait du nous inciter à une plus grande prudence ? Nous n’en savions rien.
Ma mémoire sur cette période est très brouillée, un brouillard d’angoisse semi-silencieuse, qui monte peu à peu. Dans les écoles, notre mémoire collective a commencé à se réveiller.
Que fait-on en cas d’épidémie ? D’abord on ferme les écoles.
Autant le dire de suite, évidemment, ni mes collègues, ni moi ne sommes des scientifiques mais notre ressenti ne pouvait être que celui-là.
La vie quotidienne à l’école est celle de la contagion de tout et n’importe quoi. Les poux, les rhumes. Se moucher fait partie des activités les plus répétées des élèves pendant la journée, et nos mois d’hiver sont rythmés par les dominos des absences . Si A est malade, deux jours après c’est B son pote de toujours et trois jours après évidemment, c’est C, qui est non loin de A en classe. Et bien souvent nous ensuite. Certaines semaines, la journée est rythmée par la gastro et les aller- retour aux toilettes en catastrophe. La tension a donc commencé à monter au fil des informations qui s’enchaînaient , et de notre hiérarchie qui faisait comme si de rien n’était.
Nous n’étions pas scientifiques, mais nous trouvions tout de même que ce serait une chance assez incroyable qu’un virus contre lequel la Chine se confinait, et l’Italie également, soit justement celui qui ne se diffusait pas chez les enfants.
Alors pourquoi n’avons nous rien fait, collectivement, si nous étions si malins ? Pourquoi sommes nous allés au travail chaque matin, si nous avions si peur ? D’autant que nous étions en grève, quelques semaines auparavant. Une grève pour les retraites, où le principal argument du gouvernement avait été celui de l’espérance de vie qui augmentait. Sur ce point, la Covid 19 allait apporter un contre-argumentaire frappant concernant les risques au travail après 60 ans, notamment.
Mais à ce moment là,nous étions comme tout le monde. En France, tout le monde se sent totalement lucide et indépendant du discours des dirigeants élus, mais en réalité, cette crise, à ses débuts, a montré que nous étions massivement sur la même attitude qu’eux.
Nous avons pensé que la Chine c’était loin, que ça ne pouvait pas arriver ici, que ce serait forcément moins grave, que jamais les rues de nos villes ne pourraient ressembler à celles de Wuhan sous le confinement.
Puis, lorsque l’Italie a été frappée, malgré la peur qui montait, nous avons été dans le déni, pris dans nos vies quotidiennes et nous persuadant que « si c’était si grave que ça, tout de même , nous serions déjà confinés ».
La différence entre le gouvernement et nous, c’est qu’eux avaient plus d’informations et que leur déni ne peut être justifié.
Surtout, ne peut se justifier la manière dont nous, salariés du service public, de cette fameuse école de la République avons été rabaissés et maltraités dès avant le confinement. Les deux dernières semaines ont été terribles pour mes collègues enseignantEs. En effet, les parents qui étaient abonnés au Twitter de Jean-Michel Blanquer avaient bien plus de nouvelles que le salarié qui se serait contenté de lire l’ensemble des directives des hiérarchies du Ministère et du rectorat. Nous, les AESH avons eu zéro communication avant le confinement, à part sur le lavage des mains. Mais même au niveau des directions d’établissement, à presque aucun moment, l’information à leur égard n’a précédé celle faite aux médias.
Par conséquent, l’école est devenue ce lieu où les parents ne trouvaient aucune réponse sur l’avenir proche de leurs enfants et aussi sur leur présent, face à une épidémie qui devenait menaçante.
Quant à nous , nous devions vivre avec la peur qui montait. Une école en Ile de France est un lieu de croisements : en général, même dans une structure de taille moyenne, les salariés habitent des départements différents et prennent presque tous les transports en commun. Les enfants viennent certes tous du même quartier mais leurs parents sont dans la même situation de mobilité incessante que nous. A cette époque, nous ne savions rien à part que le virus était très contagieux. Nous vivions donc avec cette déduction très simple: si un seul élève était contaminé, il pouvait contaminer des gens, qui le surlendemain iraient partout en Ile de France. Et ainsi de suite.
Dans mon école, la seule consolation était ironique. Nous au moins, nous avions des sanitaires en bon état et du savon. Cela n’était pas si commun que ça. Voilà où nous en étions, après des années de manque de moyens. Avoir du savon et des sanitaires juste corrects était un privilège.
A aucun moment, avant le confinement, nous n’avons eu de consigne particulière pour les enfants souffrant de pathologies particulières, notamment ceux en situation de handicap.
A aucun moment, alors qu’il était déjà clair que le virus était de plus en plus dangereux selon l’âge des personnes, il n’y a eu de prise en compte des salariés seniors.
Et puis, après avoir annoncé solennellement que les écoles ne fermeraient pas, le pouvoir a changé d’avis. Et Emmanuel Macron a décidé de fermer le vendredi 13 mars au soir. Les parents l’ont appris le jeudi 12 mars au soir. Nous aussi. Et le lendemain matin, dans les écoles, nous n’avions pas grand chose à dire de plus que Twitter.
Ce matin là a été très triste et la journée aussi. Dans la précipitation, les enseignants ont du décider ce que les élèves emportaient chez eux, en une seule fois, puisque nous n’avions rien pu préparer avant, puisque le message était que rien ne devait laisser penser que nous allions fermer. Dans la précipitation, il a fallu dire que tout allait continuer par internet. Ou autrement, on verrait bien…
Evidemment, pour les élèves que nous suivons, en tant qu’AESH, dans bien des cas, nous savions que nos élèves ne pourraient pas travailler seuls. Mais les enseignants le savaient aussi et pas seulement concernant les élèves en situation de handicap.
De toute façon, certains élèves ne revenaient plus depuis quelques jours, la peur avait gagné et beaucoup d’autres ne sont pas revenus ce vendredi là ou sont partis à onze heures trente.
La sensation globale était celle du sauve qui peut, dans la société, et dans l’école. Les élèves le sentaient et ont réagi chacun à leur manière, mais ils ont parfaitement compris que nous ne contrôlions rien, en tout cas.
Et puis tout s’est arrêté. Sauf l’hôpital mais aussi l’école. Ou plutôt une version de l’école où les enseignantEs ont du se débrouiller, avec leur matériel informatique, pour réinventer quelque chose.
Je n’ai pas grand chose à dire sur cette période. L’un de mes élèves n’avait aucune difficulté d’ordre scolaire strict et a pu travailler avec sa famille sur ce qui était proposé par l’enseignante. Le second n’avait pas de matériel informatique, était en très grande difficulté sociale et a disparu des radars pendant deux mois.
Je me souviendrai cependant toute ma vie des mails quotidiens que mon enseignante me mettait en copie. Aujourd’hui, il est de bon ton de réduire le confinement…au confinement. De passer sous silence, la réalité de cette période : non, ce n’était pas seulement être enfermé chez soi ou aller travailler dans une métropole fantôme, c’était un événement historique d’une brutalité immense, c’était la rupture totale de la vie quotidienne, et forcément le sentiment de l’incertitude absolue et du danger imminent sur nos vies. C’était la séparation avec les siens, c’était le décompte quotidien des morts, c’était le son des sirènes d’ambulance chaque soir, c’était les applaudissements en larmes parce qu’un médecin du quartier était décédé.
Et donc ce furent aussi, toutes ces enseignantes qui se levaient chaque matin, et maintenaient un lien, ou essayaient. Alors qu’au fond, personne ne savait quand cela se terminerait.
Ce fut aussi un moment où il y eut plus de volontaires que de besoins pour assurer l’ouverture des écoles aux enfants des soignantEs , en tout cas, dans un des épicentres de l’épidémie, l’Ile de France. Volontaires sans masques et sans protocole. Qui ont disparu du discours politique ensuite au profit de la stigmatisation des décrocheurs.
Ce fut aussi un moment, où les salariés précaires de l’école ont dû tenir bon dans des conditions souvent épouvantables. Malgré le maintien du salaire, les AESH en région parisienne ont souvent vécu l’enfermement dans des logements extrêmement petits, et avec des enfants car beaucoup sont des mères isolées.
Et puis il y eut le soir du discours de Macron sur le déconfinement et la réouverture des écoles. Un salarié du privé reçoit un message de son patron pour lui dire de revenir travailler. Nous, nous l’avons appris à la télévision.
De manière très significative, dès le lendemain, nous avons été confrontés à une offensive psychologique et politique impressionnante. Nous et les parents devenions un problème parce que nous avions peur, nous étions des gens irrationnels, parce que cette date du 11 mai nous semblait hallucinante, jetée comme cela, à la télévision, alors que même les directions d’établissement n’en savaient rien avant.
En 24 heures, le virus n’était plus si contagieux que ça, en France uniquement. Ailleurs en Europe, des pays avaient déjà décidé de ne pas rouvrir avant septembre. Les études scientifiques sur la contagiosité des enfants et le danger qu’ils couraient étaient incertaines et elles le sont toujours. Mais le principe de précaution tant invoqué dans d’autres cas, devenait une billevesée absolument condamnable.
En attendant le 11 mai, les semaines se succédaient sans que les directions d’établissement puissent fournir la moindre information sur la «rentrée » aux enseignantEs et aux personnels. De nouveau, nous devions nous abonner à Twitter, pour y lire les déclarations vagues, contradictoires, irréalistes du Ministre. Et les commentaires négatifs de tous les gens qui le croyaient.
Peu à peu, les termes piégés du débat se sont mis en place. D’abord, il y a eu la sémantique du « sauvetage des élèves décrocheurs ». Après des années de coupe dans les budgets de tous les dispositifs destinés aux élèves en difficulté, alors que dans les rectorats, on continuait à programmer des fermetures de classe, et donc des classes surchargées, on osait nous dire qu’un mois et demi d’école en pleine pandémie était absolument vital pour remettre le pied à l’étrier d’élèves que le Ministre lui-même stigmatisait avec un terme péjoratif.
Quant aux élèves en situation de handicap, le mensonge était encore plus pathétique. L’année avait été marquée par la mise en place des PIAL pour les AESH. Concrètement, une réduction générale du nombre d’heures d’accompagnement alloué à chaque élève, et des salariés contraints de passer quelques heures de classe en classe, évidemment sans pouvoir vraiment aider ou construire quoi que ce soit. Beaucoup d’élèves d’ailleurs n’ont même pas d’AESH, faute de salariés disponibles pour un travail dur et très mal payé.
Il y a donc eu une cruauté particulière à annoncer une particulière attention à leur égard. Cruauté pour les parents qui savaient que leur enfant, déjà malheureux en temps normal parce que mal ou pas accompagné ne pouvait évidemment pas revenir dans des conditions encore plus dégradées. Cruauté pour les familles d’autres élèves, aussi, ces enfants dont le handicap se traduit par une fragilité de santé, qui de toute façon devaient rester chez eux, ces milliers de gosses qui sont encore aujourd’hui privés d’école jusqu’à on ne sait quand et qui ont immédiatement cessé d’exister dans la parole publique.
Peu avant le 11 mai, a suivi la farce tragique du protocole de 64 pages. Farce tragique parce qu’il mettait en lumière l’équation impossible du retour à l’école pour tous. Farce tragique parce qu’il décrivait une réalité alternative et terrifiante où l’école serait devenue une caserne absurde, où nous et les élèves aurions passé nos journées à nous laver les mains et à prendre notre température, une école où tout aurait été banni de ce qui fait l’école, c’est à dire le lien social.
Farce tragique parce que la fameuse opinion publique s’est emparée avec délices du sujet, et que nous sommes devenus en trois jours, aux yeux des opposants au gouvernement, des agents de la Gestapo et des tortureurs d’enfants en puissance. Parce que nous avons du rendre des comptes aux amis, aux connaissances, aux camarades si nous étions militants, à la famille, qui, brusquement nous parlait comme si le 11 mai, nous allions devenir des gardiens de prison .
Nous pendant ce temps là, nous attendions les masques qui, dans certaines écoles, ne sont arrivés que le 11 mai après-midi. Nous pendant ce temps là, nous recevions des rouleaux de scotch qui ne collaient pas pour faire des marquages absurdes qui se sont usés en dix jours. Nous pendant ce temps là on tentait des arrangements de tables, nous pendant ce temps là , on mettait des sacs poubelle sur tout ce qui fait une classe. Nous, pendant ce temps là, on flippait de tomber malades dès le douze pour que dalle.
Alors, à vrai dire, nous avons été contentes, en tout cas dans mon école, de retrouver l’école. De nous retrouver entre nous, c’est à dire, enfin, sans cet affreux regard que la société, notre Ministre , et tout le monde portait sur nous. Contentes d’avoir l’air connes ensemble avec nos masques, contentes de revoir les élèves, les rares qui sont revenus les premières semaines.
Et l’école fut quand même, un peu, pour toutes celles et ceux qui étaient là, un bel endroit. Il faut dire cela, malgré Blanquer, partout des collectifs de travail ont fonctionné et inventé et fait face. A tout, les contaminations, l’angoisse des parents, des élèves, des collègues. Aux changements de protocole toutes les deux semaines, aux vendredis où il fallait bouleverser l’organisation des groupes pour le lundi, aux parents qui ne voulaient pas remettre leur enfant à l’école mais se pensaient obligés, à ceux qui voulaient les remettre mais ne pouvaient pas car ils ne faisaient pas partie des « publics » décrétés prioritaires par un Ministre qui changeait les critères en passant d’Europe 1 sur RTL.
Le plus important, et dont on parle finalement peu , a été quelque chose d’inédit dans la période contemporaine. Nous avons dû écouter, expliquer, rassurer, des enfants qui avaient été confrontés à un événement historique qui avait pris de court les adultes.
Comme à l’accoutumée le Ministère avait produit des fiches sur ce sujet, lesquelles sont destinées essentiellement à la communication au public et surtout aux journalistes, mais sont totalement inutiles dans le concret. Il n’y a pas de vademecum qui vaille pour traiter le sujet d’une pandémie mortelle avec des enfants qui y sont confrontés, il n’y a que l’expérience et l’improvisation, l’empathie et la rationalisation des peurs. L’organisation d’une « séance » sur l’épidémie et le confinement, avec en sus sa petite dimension raciste ( repérer les signes de « radicalisation » , non mais sérieusement ? ) , c’est très joli et rassurant sur le papier.
Sauf que les enfants ne fonctionnent pas de cette manière, et que la « séance dédiée » n’est évidemment pas le moment où ceux qui vivent mal tout cela vont docilement lever le doigt pour dire « alors moi je suis complètement terrifié ». C’est tout au long de ces semaines de « rentrée » sous le Covid 19 que nous avons dû faire face aux questions impromptues, aux brusques manifestations d’angoisse à propos de tout autre chose. A une élève qui en plein milieu d’un cours de grammaire lève le doigt pour demander si un jour elle redeviendra une bonne élève ou si c’est fichu puisqu’elle a manqué deux mois et ne rattrapera jamais le programme. A un élève qui, à chaque occasion redemande ce qu’est la maladie de Kawasaki. A une autre qui a peur que l’amie dont elle n’a pas de nouvelles, parce qu’elle n’est pas revenue à l’école, soit tout simplement morte.
Par ailleurs, si l’école avait repris physiquement, si nous, les salariéEs de terrain étions censés recommencer immédiatement « comme avant », par contre, tout le reste n’a pas repris. Pendant que Blanquer commençait à développer sa thématique sur les « profs décrocheurs », la réalité des manquements institutionnels était totalement masquée. De nombreux élèves à besoin particulier, qu’il s’agisse d’élèves en situation de handicap, d’élèves pour lesquels un appui RASED était nécessaire, d’élèves non francophones qui devaient être orientés vers une classe d’apprentissage rapide du français, d’élèves qui devaient accéder à des parcours spécifiques au collège ( classes bilingues, ULIS, changement d’affectation géographique ) avaient été laissés seuls pendant tout le confinement, seuls avec des démarches complexes à effectuer par les familles, et leurs dossiers laissés en friche. Même si de nombreux intervenants extérieurs ont repris le travail, et ont tenté de pallier à tout cela, beaucoup de dossiers ont juste été clôturés, avec des « on verra l’an prochain » assénés par les hiérarchies de l’Education Nationale….et notamment pour ces fameux élèves « décrocheurs » pour lesquels l’école était censée rouvrir de manière prioritaire.
De plus, cette période aurait pu effectivement être un temps de préparation à la rentrée de septembre, avec ou sans deuxième vague. Une période où adultes et élèves, nous aurions appris à vivre la scolarité en période de pandémie. D’abord par la prévention et l’apprentissage des gestes barrière au quotidien, en imaginant de nouvelles manière de faire.
Contrairement aux clichés, les enfants ne sont pas forcément traumatisés par la distanciation sociale et une des grandes découvertes pour nous les adultes a été la manière, dont en quarante huit heures, ils ont adapté leur sociabilité de manière ludique, créé de nouveaux codes sociaux à la mode, des jeux adaptés. Pour beaucoup, ils arrivaient avec des masques et nous aurions pu mettre à profit cette période pour leur apprendre à s’en servir pour la suite, s’ils en avaient tous eus, fournis par l’Education Nationale. Surtout, si le Ministère avait été soucieux de prévoir une rentrée avec les scénarios du pire, et soucieux d’y mettre les moyens, alors nous aurions pu construire une école de crise. Sur la durée.
Utopie naturellement. C’est tout le paradoxe terrible de cette période.
Si les salariéEs de l’Education Nationale s’étaient comportés sans idéal, sans solidarité, sans intelligence du collectif, sans courage, sans être à la hauteur des évènements, en somme, alors oui l’on aurait pu parler d’effondrement de l’école. Mais ce qui s’est passé sur le terrain, au contraire, a été un moment où ceux qui font l’école au quotidien, l’ont portée à bout de bras.
Il faut rappeler cette réalité. Rien, dans notre contrat de travail ne nous obligeait à déployer les montagnes d’inventivité dont nous avons fait preuve. Que se serait-il passé si 90 pour cent des enseignants ou même moins avaient déclaré leur ordinateur en rade, leur téléphone cassé pendant le confinement ? Que se serait-il passé s’ils avaient fait le minimum syndical, compté scrupuleusement leurs heures de travail effectif ? Que se serait-il passé s’ils avaient argué de mille raisons de ne pas effectuer telle ou telle tâche de retour à l’école, n’étant pas engagés pour tracer des traits à la peinture devant les écoles, pour assurer des gestes d’hygiène sur des dizaines d’élèves , ou pour transporter eux même du mobilier toutes les deux semaines pour le cinquantième aménagement de classe ?
Dans mon école, toutes les enseignantes et une bonne partie des autres salariées pouvaient ne pas venir après le confinement, et disposer de possibilités parfaitement légales de dispense de travail sur site. Soit pour des raisons familiales, soit pour des raisons de santé. Tout le monde est revenu, et pas par lèche-bottisme ni par accord avec les stratégies du Ministre. Non, juste parce que la notion de service public et d’intérêt général est, quoi qu’on en dise, un élément important de l’imaginaire social dans l’Education Nationale. Cela ne se confond en rien avec une quelconque soumission politique, car l’école avait été le lieu d’une grève particulièrement suivie et massive quelques mois avant.
L’utopie de l’engagement, de la solidarité, du sens collectif , du courage a donc bien existé pendant ces six mois de pandémie. Pour autant, la politique du pouvoir a consisté à la nier absolument : en fabriquant un récit où l’école était menacée par une caste d’individualistes paresseux et lâches, qui faisaient une Histoire avec rien et dont l’égoïsme mettait en jeu l’avenir des enfants de ce pays.
En dehors de satisfaire le sombre ego d’un Ministre revanchard qui n’avait pas supporté les grèves de l’hiver, ce récit a une fonction concrète : la réouverture progressive de l’école a suivi un calendrier finalement explicable avec le recul .
Dans un premier temps, face aux demandes de sécurité sanitaires des parents et des salariés, conscients du danger pandémique, le Ministère a répondu par un protocole le plus contraignant et détestable possible, sans par ailleurs engager aucune dépense notable. Les projets d’école à l’extérieur, d’ouverture de bâtiments que le gouvernement faisait miroiter au milieu du confinement se sont évaporés avec la reprise.
Dans les écoles, nous n’avons évidemment vu ni artistes, ni sportifs, ni conférenciers multiples censés nous seconder afin de pouvoir multiplier les espaces de vie sociale et de ne pas entasser les élèves dans les classes. Nous n’avons eu aucun budget spécifique et le nombre de masques a été si chichement compté que beaucoup d’écoles n’en ont même plus un seul pour la rentrée. Selon les communes, pendant les deux dernières semaines, le savon ou le gel hydroalcoolique .
Mais le détestable protocole qui aurait pu être dix fois plus simple et tout aussi sûr, avec de vrais moyens, a renversé le débat : une grande partie des élèves qui voulaient revenir ne le pouvaient pas et même nous, nous en avions évidemment assez de multiplier des lavages de mains sans raison notable ou de ne pouvoir mélanger dans la cour de récréation des gosses qui étaient ensemble à la cantine où allaient jouer au parc tous les soirs.
Dans le débat public, la question de la sécurité sanitaire est totalement passée à la trappe et les parents n’avaient plus qu’une envie, notamment ceux qui avaient des contraintes professionnelles et sociales : retrouver l’école « normale ».
Celle qu’a promis Blanquer pour la rentrée et qui s’avèrera extrêmement dangereuse lorsqu’un nouveau pic épidémique surviendra ce qui est de plus en plus probable.
C’est la raison pour laquelle six mois de pandémie nous laissent un goût aussi amer.
Bien plus que la peur de la maladie, c’est le délitement de notre école et la perte de sens qui occasionnent chez beaucoup d’entre nous une immense fatigue mentale .
Nous avons au fond vu comment ce gouvernement avait choisi de répondre à un événement inédit. Par une politique parfaitement banale, celle de la destruction de l’école publique, laïque et gratuite déjà bien entamée.
Publique, l’école du Covid 19 le sera de moins en moins : d’abord parce que le précariat des salariés ne cesse de s’y intensifier. Ensuite parce que le Ministère n’en finit plus de déléguer, aux communes ce qui est déjà facteur d’inégalité, mais aussi de plus en plus, sous prétexte de faire appel aux « bonnes volontés » et de développer des « activités », à des acteurs privés, et l’on verra de plus en plus d’initiatives d’associations ou de « fondations » qui ne sont jamais que le faux nez de grandes entreprises.
Le «distanciel » sera utilisé de plus en plus, l’école publique sera un squelette et ceux qui ont les moyens se paieront les muscles comme cela a déjà été le cas lors du confinement où très vite de grandes entreprises comme Acadomia ont proposé des cours en ligne ou des séances de rattrapage des programmes.
La laïcité s’est réduite à des incantations répressives contre l’islam et la menace musulmane.
Quant à la gratuité, comment pourrait-elle exister, quand déjà , depuis des années, les enseignantEs paient une partie du matériel de classe avec leur propre argent, et qu’il a été considéré comme parfaitement normal que les profs se débrouillent avec leur matériel informatique personnel pour bosser ? Les profs mais aussi les élèves, et monsieur Blanquer qui se plaint des décrocheurs et va commanditer cinquante études statistiques pour démontrer qu’ils sont d’abord des enfants des quartiers populaires n’a semble-t-il jamais eu à faire des exercices de grammaire dont l’énoncé est accessible uniquement par le biais de l’unique téléphone portable des parents.
Alors, que reste-t-il de la fameuse école de la République ? Une utopie concrète, qu’ensemble, élèves, salariés et enseignants, malgré tout, nous avons fait vivre en pleine pandémie. Par un formidable effort de collectif, d’espoir et de solidarité qu’un gouvernement défaillant tente de réduire à néant même dans nos mémoires, pour nous laisser honteux et démobilisés.
Mais ces derniers jours d’école, sans embrassades ont partout été ponctués par des regards embués, des remerciements, des mots maladroits mais chaleureux, sur l’Histoire que nous venions de vivre et de construire ensemble.
Nous n’avons pas eu d’applaudissements à heure fixe, mais on n’avait pas le temps, de toute façon, on faisait face avec nos dix doigts, notre envie de partager des savoirs et du lien social, et de cela, Covid 19 a été révélateur.