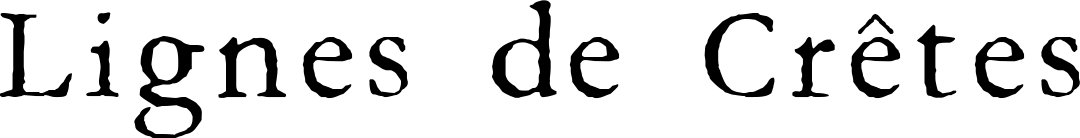J’ai toujours été attachée à la liberté de conscience. Il me semble que cette notion est fondatrice de tout ce qui confère à la vie humaine son caractère sacré et inaliénable. La liberté de conscience implique le respect de l’autre dans ses choix. Elle fonde aussi tous les principes de la démocratie et des droits humains : de l’égalité – car nous en sommes tous dotés – à la liberté – car elle en est l’essence même. Ces convictions font d’ailleurs écho à ce que j’ai compris du dieu dans lequel j’espère (bien loin des enseignements rigidifiés d’une Eglise avec qui je n’ai plus grand-chose en commun) et pour qui la liberté de l’Homme est le corollaire indispensable à la concrétisation d’un monde dans lequel l’humain serait co-créateur.
Ce sont d’ailleurs ces certitudes profondes qui m’ont toujours amenée à défendre le droit à l’IVG. Je n’ai jamais pu comprendre comment on pouvait se déclarer « pro-life » et se débrouiller avec le paradoxe de se poser en protecteur de la vie humaine (y compris celle à venir) au nom de son caractère sacré, tout en lui enlevant précisément sa substance première, celle qui lui confère tant de prix ; la liberté de conscience (et donc la liberté pour les femmes de poser leurs propres choix en ce qui concerne leur vie et leur corps).
Un dilemme : comment être pour la liberté de conscience ?
De la même façon et pour les mêmes raisons, j’ai toujours également défendu le droit à l’objection de conscience et donc, notamment, dans le cas d’un médecin qui ne souhaiterait pas pratiquer personnellement cet acte d’interruption volontaire de grossesse mais préférerait adresser la patiente à un confrère.
Jusqu’à il y a un an encore, enfant de la postmodernité à l’identité fragile, je tenais à ces grands principes comme à une sorte de façon de me définir. C’est bien là le piège des grands principes quand on en fait la base d’une mythologie personnelle bien propre; ils nous définissent autant qu’ils nous enferment et n’échappent pas, ainsi, à cette particularité de tout élément identificatoire.
Ces grands principes au sujet de la liberté de conscience, je les ai tenus jusqu’à l’absurde ; jusqu’à sortir, au détour d’une discussion un peu enflammée, des arguments imbéciles que j’ai regrettés à l’instant. Ce jour-là, rien n’est sorti pour moi du feu de la discussion. Mais quelque chose a éclos au fond de moi, caché loin derrière mes certitudes.
Il a fallu de nombreux mois pour que, de cette éclosion, je cueille un fruit mûr. Le temps du mûrissement de la conscience est un temps long, qui s’accommode mal de l’urgence des discussions enflammées, qu’elles aient lieu IRL ou sur les réseaux sociaux. Mais ça a fini par arriver il y a quelques semaines… Non, ce ne sont pas les mots scandaleux du docteur Bertrand De Rochambeau, président du Syndicat national des gynécologues (SYNGOF) qui qualifiait l’IVG d’homicide au micro de l’émission ‘Quotidien’ qui m’ont amenée à constater que le fruit était mûr pour moi. Bien avant ça, au cœur de l’été, une nouvelle qui passait a allumé en moi la révolte. Dans la Sarthe, un hôpital public (l’hôpital du Bailleul) ne pratiquait plus l’IVG, contraignant ainsi les patientes à se déplacer assez loin pour subir une IVG qui était pourtant leur droit le plus strict.
La cause? Depuis le départ à la retraite d’un praticien, sur les quatre médecins habilités à le faire, trois invoquent leur clause de conscience, rendant impossible l’accès réel à ces soins essentiels, puisque le quatrième ne peut faire face seul à la demande. Or, il ne s’agit pas d’un ‘accident’, d’un cas isolé, puisque les femmes de Fougères en Bretagne, de Montaigu en Vendée, et d’Olonne sur Mer sont également concernées. Plus largement, on comprend que ces cas avérés et graves ne sont que la face visible d’un iceberg fait de regards méprisants et de paroles culpabilisantes accueillant les patientes en demande d’une IVG qu’on veut finalement bien leur octroyer du bout des doigts, parce qu’il faut bien, comme si il ne s’agissait pas de leur droit le plus strict mais d’un caprice d’écervelée égoïste.
Cette nouvelle m’a confrontée au réel, qui m’a frappé de plein fouet, me filant la claque nécessaire pour faire enfin vaciller mes grands principes humanistes au profit d’une position tenable et d’un peu d’humanité. Jamais plus je ne défendrai l’objection de conscience des médecins qui refusent les IVG. Ni celle du docteur de Rochambeau ni celle d’autres médecins, quand bien même ils se montreraient plus humbles, plus humains et plus réellement empathiques dans leur refus. Pourquoi? Parce qu’entre honorer un principe et lutter contre ses conséquences néfastes réelles pour les gens, c’est tout choisi. Il n’y a que les imbéciles qui ne changent pas d’avis, et je ne veux pas être une imbécile qui a des principes et aucun sens du réel ni de l’empathie.
Retour au réel
D’une façon générale, cette expérience m’a permis de mettre en évidence deux écueils fréquents de la pensée. Le premier consiste à oublier le réel. Les principes sont au service de l’Homme qui veut agir sur le réel, qui cherche à poser des choix et à orienter son action, et non le contraire. Ils sont des repères et non des limites. Réfléchir en faisant abstraction du réel conduit toujours, au final, à nier la réalité des oppressions et donc à se mettre de facto du côté de celles-ci.
Ainsi, toute féministe qui a déjà discuté avec un interlocuteur qui s’oppose, par exemple, aux politiques de quotas au nom du principe d’égalité sait que quelqu’un qui réfléchit hors du réel est seulement en réalité quelqu’un qui ne veut pas le voir changer. Il suffirait pourtant que l’interlocuteur se penche quelques minutes sur les études multiples qui objectivent les inégalités de genre et justifient de mesures particulières qui favorisent l’accès des femmes à certains domaines, non pas pour justifier une inégalité de traitement, mais pour rétablir une égalité que tout dans le réel vient empêcher.
De même, toute personne qui a discuté avec un amoureux de la liberté d’expression qui déplore à grands coups de « on ne peut plus rien dire » que ce qu’il appelle la « bienpensance » pousse la société entière à l’auto-censure, sait que cette personne est, au mieux une personne déconnectée de la réalité de la libération de la parole raciste et de la normalisation du fascisme en général dans le débat public, au pire un fasciste qui s’assume encore mal et dans tous les cas un allié objectif des fascistes.
Retour aux gens
Le second écueil qui m’est apparu comme évident consiste à réfléchir de façon autocentrée, en circuit fermé, et coupé des autres. Dès l’instant où les principes ne sont là que pour nourrir d’autosatisfaction l’identité de l’individu, dès l’instant où ces principes sont, en un mot, du domaine de la posture, ils conduisent nécessairement au déni de l’autre, dès lors que celui-ci viendra par son expérience mettre à l’épreuve ces grands principes.
Ainsi, j’ai développé depuis quelques temps une méfiance a priori de toute réflexion politique qui ne trouverait pas sa source, même ténue et indirecte, dans l’empathie envers des semblables qui expriment leur réalité.
Que signifie en effet un antisionisme viscéral chez un européen qui n’a aucun lien personnel ni indirect avec ce conflit mais se cache derrière la défense du principe de justice ? Ne s’agit-il pas là d’une posture désincarnée de toute compassion réelle qui trouve seulement sa source dans le récit qu’il aime se faire du monde et dans la posture gratifiante du rebelle ou du résistant ?
Oh, bien sûr, si la cause est juste, et si, ce faisant, cette personne défend en effet la justice, où est le mal ? Le mal, il est dans le dérapage inévitable de celui qui ne désire plus voir que les chapitres du récit qui l’arrangent. Le mal, il est aussi, même si cela semble paradoxal, dans la réification si facile – puisqu’il n’a jamais été réellement incarné – de celui que l’on dit défendre mais qui n’est plus au final qu’un faire-valoir au service d’une mise en valeur de l’individu qui s’exprime.
Le danger, bien entendu, serait de devenir absent au monde, à ses injustices et aux enjeux du débat public tant que personne ne vient personnellement frapper à notre porte. C’est pour cette raison qu’il convient d’une part, de rester ouvert au monde et à l’autre, prompt à entendre les voix particulières qui nous interpellent ; et, d’autre part, à ne cesser d’interroger les ressorts de nos positions politiques, pour s’assurer de ne jamais bâtir nos postures et nos identités sur la réification de qui que ce soit.
Une question de priorités
Entre cette discussion enflammée d’il y a presque un an et cet été, qu’est-ce qui a changé ? Je me suis politisée un peu plus. Pour beaucoup, ‘politique’ est un gros mot. Un mot qui fait peur et qui traîne derrière lui les remugles des petits arrangements personnels, des trahisons et des compromissions qui invitent à défiance.
Pour moi, cela signifie au contraire que j’ai davantage pris la mesure de la dimension collective de la marche du monde et de ses enjeux. Je ne peux plus planifier mon action sur le monde à la seule aune d’une réflexion qui tourne sur elle-même ; je me suis confrontée à la réalité du monde que certains de mes semblables se prennent de plein fouet dans la figure. Et j’ai décidé de tenter d’abandonner le rigorisme des grands principes et l’hypocrisie des postures pour vivre et tâtonner avec les autres, sans aucune réponse et avec des tonnes de questions, mais avec aussi la certitude que tout partira de ce tissage collectif.
Politiquement, ce sont en fait nos priorités qui nous définissent, probablement autant que les valeurs que nous affirmons défendre. Aussi, plus jamais je ne donnerai la priorité à un principe au détriment du réel.