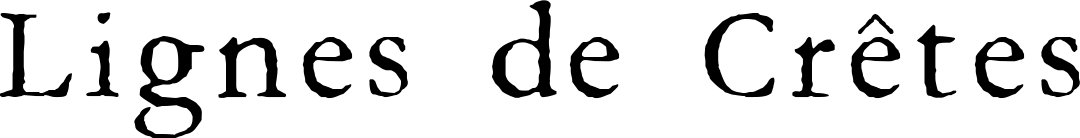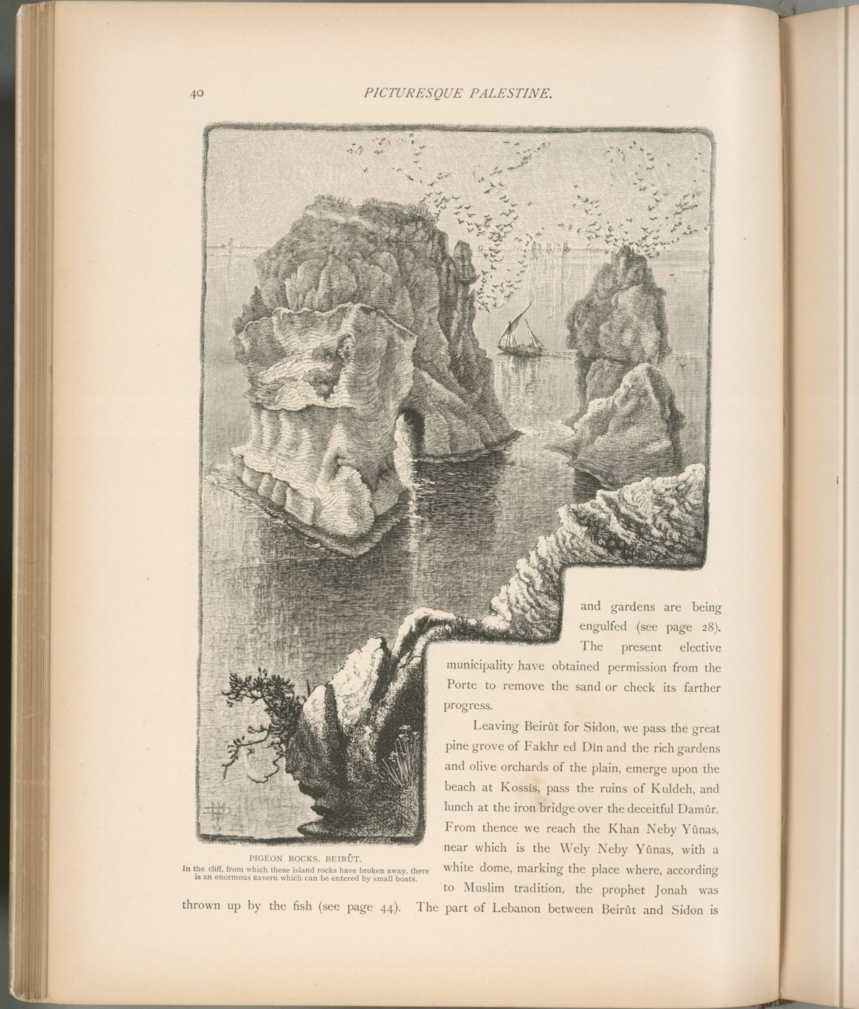Bizarre d’attendre encore une guerre déjà commencée. Il y a déjà des dizaines de morts au Sud-Liban dans les rangs du Hezbollah, des pertes qui n’ont jamais été aussi importantes depuis 2006 (mais sont négligeables par rapport aux pertes ensuite en Syrie, qui ont peut-être durablement bougé les seuils de tolérance). Déjà des militaires, déjà des morts, déjà des milliers de déplacés, et déjà des morts familiers et proches, notamment en la personne d’un journaliste dont tout le monde avait au minimum une connaissance indirecte, celle d’un visage familier dans un certain Beyrouth – et pourtant pas encore une guerre qui se dit. Dans cette période où les confrontations en cours ont déjà duré plus longtemps que la guerre de 1967 ou celle de 1973, et désormais plus que 2006 bientôt, règne un flou bizarre.
Savoir la violence et la guerre déjà là sur le sol libanais et pour une fois sentir que ce n’est pas un événement, pas du dicible, juste un fond de roulement, est une situation inédite dans un pays où tout s’écrit d’habitude par surgissements soudains. C’est aussi d’une tristesse sans nom par rapport à l’histoire du sud-Liban, terre tellement marquée par la guerre (invasion en 1978, 1982, occupation jusqu’en 2000, guerre en 2006), que des dizaines morts ou des bombardements quotidiens n’y sont même plus un événement national, mais presque quelque chose qui relèverait d’une presse régionale si elle existait dans le pays, ou bien d’un bulletin interne d’une organisation, celle du Hezbollah, dont les traductions automatiques étranges sur ses sites (« killed while performing his jihadi duties »), répétée exactement sous la même forme de l’un à l’autre cas, ont presque des allures d’annonces de mutations et de promotions, ou de froid yearbook des martyrs.
Le déjà-là et le suspendu
Combats, ou pas, ou déjà plus, la guerre a pourtant commencé pour les personnes à proximité de la frontière libano-palestino/israélienne, dont la majeure partie est dans la situation inédite de pouvoir partir pas tout à fait du jour au lendemain – différence majeure par rapport aux conflits passés – voire pour certains tentent de ne pas partir dans une période de crise où la guerre perturbe une période de récoltes vivrières (qui pour certains est vitale aujourd’hui) dans une zone aussi agricole que pauvre. A ce titre la gravité de l’utilisation de munitions au phosphore blanc par Israël (désormais de plus en plus avérée) est aussi là, dans les feux qui ravagent des cultures. La guerre a aussi commencé pour le secteur de l’agriculture de ce point de vue, comme pour le tourisme, qui reposait – hors été – sur la présence d’étrangers au Liban (quand même environ 90,000 en 2016, dont on peut supposer que le nombre a été réduit depuis 2019), massivement partis d’un coup. Une industrie qui repose aussi sur une organisation en amont à l’échelle de semaines voire de mois à l’avance, sur fond de confiance, pour les voyages et les visites : encore quelques semaines à ce rythme et c’est la saison des fêtes qui va aussi vaciller. Dans le même temps, toute la consommation habituelle du Liban même est ralentie, de l’argent étant gardé de côté dans le package d’urgence que chacun/e constitue.
Une autre guerre, celle du plus offrant, a déjà commencé aussi pour les propriétaires d’appartements dans les zones identifiées comme sûres, en gros la géographie épargnée de la guerre de 2006, majoritairement chrétiennes, qui ont augmenté les prix et demandent pour certains un an de loyer d’avance. Les réfugiés du sud Liban et du sud de Beyrouth, en 2006, une fois la guerre commencée, pouvaient faire l’objet d’une gestion de crise mi-gouvernementale mi-liée à une mobilisation générale à travers associations, ONG et structures ad hoc.
Dans la situation actuelle, la question de se réfugier se joue certes avec quelques hébergements publics et quelques structures administratives ou militaires, des formes de structures d’urgence souvent gérées au niveau municipal, pour les quelques villages directement touchés. Mais majoritairement, elle se déploie à un niveau individuel, sans instructions claires. Certains peuvent partir, et les autres, ceux à qui la crise économique n’a plus rien laissé notamment, ne peuvent pas. La décision d’exode est laissée aux individus, à leurs ressources variables, et quasiment au jeu du marché (qu’on peut maquiller aisément en volonté de ne pas quitter sa terre jusqu’au bout, pour la gloire, mais enfin…), jusqu’à dangereusement mettre dans la balance le caractère temporaire de cette situation : cette non-prise en charge de l’urgence par un Etat à une échelle large – ce qui serait garant d’un après, car marquant l’exception pour une raison et un temps clairement délimité – risque d’avoir un effet à long terme.
Il sera difficile de faire revenir chacun chez soi, faute de pouvoir en retour assurer que ce qui n’a pas vraiment commencé s’est réellement terminé. Au lieu de ça, ministres et institutions annoncent des « plans », montrant combien eux aussi sont dans l’attente et l’inaction, et entretenant l’idée d’une période qui n’a pas encore commencé, dont ils ne sont pas responsables, et par extension, pour chaque individu, une période qu’on ne peut pas tout à fait se sentir déjà vivre alors même qu’il y a une grande différence à regarder Gaza depuis le Liban ou depuis l’Europe.
La guerre existe aussi à grande échelle, à l’international : pour les assureurs qui renchérissent les tarifs autour du secteur aérien ou ceux de l’importation d’hydrocarbures; pour tout le secteur du transport, de marchandises comme de personnes qui en dépend et en répercute le coup, diminue les vols, les bateaux, les transferts ; pour des institutions internationales par définition sommées de favoriser le scénario du pire pour se dédouaner à l’avance, responsabiliser les individus, et alléger l’hypothétique gestion du pire à venir de ces individus déjà partis, quitte à participer en retour à nourrir une montée des enjeux.
Cette promesse est omniprésente dans les angoissants fils sécurité de ces institutions, théâtre où se jouent aussi les prétentions à mieux savoir que les autres si oui ou non et quand la guerre doit avoir lieu, comme un sujet où il s’agit de tenir son rang, en prétendant qu’on pourrait prévoir des choses imprévisibles par nature où les acteurs principaux eux-mêmes gèrent à l’action-réaction minute par minute plutôt qu’à la stratégie réfléchie en amont.
Au Liban peut-être plus qu’ailleurs une position de pouvoir se reconnait à la proximité à l’événement futur ou passé : en France chacun est critique de cinéma ou sélectionneur de l’équipe de France, au Liban chacun est chroniqueur géopolitique, et par un mimétisme incontrôlé c’est un jeu auxquels tous les étrangers sur le sol libanais participent aussi – sans se rendre compte que c’est en partie la reprise de leurs fils sécurité bricolés à la va-vite à partir de la moindre rumeur (et dont la seule utilité avérée est essentiellement interne pour justifier des primes sécurités mirobolantes) qui nourrissent les psychoses libanaises, dans une forme de boucle perverse. Faute de principes de tri, le moindre fait divers s’y retrouve, et y gagne une importance jamais vraiment mesurée (mais il faudrait expliquer des choses par rapport au néo-colonialisme dans ce pays pour le comprendre, et c’est une autre histoire).

A une échelle individuelle, partagée à voix basse cette fois-ci et confinée à l’individu sans voie de sortie, la guerre est aussi déjà dans les têtes et galope de visions en visions, soit par des remontées de souvenirs et de savoir-faire pratiques, soit par des surgissements mentaux, soudaines superpositions d’images terribles sur du familier et du quotidien : vous marchez et autour de vous le bout de la rue est mentalement dévasté l’espace d’un instant. Et il serait indécent de trop le dire quand d’autres vivent de vraies destructions en ce moment. Anxiétés et paniques personnelles n’ont pas l’air encore d’être légitimes quand il s’agit de d’abord vérifier que d’autres sont encore vivants. La guerre n’a pas commencé – puisqu’on vous le dit – et les anxiétés sont donc un luxe comparé aux guerres et à la violence effective.
Une certaine guerre aura eu lieu à ce titre quoi qu’il arrive ensuite, et même, parce qu’elle n’a pas commencé, elle risque pareillement de ne pas vraiment finir ou de mettre un temps fou à se clore. Elle n’a d’ailleurs à ce stade même pas de nom, même pas de caractère autonome. Elle n’éclate pas, mais déborde petit à petit, depuis un autre conflit d’abord, mais aussi sur elle-même puisque la violence est déjà là, et son importance, sa proximité au mot guerre, se mesure seulement à sa profondeur géographique – les frappes et les échanges de tirs ont-ils lieu à 5, 10, 20 km de la frontière? – comme autant de seuils scrutés et passés peu à peu. Vivre une guerre de notes de bas de page et de petits pas par rapport à un événement majeur n’est pas exactement dans les habitudes du Liban qui vit tout en grand et au centre, mais dit bien aussi combien le pays se trouve réduit à une certaine marginalité à l’heure actuelle, alors qu’il a longtemps été un lieu d’événements à répétition dans un monde arabe très verrouillé jusqu’en 2011.
Que la guerre n’ait pas l’air de se passer est bien sûr une conséquence de la nature du conflit en cours, où il n’est pas question de dire qu’il y a déjà une dimension régionale (Israël bombarde aussi la Syrie, et les iraniens en Syrie, les Houthis yéménites envoient des missiles sur les américains, les attaques et menaces se multiplient en Irak) tout en maintenant une pression au même niveau pour être sûr que ce pire n’arrive pas – basique mécanisme de la dissuasion. Et dans cette logique, le Hezbollah – même s’il n’a qu’une envie limitée d’aider un allié finalement bien plus lointain que la représentation donnée par les visions géopolitiques aussi faussement compliquées que graphiquement claires (sous formes d’axes et de lignes et d’aplats de couleurs d’acteurs bien délimités, sans ambiguïtés ou divisions internes) – ne peut pas ne rien faire.
Par ailleurs, rien dans l’histoire du Liban, malgré toute sa richesse, n’a ressemblé jusqu’ici à la situation actuelle d’attente possible de la guerre régionale avec son front libanais. Le Liban n’a jamais été un front des guerres régionales de 1947, 1967 ou 1973, et la dernière fois qu’une guerre régionale a été possible c’était peut-être en 1981 lorsqu’on est passé tout près d’une confrontation entre la Syrie et Israël à partir du Liban. Certains diront bien sûr que le Liban a toujours été une terre de confrontations entre tout ce petit monde, mais ça n’a en réalité pas grand chose à voir avec la perspective d’un conflit régional avec des armées ouvertement engagées. Que cette guerre ait de tels contours, même sous forme de lointaine silhouette, et aussi inédits, excite d’autant l’imagination du pire.
L’événement en panne
Mais à l’échelle du Liban même, celui d’aujourd’hui, cette situation prolonge une forme étrange de refus de l’événement, où même le paradigme de l’explosion qui tant rythmé l’histoire du pays semble en panne. Depuis plusieurs mois plus rien ne se passe, même les événements sont en berne, ou épargnent étonnamment le Liban, ou le rendent secondaire – avant cette catastrophe palestino-israélienne, il y a eu ce tremblement de terre passé très près, et que certains attendaient pourtant depuis longtemps comme la dernière catastrophe sur la liste (Godzilla et invasions de cafards géant mis à part). Dans le bureau d’un expert, sismologue, fin 2021, je m’étais vu décrire par le menu la catastrophe que serait un tremblement de terre sur un parc immobilier libanais constitué en partie d’extensions empilées d’étages sur étages construits au fil des ans – événement que, je peux le dire aujourd’hui, j’avais constitué mentalement comme étant le dernier événement qu’il restait à Beyrouth (à parité avec le dernier événement qu’il reste au Liban, la mort de Feiruz)(non, celui là non plus n’arrivera pas).
La crise économique et politique n’a aussi plus de nom et manque de mots, elle ne suscite quasiment plus de manifestations pour s’en plaindre (il n’y plus de manifs, plus de mouvements sociaux, et en fait, à front renversé, on peut même se demander si les événements actuels ne vont pas être un bon moyen pour les activistes locaux de remettre pied dans les rues en évitant de reprendre ces combats dans l’impasse). Cette crise, les événements qui la rythment, existent et devraient être annoncés et commentés dans toute leur ampleur, passent comme des informations sectorielles et techniques, faute d’économistes, comme de journalistes, militants et chercheurs formés en économie pour en parler et faute évidemment en amont de la moindre discussion démocratique sur ces questions : la décision la plus majeure de l’année, celle de mettre fin à un taux de change fictif à la douane en forme de subvention déguisée à l’import (subvention payée par la banque centrale et donc par les libanais pour un import dont dépend énormément l’économie libanaise), s’est joué en deux temps en décembre et février, par surprise. L’autre subvention, celle qui stabilise le taux de change avec le dollar, toujours payée par la banque centrale et donc aussi par les libanais, court toujours.
Ces décisions économiques qui se font à un niveau d’un seul ministre en apparence, sans discussion au parlement, comme elles se faisaient auparavant au niveau de la banque centrale à coup de « directives », se sont succédées. Noyées dans leur nombre et leur technicité elles apparaissent dépolitisées – le reflet aussi de l’absence criantes de compétences économiques de ces hommes politiques dont le caractère d’hommes d’affaires nous fait souvent surévaluer leurs compétences dans une échelle de l’économie qui n’a pourtant rien à voir.
Dans ce vide apparent certains, cet été, commençaient (de manière insensée) à parler de la crise au passé, confondant renouveau économique avec façadisme économique (presque au sens littéral tant il s’agit de vendre du clinquant), notamment celui des nombreuses ouvertures de cafés et restaurants, et d’achats immobiliers plus généralement, sur fond d’un nouveau flux d’argent seulement liquide, qui ne passe plus par des banques qui mine de rien opéraient un tri par rapport à l’entrée de capitaux. Des ouvertures explicitement destinées aux expatriés libanais qui reviennent l’été et à des investisseurs qui n’habitent pas là (et en investissant maintiennent d’autant à la hausse les prix de Beyrouth). Pendant ce temps à Beyrouth, d’autres choses ferment, dans le petit monde culturel et intellectuel, la décennie 2010 en M qui avait pourtant longtemps résisté a pris fin entre la fermeture de l’espace culturel Mansion, du bar Molo, le déplacement de la boite/salle de concert Métro – et on peut y ajouter désormais à travers cette nouvelle crise – la désertion d’un autre bar qu’est Mezyan.

L’histoire du Liban a jusqu’ici toujours avancé par hoquets, comme histoire surprise, au point qu’elle s’écrive de manière particulièrement marquée par chronotopes (le 8 mars, le 6 février, le 14 février, le 14 mars, le 13 avril, le 25 mai, la guerre des 33 jours, le 4 août, le 13 octobre, le 17 octobre, dont la célébration a été complètement oubliée dans le contexte actuel, etc), et lorsqu’il y a eu par le passé attente de l’événement, c’était surtout de la prochaine occurrence d’une série en cours (attentats, assassinats, reprise de combats, etc), ou attente par principe parce que tout était possible, parce que la guerre depuis 1975 a reconfiguré les routines intellectuelles jusqu’à créer des cerveaux stratèges, pesant des scénarios, persuadés par la nécessité de saisir l’événement avant qu’il arrive, à travers le moindre signe.
Mais même ce traditionnel savoir-faire de promettre le prochain événement a désormais du mal à être tenu : les rumeurs sur l’imminence d’une nouvelle guerre estivale, ce marronnier phare de la florissante entreprise collective de rumeurs du Liban, étaient peu inspirées cet été, alors que ce conflit israélo-palestinien serait passé, quelques années plus tôt, comme la confirmation d’une rumeur tardive. Au lieu de ça, c’est la surprise qui a prévalu.
In extremis, l’annonce, en plein milieu de la crise ouverte depuis le 7 octobre, d’un forage de pétrole infructueux au large du Liban, a rassasié ces réflexes avec l’idée que le vrai événement – la présence d’une manne pétrolifère au Liban – est encore différée pour des raisons géopolitiques. En réalité il y aurait donc bien un événement à ce titre, mais volé, nié, ou décalé dans le temps (pour les plus optimistes). La tactique politique d’annoncer bruyamment un futur de pays pétrolier, utilisée par le président de la république en 2019 comme premier discours pour tenter de calmer des mobilisations sociales qui commençaient alors (geste surréaliste), est devenu un des éléments d’une mécanique d’entretien d’une croyance en l’avenir prospère du Liban à une quasi-échelle de l’individu. Mécanique dont Rosalie Berthier a montré combien elle était plus qu’une croyance ou une série de rumeurs folkoriques et sympathiques, et plutôt un vrai phénomène de wishful thinking avec des effets spécifiquement économiques en retour, où “la vraie rente libanaise est d’être le Liban” .
Si tout ce dossier de pipelines n’impliquait qu’une contribution, même inconsciente, à la survie du Liban, un effort personnel d’imagination et de survie mentale propre à chaque individu – et n’était pas l’effet de la mise à disposition de ces idées par des organes de propagande (Russia Today, qui fait en ce moment sa pub dans tout Beyrouth), ou d’influenceurs complotistes qui ne cherchent là que le profit de vidéos monetisées et suivent le marché où il se trouve, en ce moment depuis l’Ukraine vers la Palestine et secondairement le Liban – il y aurait eu dans cette croyance acharnée une beauté et une fidélité désarmante.

Une impasse intellectuelle
Il est en fait déjà difficile de savoir ce qui s’est passé au Liban depuis 2020. Ce qui traîne, s’accumule, se répète de manière lancinante et sans bruit – par exemple les risques terribles pour la santé que font peser des milliers de générateurs marchant de concert pour compenser une électricité défaillante, les futures pollutions des batteries de panneaux solaires sans circuit de recyclage, entre autres effets cumulés de quatre ans de crise économique aiguë – peine d’autant moins à percer le voile des attendus de l’écriture journalistique ou intellectuelle, qu’il y a ce poids de l’habitude, celle d’avoir toujours écrit l’histoire de ce pays comme une suite de pics (géo)politiques tragiques (mais en même temps si dramaturgiques) – tout plutôt qu’un angle social ou économique sec qui n’offrirait pas prise à un récit.
On parle si peu de santé, d’écologie ou d’économie dans ce pays qui devrait être un cas d’école des limites extrêmes du capitalisme financiarisé, celui-là qui devrait changer notablement les règles du jeu militant et intellectuel comme l’a expliqué Michel Feher. Le Liban, un des pontons en suspension au bord et déjà au-delà du capitalisme, devrait être une nouvelle forme de « pays message » (pour reprendre le mot de Jean-Paul II en 1989), non pas celui des risques/promesses du multiculturalisme, ou de la rencontre chrétiens/musulmans, ou des risques du terrorisme islamiste (puisque c’est par et au Liban qu’on le découvre dans les années 1980) mais celui du risque d’un libéralisme poussé à l’extrême : tellement présent dans le pays dès les années 1950, il n’a jamais eu besoin d’être néo, jusqu’à créer une économie où les banques sont le principal producteur de richesses et le deuxième plus grand employeur du pays.
Toute une campagne électorale en 2022 a ainsi pu être menée quasiment sans jamais parler des banques ou de l’économie, qui ont réussi avec un talent fou à attribuer l’entière responsabilité de tout un système à un seul homme, Riad Salamé, contre qui les hagiographies délirantes des vingt dernières années étaient faciles à retourner dans le sens inverse. Les élites libanaises peuvent du coup célébrer tranquillement, à la mort de Raymond Audi – le fondateur de la principale banque du pays, qui prend son essor (ahem) pendant la guerre civile – la disparition d’un homme bien trop charmant et trop cultivé, trop ami des arts, pour être seulement banquier. Pendant ce temps, les apparents nouveaux acteurs politiques ont découvert les délices du jeu politique libanais, de rencontres et de négociations permanentes et quotidiennes, de fréquentation du monde, sans se rendre compte qu’ils s’y sont perdus et ont oublié de porter le dossier économique, tout entier pensé comme la future conséquence d’accords internationaux.
La croyance en la géopolitique comme seul moteur de l’histoire concerne tout le monde, y compris et avant tout les élites, qui se font prendre à l’addiction d’un jeu libanais toujours très tendu, où tout peut avoir sens, où la veille est de mise, et le mouvement permanent et les rencontres doivent être continues pour saisir ce qui se passe à un moment t. Quitte à se rendre compte trop tard qu’avoir participé à ces réunions, groupes WhatsApp, grands projets, ces heures intenses, ne laisse pas autre chose qu’une impression flatteuse d’avoir été au cœur de la bourrasque sans avoir agi sur quoi que ce soit.
Peut-on souffrir de métaphores et d’idées mal placées, mal conçues ? Il y a une curieuse articulation au Liban entre deux choses qui explique aussi pourquoi l’économie et le social ont toujours l’air secondaire. D’une part cette pratique de la politique ou ce suivi d’une politique, entendu comme uniquement pratique politique d’élites qui négocient et parlent, qui ne fait que bouger en permanence, sans aucune stabilité, où les acteurs se multiplient – un jeu incroyablement addictif.
D’autre part l’appréhension de la politique comme système, aussi bien décrit comme telle par ses praticiens que par les analystes – être du monde c’est alors à la fois être a au courant des derniers mouvements mais aussi en avoir compris le système. Un système – qu’on l’appelle confessionnel ou géopolitique ou mafieux – constitué d’un ensemble d’entités aussi opposées dans les discours qu’objectivement alliées, et d’acteurs qui justement ont l’avantage d’être hors du temps, immémoriaux et stables. Les types de savoirs qui s’agitent au Liban ordinairement, la géopolitique, comme la science des confessions ou pire encore (dans le degré de précision) des familles, ces sciences figées (sciences de la carte et sciences coloniales aussi d’ailleurs), et enfin le consociationnalisme qui ne parle que des élites entre-elles – tous nourrissent ces discours.
En dernier recours, ils permettent de faire l’économie du suivi des mouvements continus d’une société en des termes économiques ou plus techniques, jusqu’à oublier de chercher à les mesurer et en oublier l’existence – ce qu’un statisticien m’avait expliqué en ces termes très directs en parlant de la réalisation d’un sondage électoral : pourquoi donc chercher à savoir comment les femmes votent dans un village quand je sais que la variable explicative la plus forte c’est comment la famille de cette femme vote ? Pas étonnant à ce titre que les seules structures d’information des partis soient circonstancielles (et d’ailleurs massivement externalisées à des boites privées embauchées pour l’occasion) : les « machines électorales », pour le vote. Tout ça prend, à grande échelle, des allures de boucle perverse, où l’on ne trouvera jamais ce qu’on ne cherche pas.
Le scepticisme de la catastrophe
De leur côté, les vieilles élites, elles, ne peuvent plus comme avant manier l’événement : d’abord parce que le seul véritable événement attendu et sûr les concernent maintenant eux-même, ce moment où ils tireront leur révérence, une forme d’attente de la fin de règne royale ou dictatoriale, qui au Liban aura tutoyé les limites mondiales du genre avec des personnages au centre depuis 40 ans, mais une manière de régner unique multipliée par plusieurs sous-chefs, aujourd’hui tous en bout de course – Michel Aoun 90 ans, Nabih Berry 85, Walid Joumblatt 74, Hariri père en aurait 79. Fin impossible à accélérer, impossible à penser comme une opportunité politique parce que (sauf à rêver de disparitions simultanées, particulièrement impossible dans le cas du chef du Hezbollah Hassan Nasrallah)(seul le Covid a laissé plané un espoir un temps) ces disparitions se feront au compte-goutte, et que chacun d’entre eux les prépare depuis des années. L’immortalité ayant toutefois une limite, il reste à voir comment s’opérera la transmission dans les faits.
Plus encore, à force de survoler et contourner les dates limites, celles-ci ne se rattrapent plus. L’absence de l’événement, qui ne vient pas et qu’on finit par ne plus attendre, est aussi une constante des derniers mois, où les événements légalement prévus n’arrivent pas et la rythmique politique est grippée (l’élection présidentielle en panne, et bientôt le remplacement de la tête de l’armée, et l’on a même oublié au passage que le gouvernement aussi était démissionnaire). Le prochain événement prévu à coup sûr n’est pas tant le moment où l’on élira un président : c’est celui où la durée de la vacance du gouvernement libanais, 526 jours aujourd’hui, dépassera le record mondial, tenu encore à ce jour par la Belgique, 652 – le rendez-vous est déjà fixé le 5 mars 2024. Hier, on fêtait aussi les 1 an sans présidence de la république. Un autre rendez-vous, à plus long terme, pourrait être celui de l’épuisement des réserves de change de la Banque Centrale : au rythme actuel, et à supposer justement que la guerre ne complique pas ce front monétaire, il reste 5 ou 6 ans (avant de se résoudre à vendre la dernière ligne de défense, l’or).
Ces durées qui s’allongent changent la donne. Il devient difficile d’y voir, comme dans les années précédentes, une machination ordinaire et l’expression d’un jeu de vétos mutuels et de négociations continuelles dans un système particulièrement pervers de gouvernement partagé, où toutes les décisions, même les plus minimes font l’objet d’une discussion collégiale en conseil de ministres (rien ne se joue par exemple dans des rencontres de deuxième ou troisième niveau entre conseillers de ministres ou directeurs généraux de ministère, tout remonte, jusqu’à presque la nomination des plantons de ministères). A force ne pas fonctionner, il paraît légitimement tout simplement plus facile de dire qu’il ne fonctionne plus.
Les promesses politiques n’ont plus de traduction, et en retour même les habituelles menaces de catastrophe sociale ou technique sont marquées d’une certaine lassitude, voire d’une dimension quasiment rituelle où l’on est tenté de se demander combien ceux qui les émettent y croient encore. Attiser la possibilité d’une catastrophe imminente a été pourtant un réflexe de communication des hommes politiques libanais : en 2021, un premier ministre promet une explosion sociale sous peu, sous-entendu si des aides n’arrivent pas de l’extérieur. Problème : ce type de menaces ne prennent plus, quand bien même la situation empire.
La nouvelle variation sur l’idée d’exceptionnalisme libanais, sous forme d’importation du mot d’ordre (mondial) de la résilience (cette idée responsabilisante et psychologisante, dépolitisante à souhait, que tout rebondit sans cesse au niveau du peuple et des individus quoi qu’il se passe au niveau politique ou militaire) a au Liban une autre définition implicite : elle arrive au moment précis où les bailleurs de fonds internationaux commençaient à baisser la voilure au milieu des années 2010 et permet de dire implicitement et poliment que même eux ont fini par ne plus croire aux risques tant agités pendant des années, et donc de s’en dédouaner sur l’idée que tout finit toujours par se résoudre.
A force de mise en scène, les réalités sociales, économiques et techniques deviennent difficiles à discerner, d’autant plus que les déclarations ne font même plus l’effort d’être cohérentes au fil du temps : comme quand le patron d’Ogero – l’agence chargée d’internet et des télécoms – brandit l’hypothèse d’une coupure d’internet comme chantage à son gouvernement, en oubliant qu’il avait lui-même assuré qu’aucune coupure de ce type n’était possible quelques mois plus tôt, et un temps plus tard en critiquant les employés qui usent de la même menace comme d’un moyen de négocier des salaires.
Cette promesse de grand soir d’internet, très improbable techniquement parlant, masque dans l’apparente possibilité d’une décision souveraine et radicale ce qui est un processus de fond : une subsidence sociale et technique – ce terme qui désigne le lent processus par lequel la terre peut parfois s’enfoncer à force de poids sur la surface terrestre (cf. les développements de Camille Ammoun sur ce point), en partie incontrôlée, sauf par les petits soldats anonymes de la maintenance, les héros silencieux actuels. Chez Ogero c’est une situation qui se traduit par des pannes, une maintenance à trous, une surveillance défaillante des infrastructures qui amènent certains à voler les câbles. Tout autre chose que de l’événement (géo)politique, plutôt du pur fait divers et des micro-événements.
Tout semble avoir reculé d’un cran: les ressorts habituels d’un pays où tout était surpolitisé, où la politique dictait tout, où le moindre fait divers pouvait faire l’objet d’une lecture géopolitique en surplomb, apparaît comme la façade désormais délavée, comme le sont les affiches politiques dans les rues au fil des ans, derrière laquelle s’agite l’ordinaire de bricolages situés. Des manières de vivre et survivre négociées au jour le jour, multipliés à l’échelle de chaque individu, par une foule d’anonymes qui n’ont pas le temps de se constituer en sujet politique et collectif à une échelle nationale.
D’autant plus quand c’est souvent, comme corps intermédiaire, la famille qui est devenu le lieu du conflit, du politique et de l’économie (bien plus que les confessions en réalité, ce que la grande sociologue Suad Joseph a beaucoup travaillé). La crise se joue à l’intérieur des familles, avec des envois depuis l’étranger, avec des patrimoines au Liban qui en ce moment changent de main à grande vitesse. De nombreuses familles se déchirent, s’arnaquent, et dilapident des héritages en interne, tout en s’efforçant de garder une façade collective au besoin.
La violence dans le flou
Enfin, le rapport à la violence ne fait pas exception, il est pris dans des logiques de mise en scène permanente et de déclarations tonitruantes qui ne permettent pas d’y voir clair (et paraissent parfois laisser de côté des questions évidentes : comment ferait-on une guerre quand plus personne n’a d’argent par exemple). Les affrontements de Tayouneh en octobre 2021 par exemple, n’ont pas eu l’honneur d’avoir leur chronotope et apparaissent rétrospectivement assez anecdotiques, voire marqués par une dimension théâtrale bien réglée qui en a limité les victimes malgré les armes lourdes engagées – tiraient-ils alors trop mal ou trop bien? – et autorisait en retour des badauds à observer ça à quelques mètres des combattants presque sans s’inquiéter, voire un livreur de sandwich à ne pas se méfier et à tomber d’une balle perdue (mais aussi qu’en amont une autre personne juge bon de commander un sandwich dans cette situation – vrai mystère). De l’avis d’un militaire sur ce point, observateur direct de la scène, ce qui en ressortait surtout a été le professionnalisme du Hezbollah, prêt à envoyer des centaines d’hommes et qui ne l’a pas fait, prêt à en perdre quelques-uns pour montrer aussi son sérieux politique, charge à la poignée d’ultras d’en face qui pensaient redonner une fierté à leur communauté de cesser rapidement leur manège.
De l’autre côté aussi les incertitudes règnent. Dire par exemple que le Hezbollah a acquis une expérience en Syrie, ou a fortiori en 2006, n’a plus la même valeur aujourd’hui, les soldats d’alors ne sont déjà plus (et en fait depuis longtemps) les soldats d’aujourd’hui, et il n’est pas tout à fait certain que le Hezbollah ait la capacité bureaucratique de transmission d’expériences qui fait déjà souvent défaut à des armées de métier, encore plus quand cette organisation ne peut pas vraiment dépasser une certaine limite dans ses manœuvres et entrainements à l’air libre (d’où un doute certain sur ses « 100,000 hommes », qui représentent sûrement bien plus l’ensemble des personnes passées un jour par un camp d’entrainement depuis plusieurs années qu’une force mobilisable sur le terrain immédiatement). De fait les membres du Hezbollah tués récemment ont tous des visages qui trahissent leur jeunesse.
C’est une chose de pouvoir invoquer cette possible expérience contre les autres camps politiques au Liban, désormais fort éloignés de la moindre pratique sérieuse et professionnalisée de la violence en comparaison, au point qu’ils soient seulement capables de s’attaquer aux communautés déjà fragilisées (réfugiés syriens ou communautés LGBT, durement éprouvées récemment) plutôt qu’à leurs ennemis déclarés. Habitués patibulaires des monceaux de salles de sport du Liban et représentants d’une politique de la gonflette, ces anti-hezbollah primaires, adversaires rêvés pour le mouvement, ne sont pas de véritables familiers de l’entrainement militaire à proprement parler (et si, même les milices c’était mieux avant).
C’est une autre chose de pouvoir l’opposer contre une armée israélienne, en plus sur un terrain de guérilla et de maquis qui n’aurait plus rien à voir avec les combats urbains en Syrie justement, contre une armée plus que professionnalisée, dans laquelle on n’a pas oublié que 2006 a été une victoire tactique de leur part interprétée comme une défaite stratégique qui a donné la victoire au Hezbollah, faisant mécaniquement monter les enchères pour l’avenir : pour faire reconnaître une victoire du point de vue israélien, il faudra donc frapper plus fort ? C’est cette promesse morbide que tout le monde a en tête aussi au Liban, où l’on ne sait plus vraiment ce qu’un tel événement perturberait, faute d’avoir une idée de ce que sont les structures économiques ou politiques ou militaires qu’il viendrait faire trembler, et en ayant très peur de ce qu’elle pourrait révéler des fragilités acquises depuis 2006, la guerre en Syrie en 2011, plus encore les crises depuis 2019, qu’on finit par ne plus voir à force de repeindre les façades.