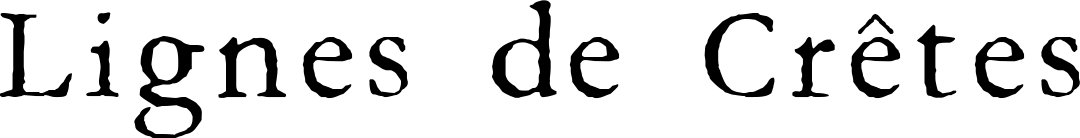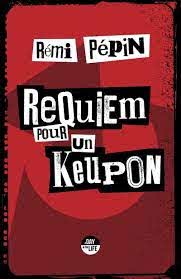C’est une histoire de chaînon manquant.
Une histoire anecdotique passée à la trappe de nos mémoires collectives, un bref laps de temps entre la grande histoire révolutionnaire inaugurée en 68 et puis les attentats de 86 et la chute du Mur de Berlin où émerge celle du nouveau paradigme érigé en récit explicatif, la guerre des Civilisations .
C’est l’histoire d’un bref moment où une jeunesse arrive dans un monde où tout semble avoir déjà eu lieu et s’être échoué dans une banlieue pas encore objet d’histoire, dont on ne se revendique pas parce qu’il ne s’y passe rien. C’est l’histoire d’une jeunesse, au fond, pas si importante numériquement parlant, qui a écrit un destin bien peu historique, à l’ombre du mur de Berlin, symbole de l’échec du communisme, dans le sillage de parents ayant expérimenté toutes les transgressions possibles après 68 pour finalement divorcer et acheter un pavillon, tout en allant à des manifs un peu tristes pour le principe.
C’est dans un bout d’éternel présent non identifié qu’une jeunesse décide de déclarer le futur impossible. Mais pas avec de grandes envolées tragiques, plutôt dans un joyeux bordel , dans un élan créatif où bizarrement, l’on jette aux orties toute issue positive tout en déployant une immense énergie créative et romanesque.
Donc ça s’appelle Requiem pour un keupon, mais c’est tout sauf un requiem triste. Plutôt un carnaval des damnés et heureux de l’être.
Une histoire de musique ? Comme disaient les parents , mais ce n’est pas de la musique. Clash et les anglais, oui ok, mais pas le punk français, mais pas ta boite à rythmes . Et effectivement, le bouquin s’ouvre sur un concert mythique , et une expérience musicale bouleversante.
Mais très vite, à travers la course d’un adolescent à travers Paris, c’est autre chose une histoire de vies. Une histoire de vies dehors, d’abord, car ce bref moment historique est peut-être d’abord celui de la liberté collective des adolescents. Pas de tous, évidemment,et pas sans contrôles de flics, mais la fin des années 70 et le début des années 80 sont quand même aussi cette époque, où encore de gauche une partie de la population trouve normal, ou au moins indifférent que des gamins de quinze ans sortent tard le soir, s’habillent à leur façon, ouvrent des squats, picolent et braillent devant des bars. Un époque d’avant l’internet, où l’on n’est pas obligé de dire aux gosses de sortir au lieu de squatter les écrans, mais où au contraire dès qu’ils sont au collège, on ne les voit plus guère à la maison. Une époque où l’on rencontre quand même plein de monde, cent fois moins évidemment que sur Snap ou Instagram mais en vrai.
Peut-être le plus important n’est-il donc pas la musique mais les paroles. Chanter le néant, le désenchantement, la violence, la transgression, sans être dieudonniste ou fasciste, luxe révolu de nos libertés perdues à force de trop les user sur les comptoirs sales de l’extrême-droite.
Le punk dézingue tout, et d’abord le futur, et d’abord l’espoir, il est sale, il se vautre dans la laideur, dans les addictions, dans la violence un peu gratuite. Mais il a aussi sa naïveté absolue , dévastatrice positivement, celui des énumérations où l’on se persuade vraiment qu’il est possible de saluer le rebelle afghan et le punk anarchiste, le toxico et tonton Albert. De créer à partir des souffrances et des oppressions , un cortège des éclopés, des fous, des malades de l’amour, des rescapés des grandes utopies, de trouver la voie étroite, absolument radicale entre le stalinisme et le fascisme.
Nous n’étions que quelques milliers dit Rémi Pépin, on se croyait plus. A tort, vous étiez plus. Simplement, nous ne sommes pas tous sortis de nos banlieues pour aller écouter les Béru en live. Nous n’avons pas tous fait un groupe, d’ailleurs on s’en foutait de la musique. On buvait juste les paroles, dans nos chambres de gamins et de gamines timides, après qu’un grand ou une grande qui prétendait avoir vu le squat des Cascades en vrai nous ait passé une cassette. On décidait juste après avoir écouté « Vivre Libre ou Mourir » et « Panik » qu’un jour, dans six mois, on foutrait le camp de la baraque, qu’on mourrait très vite mais pas avant d’avoir vécu à toute vitesse. Qu’on ne travaillerait jamais, qu’on ne respecterait jamais la police, qu’on habiterait dans un squat , qu’on ne serait jamais riche comme les connards, qu’on n’aurait pas de pavillon et qu’on emmerderait le Front National à tout jamais.
La majorité d’entre nous ont surtout bu de la Valstar, tenté une teinture ratée, et toutes sortes de drogues, acheté des Docs aux puces de Clignancourt, et espéré que quelqu’un remarque qu’ils étaient devenus punks, et n’étaient plus juste des filles violées, des ados maltraitées et timides, des gosses qui crèvent d’ennui et de désespérance entre deux tours grises d’une banlieue rougeâtre.
La plupart du temps, personne n’a rien remarqué de nos treize ou quinze ans, objectivement. Nous étions la génération à qui l’on promettait plein de choses follement amusantes, l’overdose, le SIDA, le chômage. Nous étions la génération à qui nos parents n’avaient souvent rien à apprendre, où du moins le croyait-on à part le vécu des crises économiques , de la déception finale de la gauche, la trahison de Mitterrand et la chute du communisme qui s’incarnait pour nous autant dans le maire et ses milices anti-toxico que dans la chute du Mur. Nous étions la génération qui ne pouvait pas se payer les rêves bling bling de ces années là, partir aux vacances au ski, mettre des Chevignon et du Naf Naf, bronzer artificiellement et faire du ski nautique.
La génération après l’héro et juste avant le rap. Ne sachant pas forcément ce qu’était être issu de l’immigration, entre petites mains jaunes déjà un peu dévaluées ( mais c’est moi le pote ?) et échos des émeutes, ailleurs, dans d’autres cités, dans la nôtre, il ne se passait rien, à part le voisin qui n’aimait pas les maghrébins. Mais nous avons eu les Béruriers Noirs, et Ludwig von 88, et la Mano Negra, et les Négresses Vertes, contrairement à Rémi Pépin , nous ne savions pas que tout cela était déjà un peu fini, un peu commercial. Nous on s’est sentis un jour de vrais rebelles, des gamins qui vomissaient le monde tel qu’il était. On s’est trouvés un destin.
Et donc on lit Requiem pour un Keupon sans nostalgie aucune de nos jeunesses pas mythiques du tout, mais avec le plaisir de recoller les morceaux d’une histoire qui fut un peu la nôtre. Nous, qui sommes restés de gauche, et qui en lisant l’errance de ce petit fils de prof qui en fait une grande aventure épique nous rappelons brusquement pourquoi, et dans ce 2020, quand même très, très à droite, le souvenir de la filiation est bienvenu.
Evidemment pas Mitterrand, évidemment pas François Hollande et encore moins Mélenchon, pourquoi pas Ségolène Royal, si on va par là ? Evidemment pas les partis exsangues, le PS se demandant pendant vingt ans comment être de droite, la gauche radicale trouvant que radical ça pourrait être aussi faire un Front National mais avec le droit au travail et à une retraite bien méritée à se regarder les spectacles de Dieudonné.
Ce n’est pas de là que vient notre internationale, mais de ce salut à tous les zazous, à la Jeune Garde Rouge et à l’handicapé, et à l’endimanché, de cet amour éternel pour les petits agités, de cette culture des dingues et des paumés qui croyaient en même temps qu’un jour la raïa serait le genre humain, et qu’il y aurait pas de futur en Europe, et que les rebelles y croupiraient dans les bunkers de l’isolement.
C’est ce qu’on fait, mais joyeusement, et Requiem pour un keupon, c’est un magnifique bouquin mais un titre à la con, monsieur Rémi Pépin, toi même tu le dis, déjà en 77 on te disait que le punk était dead. Mais non, on est là, avec des fantômes, qui se foutraient de nos gueules et vomiraient sur nos pompes si on versait notre larme sur leurs morts précoces, et nous diraient hé regarde toi, t’as même voté Macron pour éviter le Front National et tu t’achètes des bouquins sur le punk chez Kindle, j’ai bien fait de partir avant pour pas voir ça. Et on en rirait, et on dirait OK OK, nous avons été une jeunesse qui avait le sens de l’auto-dérision, au moins cela.
Requiem pour un keupon, Rémi Pépin, éditions le Castor Astral.