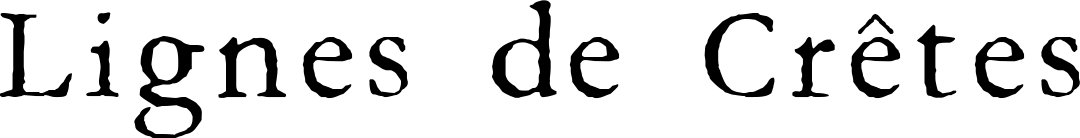L’émission de Mediapart dans laquelle l’actrice Adèle Haenel est intervenue le 4 novembre dernier pour témoigner de l’agression pédocriminelle dont elle a été victime était un grand moment de télévision. Des témoignages filmés de victimes et imprégnés d’une telle tension étaient advenus au cinéma – jamais, semble-t-il, sur un plateau de télévision.
Dans un État de droit, les témoignages des victimes de violences sociales et politiques sont censés avoir leur place d’abord au sein de l’institution judiciaire. Mais encore faut-il qu’ils soient effectivement audibles par la justice – et que l’on puisse donc compter sur celle-ci pour engager une procédure visant à punir les coupables et à accorder réparation aux victimes. Or on sait bien que tel n’est pas toujours le cas, loin s’en faut – quand bien même la législation et les décrets d’application existent qui le permettraient. C’est ainsi que depuis le XIXe siècle des pratiques testimoniales calquées sur le modèle de la déposition en justice se sont beaucoup développées hors des enceintes des tribunaux – en particulier dans des publications en livres de littérature. L’utopie de celles et ceux qui témoignent est alors de s’adresser à toute la société et de permettre une prise de conscience collective, de sorte qu’à l’avenir les violences du passé soient jugées, ne serait-ce que par le tribunal de l’histoire, et que, devenues intolérables pour tou·tes, elles ne puissent plus se reproduire.
Le parti qu’Adèle Haenel a pris de livrer un témoignage médiatique à Mediapart, d’abord à l’écrit dans l’article de Marine Turchi du 3 novembre puis en personne dans l’émission du lendemain, procède d’un tel projet, dans la poursuite du mouvement #MeToo. Il n’est pas indifférent à cet égard qu’un des aiguillons de son témoignage ait été l’effroi que lui a inspiré soudain l’impunité de son agresseur Christophe Ruggia. Elle n’a pas voulu adresser son témoignage à une justice française défaillante qui, ne protégeant pas les femmes victimes de violences sexuelles (« un viol sur cent » débouche sur une condamnation !), exerce une « violence systémique » contre elles. À l’issue d’un cheminement personnel de plusieurs années et d’une enquête journalistique de sept mois, elle s’est saisie de la tribune que lui offrait Mediapart non seulement pour que les bourreaux se regardent en face mais pour que toute la société, qui est impliquée, fasse de même – et qu’il apparaisse alors à tou·tes que l’institution judiciaire n’est plus « représentative de la société » et qu’elle doit être réformée [1].
Il a déjà été beaucoup dit – et ce, durant l’émission elle-même – qu’il y a désormais « un moment Adèle Haenel » tel que les choses ne seront plus jamais comme avant, ni dans le cinéma français, ni plus généralement dans la société française. De fait, pour ce qui est du milieu du cinéma du moins, la prise de parole d’Adèle Haenel a fait l’effet d’une déflagration aux retombées quasi immédiates dans l’espace public, comme l’attestent successivement le communiqué de la Société des réalisateurs de films du 4 novembre et l’impossible promotion du film J’accuse suite au témoignage de la photographe Valentine Monnier publié par Le Parisien du 8 novembre, qui constitue la sixième accusation de viol à l’encontre de Roman Polanski. Par la voix de la SRF, le cinéma français a fait savoir qu’il s’engageait à faire son propre examen critique, outre qu’il initiait en association une procédure de sanction professionnelle visant Christophe Ruggia. Quant au témoignage de Valentine Monnier – soutenue sans ambages par Adèle Haenel –, il a commencé de mettre à l’épreuve cet examen critique annoncé, permettant d’entrevoir que le mouvement #MeToo pourrait enfin connaître de vraies répercussions en France.
Abus sexuels et harcèlements : @LaSRF1968 appelle à des Etats généraux @Collectif5050 @LeCNC @MinistereCC
#assises5050 #parité #diversité #inclusion
Communiqué : pic.twitter.com/Fzuqe1ykQ4— LaSRF (@LaSRF1968) November 15, 2019
Ce « moment Adèle Haenel », c’est ainsi pour l’essentiel un moment d’écoute et d’effectivité sociale de son témoignage, comme par exception. Or c’est ce qu’il m’intéresse d’étudier ici, eu égard au fait que les pratiques testimoniales des victimes se sont constamment heurtées dans l’histoire et continuent de se heurter à l’inaudible. Qu’est-ce qui fait que dans ce cas précis non seulement on prête attention mais on donne du crédit à la parole de la témoin ? Je voudrais mettre en lumière la pertinence et la justesse des choix opérés par Adèle Haenel, ainsi que le rôle décisif joué par le journal multimédia qui a accompagné sa démarche. Nous avons eu affaire à une prise de parole exemplaire qui rappelle le rôle nécessaire des témoignages de victimes dans le bon fonctionnement de la vie démocratique d’un pays.
De l’intérêt public du témoignage médiatique
Il faut revenir sur le choix du témoignage médiatique qui est au commencement et qui n’a rien d’excentrique. Depuis le XIXe siècle, les pratiques testimoniales de victimes qui ont accédé à la sphère publique ont été tributaires de l’essor des techniques liées à l’imprimé – et au journal autant qu’au livre. Avant la guerre de Sécession aux États-Unis, les ancien·nes esclaves africain·es-américain·es sont parvenu·es à écrire ou à faire écrire puis à éditer en livres leurs témoignages grâce au soutien des associations abolitionnistes et de leurs journaux qui ont annoncé, soutenu par des appels à souscription, imprimé, cité par pages entières voire publié intégralement dans leurs colonnes, recensé et vendu dans leurs locaux ces récits de servitude. On retrouve des exemples au XXe siècle d’un tel rôle joué par la presse ; c’est, parmi d’autres, celui des journaux arméniens de différents pays qui ont appelé, édité en feuilleton et promu des témoignages, exceptionnellement pendant et surtout après le génocide des Arméniens perpétré dans l’ancien Empire ottoman. Mais il faut ajouter à cela un autre phénomène médiatique qui conditionne la possibilité du témoignage d’Adèle Haenel, et qui est relatif à la montée en puissance de la figure du reporter depuis la seconde moitié du XIXe siècle.
Depuis les origines du reportage, on a vu se construire et se développer une éthique du reporter qui consiste, pour « faire voir le caché » des violences sociales et politiques, à faire entendre les voix de celles et ceux qui en sont les victimes – et qui le plus souvent ne se sentent pas légitimes à prendre la parole. Il est alors arrivé par exception qu’un travail d’enquête de longue haleine sur un sujet conduise un·e reporter à mettre en exergue un témoignage individuel, dont il/elle a reconnu toute la valeur d’exemplarité tout en pariant dans le même temps sur la force singulière. Cela s’est vu dans la presse écrite aussi bien que dans le cinéma documentaire. Récemment, c’est ce qu’a fait Florence Beaugé en publiant le témoignage de Louisette Ighilahriz sur son expérience de la torture par l’armée française en Algérie en 1957 dans Le Monde du 20 juin 2000; ce qu’a fait Annick Cojean en publiant le témoignage d’Hasna al-Hariri, qui décrit l’arme de guerre du viol dans les centres de torture du régime syrien, dans Le Monde du 5 décembre 2017; et c’est donc ce qu’a fait à son tour Marine Turchi en publiant le témoignage d’Adèle Haenel dans Mediapart du 3 novembre 2019 [2].
Ce dernier témoignage est le fruit de la rencontre inopinée, un soir d’avril 2019, entre la victime, hantée par les violences sexuelles qu’elle a subies de 2001 à 2004 alors qu’elle était encore une jeune adolescente, et la reporter, dont le travail journalistique porte notamment sur les violences faites aux femmes depuis qu’elle a rejoint le service « Enquêtes » de son journal en 2017. Sur son blog puis dans l’émission, Marine Turchi a fait le récit de cette rencontre et de la façon dont, comprenant cette spécialisation de la journaliste de Mediapart, Adèle Haenel a aussitôt « débit[é] son récit comme une urgence » – d’ailleurs devant d’autres femmes présentes qui n’en revenaient pas.
Ce qui s’est scellé dans ce moment consiste en une alliance de la témoin et de la reporter. Un témoignage unique ne pouvant être accepté dans le journal sans examen, il s’est agi d’un commun accord de procéder à une enquête afin de l’étayer et d’en justifier ainsi la publication dans « un article d’intérêt public » (ibid.). Comme nous allons le voir, cependant, cet « intérêt public » ne tient pas seulement à ce qui contribue à donner valeur de preuve au témoignage, grâce notamment à un faisceau de récits concordants livrés par des témoins tiers/ces. Il réside également dans ce que l’enquête fait ressortir de l’attitude de ces dernier·es au moment des faits incriminés et qui contribue à ce que ceux-ci se perpétuent dans nos sociétés. Ce que ne prévoyait sans doute pas Adèle Haenel, en outre, du moins dans le premier temps de son alliance avec Marine Turchi, c’est que, confié à un journal d’information numérique tel que Mediapart, son témoignage aurait la possibilité d’être à double détente : dans un article qui le restitue par écrit puis dans une émission en direct où il se réarticule et s’analyse à chaud.
Au crédit du témoignage : travail d’attestation et vérité incarnée de la témoin
Au fondement de la publication était donc la fonction d’attestation du témoignage [3]. Les témoignages en général, ceux des victimes en particulier, sont une source relativement fragile qui nécessite beaucoup de soins et de précautions. C’est d’autant plus vrai que cette fragilité intrinsèque les expose à l’esprit de défiance. Celui-ci ne date pas d’hier ; observant que « [l]e malheureux qui va sans cesse doutant de tout et de tous n’est d’ordinaire qu’un crédule trop souvent trompé », Marc Bloch mettait déjà en garde contre lui avant la Première Guerre mondiale. Cependant, malgré l’historien fondateur de l’École des Annales – et parfois même en osant se réclamer de lui –, cet esprit de défiance fait florès aujourd’hui dans nos sociétés et leurs institutions. À l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), il règne en maître sur les destinées des personnes migrantes qui entreprennent de faire respecter leur droit d’asile. Si le taux de protection n’était que de 27 % en 2017 et 2018, c’est bien spécialement parce que, par principe dans cette institution, l’on n’accorde guère de crédit à leurs récits.
Or c’est bien ce qui contribue aussi à expliquer le taux calamiteux, dénoncé par Adèle Haenel, de condamnations pour viol en France. Quand, dans l’émission du 4 novembre, elle évoque qu’« [i]l y a tellement de femmes qu’on envoie se faire broyer, soit dans la façon dont on va récupérer leur plainte, soit dans la façon dont on va disséquer leur vie et porter le regard sur elles », celle-ci décrit très exactement les processus par lesquels les institutions policière et judiciaire travaillent de concert à discréditer les récits des victimes [4]. Prendre soin des témoignages, alors, ne consiste pas dans un acte de foi qui les soustrait à la critique des sources, comme s’il s’agissait de sacraliser la parole des victimes. Au contraire, comme le fait Marine Turchi, cela revient à se livrer à cette critique, sachant qu’elle est « [l]’art de discerner dans les récits le vrai, le faux et le vraisemblable » (Marc Bloch, art. cité) et qu’elle se met donc de facto au service des témoins sincères.
Au demeurant, ce qui est saisissant dans le témoignage d’Adèle Haenel, c’est de comprendre qu’il est le fruit d’un long travail vers toujours plus d’exactitude. Il ne faut pas oublier l’âge de l’actrice, de 12 à 15 ans au moment des faits de 2001 à 2004, pendant et après le tournage des Diables (2002), son premier film ; son âge, et la différence d’âge avec son agresseur, Christophe Ruggia, réalisateur du film, âgé alors quant à lui de 36 à 39 ans. De ce point de vue, le temps écoulé de 2004 à 2019 n’est pas à concevoir seulement comme un temps de la hantise mais aussi comme un temps de la réflexion qui a permis progressivement à Adèle Haenel, dans l’interlocution, de se représenter clairement à elle-même les violences qu’elle a subies et de pouvoir les formuler comme une déposition. Rétrospectivement, aujourd’hui, Adèle Haenel est en mesure d’expliquer qu’elle a vécu les faits de violence dans un état d’aliénation tel qu’elle a d’abord été dans l’incapacité de s’y soustraire et, longtemps après encore, dans celle de les nommer. Ce qui fait la force de son témoignage, ainsi, ce n’est pas seulement la description précise qu’elle livre des gestes pédophiles de Christophe Ruggia ; c’est en outre l’analyse fine qu’elle est en état de produire désormais du système d’emprise de son agresseur, et par conséquent la description lucide qu’elle livre aussi de sa façon à elle de vivre les choses sous emprise à l’époque.
Fondamentalement, l’emprise consiste dans une entreprise de chosification. Il s’agit de priver l’autre, que l’on veut soumettre à sa domination, de sa faculté de penser par soi-même et donc de juger et de décider de ce qui lui arrive; l’enjeu est de couper l’autre de son expérience. Comme Adèle Haenel l’expose dans l’émission, c’est un abus de pouvoir qui provoque une peur viscérale terriblement tenace. Ce phénomène d’emprise s’observe beaucoup dans les violences de couple et la maltraitance des enfants ; il naît parfois à l’occasion de relations professionnelles dans lesquelles l’homme exerce un magistère. C’est le cas de figure auquel Adèle Haenel a été confrontée, dans le milieu du cinéma. Ce qui est intéressant à remarquer, c’est que, dans son odieux « droit de réponse », Christophe Ruggia ne l’a pas démenti. Sur les conseils de son avocat, il a cru pouvoir nier les faits de pédophilie tout en admettant avoir « commis l’erreur de jouer les pygmalions » et en revendiquant d’ailleurs fièrement le statut de « découvreur » de l’actrice et de son « grand talent » [5].
Au fond, ce qui est à l’œuvre ici n’est rien d’autre que la continuation de la stratégie destructrice initiée quand Adèle Haenel n’était encore qu’une jeune adolescente. L’abus de pouvoir était à l’époque d’autant plus lâche que Christophe Ruggia n’était pas seulement un adulte mais un réalisateur de films et qu’aux yeux de l’enfant qui rêvait de cinéma, il était ainsi « une sorte de star, avec un côté Dieu descendu sur Terre » [6]. Or la stratégie consistait déjà à nier les faits dans le temps qu’ils se produisaient. Nier les faits, c’est en effet souvent les falsifier de façon à les faire passer pour autre chose que ce qu’ils sont. Le problème de Christophe Ruggia est que la relation pédagogique qu’il avait nouée avec Adèle Haenel en la formant au métier d’actrice s’est vite transformée en désir de possession. C’est bien le sens du nom de Pygmalion invoqué par le réalisateur aujourd’hui. Il s’est alors agi de recouvrir la réalité de ce désir de deux façons : en le faisant passer pour du don, d’une part ; en le faisant passer pour de l’amour réciproque, d’autre part. Le discours amoureux de Christophe Ruggia était un empaquetage hermétique et correct, presque noué de faveurs roses, de ses attouchements et de son harcèlement sexuel. Quant au discours du don, il avait vocation à faire culpabiliser l’adolescente, qui était décidément « une sacrée garce de ne pas jouer le jeu de cet amour après tout ce qu’il [lui] avait donné ».
Comme on peut l’observer, le travail d’attestation produit par Adèle Haenel est d’autant plus crédible qu’elle ne se contente pas d’énoncer les faits et de produire des documents mais qu’elle fait parler les uns et les autres. Même quand elle évoque les effets destructeurs durables de ces violences sexuelles, elle ne se départit pas de son souci de s’adresser à notre intelligence. Ce sont les bourreaux qui, jouant les victimes, versent dans le pathos ; ainsi Christophe Ruggia se complaît-il dans son rôle d’amoureux éconduit dans les lettres qu’il a adressées à Adèle Haenel après qu’elle l’avait fui. On se demande bien pourtant pour qui son « amour pour [elle] » a été « trop lourd à porter » (ibid.).
Car, tandis que lui a poursuivi sa carrière de cinéaste engagé comme si rien n’était, c’est elle qui a survécu difficilement, se murant dans le silence, décidant malgré elle d’« arrêter le cinéma », et plongeant en somme dans un « énorme mal-être ». Or rien n’est plus éloigné du projet testimonial d’Adèle Haenel que de vouloir nous inspirer de la pitié. Lorsqu’elle veut nous faire comprendre ce moment de sa carrière où, en dépit de sa passion du jeu d’actrice, elle « quitte son agent, ne donne suite à aucun scénario ni casting, et coupe les ponts avec le milieu du cinéma » (ibid.), c’est parce que cette décision radicale nécessaire à sa survie, qui est documentée, est un élément supplémentaire qui vient conforter son témoignage. C’est pourquoi le préjugé selon lequel un tel témoignage médiatique « fonctionn[e] sur l’émotion » est erroné, en ce qu’il essentialise dans une même disqualification les médias et les victimes qui témoignent, requalifiées en « héroïne[s] contemporaine[s] médiatique[s] » [7].
Il n’est pas question ici de dire que l’émission du 4 novembre n’a pas été chargée d’émotion. Mais je ne vois pas au nom de quoi ce serait à mettre à son discrédit. Il n’y a évidemment pas lieu de condamner les émotions en les opposant de manière factice à la raison, comme si l’on pouvait faire que les êtres humains ne soient plus doués de sensibilité. Ce qui est problématique ne réside pas dans les émotions en elles-mêmes mais dans leur instrumentalisation. C’est ce j’ai désigné à l’instant en parlant de « pathos », soit une recherche d’effet qui se donne l’émotion pour fin en soi. Le pathos est spécialement le propre de l’économie spectaculaire, qui procède du kitsch. Or ce qui ressort des différents corpus testimoniaux édités depuis le XIXe siècle, c’est que l’art du témoignage se situe aux antipodes d’une telle économie. Même lorsqu’il est l’œuvre de condamné·es à mort encore au milieu du danger, cet art testimonial se caractérise par le « refus du gigantesque et de l’apocalyptique » [8]; il ne viendrait pas à l’idée des témoins de mimer les violences qu’elles/ils ont subies par une esthétique du choc, comme pour infliger celles-ci aux lecteurs/rices. De ce point de vue, il convient de louer le long format de plus d’une heure d’émission consacrée exclusivement au témoignage d’Adèle Haenel – d’ailleurs étonnée elle-même de ce temps dont elle disposait lorsqu’elle s’est souciée de pouvoir lire sa « lettre au père » d’avril dernier. Après le temps long de l’enquête, ce temps long d’exposition du témoignage est ce qui a permis à celui-ci de s’imprimer durablement dans la mémoire des récepteurs/rices.
Ce principe de sobriété du témoignage, précise Primo Levi, vient de ce que « c’est dans ces conditions seulement qu’un témoin appelé à déposer en justice remplit sa mission, qui est de préparer le terrain aux juges » [9]. Or c’est bien ce modèle de la déposition en justice qui préside à l’attitude d’Adèle Haenel durant l’émission. La tension que j’évoquais en ouverture de cet article tient précisément au fait qu’elle passe tout le temps de l’émission à lutter pour contenir ses émotions. Il n’est pas indifférent à cet égard qu’elle invoque le « calme » qui anime sa démarche en général. De fait, comme Levi, elle refuse de recourir « au pathétique de la victime ou à la véhémence du vengeur ». Afin de porter témoignage, elle a attendu ce moment où elle pourrait « parler des choses, sans en faire non plus un drame absolu » ; et dans ce sens elle se refuse dans l’émission à « diaboliser » et à traiter comme des « monstres » les hommes tels que Christophe Ruggia ou Roman Polanski.
La véritable émotion vient cependant inévitablement de l’action de se remémorer de tels faits vécus. Le témoignage se distingue du rapport en raison de ce travail de mémoire des survivant·es, qui, tel Robert Antelme, interposent entre leur expérience et nous « la grille […] d’une conscience allant jusqu’au bout » [10]. C’est pourquoi, suggère Walter Benjamin, « le véritable souvenir doit […], sur un mode épique et rhapsodique, donner en même temps une image de celui qui se souvient » [11]. Seule cette conscience au présent des faits rapportés peut nous les donner à saisir dans toute leur réalité sensible, depuis le point de vue de la victime. Or, quel que soit le lieu où elles/ils portent témoignage, que les survivant·es nous fassent ainsi toucher le réel sans le dépouiller de la « tunique brûlante dont il [est] enveloppé » [12] provoque un moment de stupeur. C’est ce qui est troublant à la lecture des témoignages écrits, qui conservent la trace de ce moment où les témoins vacillent à l’évocation d’un passé soudain si prégnant. Mais c’est peut-être ce qui est plus troublant encore si l’on est en présence des témoins qui se souviennent, ou que leur remémoration est enregistrée par une caméra.
Car la mémoire s’inscrit aussi dans les corps de telle façon que les violences du passé apparaissent tels des stigmates. Nulle mystique dans cette analyse, mais le diagnostic que le témoignage advient dans un temps dialectique où la distance qui sépare le passé de la violence subie du présent de sa remémoration se maintient tout en s’abolissant. C’est ce qui explique à mon sens l’effet d’inquiétante étrangeté produit par la témoin Adèle Haenel dans l’émission du 4 novembre. L’effort pour contenir ses émotions consistait à maintenir le passé à distance, et c’est ce qui a donné à son expression ce caractère si frappant de protestation individuelle ; où se lisait toute sa détermination à contribuer à la connaissance de ce qui lui est arrivé – et qui n’est qu’un cas de violence sexuelle parmi d’autres. Dans le même temps, ce qui ressurgissait du passé malgré elle ne faisait qu’authentifier encore davantage ce que son témoignage visait à attester, en laissant transparaître la peur panique de la jeune adolescente prise au piège de son agresseur. Dans ses yeux révulsés et sa gorge nouée, la vérité s’est incarnée.
Témoignage, enquête et critique sociale de la culture
Dans l’article du 3 novembre, le travail d’attestation d’Adèle Haenel, qui doit beaucoup à l’interprétation des faits dont elle s’est donné les moyens intellectuels, est en outre corroboré par le reportage de Marine Turchi. En citant les nombreux/ses témoins oculaires alerté·es par les comportements de Christophe Ruggia à l’égard d’Adèle Haenel, en citant aussi celles/ceux – parfois les mêmes – alerté·es par la longue crise traversée par celle-ci pendant et après les violences subies, la journaliste a de fait soigneusement préparé le terrain pour que la justice puisse s’emparer du dossier, comme le Parquet de Paris en a pris la décision le 6 novembre dernier suite au témoignage d’Adèle Haenel. C’est d’ailleurs ce que suggèrent les avocats de celle-ci après qu’elle a pris le parti de porter plainte, lorsqu’ils arguent que « de nombreux éléments ont été fournis pour permettre une enquête complète et minutieuse, au-delà du caractère très authentique de son récit ».
Adèle Haenel a décidé d’assumer ses responsabilités devant la justice après son témoignage et de participer ainsi activement à la réforme du système judiciaire qu’elle a appelée de ses vœux. Peut-être n’en aurait-elle pas ressenti la nécessité si Christophe Ruggia cheminait vers une reconnaissance de sa culpabilité. Mais nous l’avons vu plus haut, il ne chemine pas ; de façon humiliante pour sa victime, il demeure enfermé dans son système d’emprise et de négation. En cela, il est bien un bourreau ordinaire. Sa façon de se plaindre des « piloris médiatiques » dans son « droit de réponse » [13] campe déjà le personnage du persécuté dont Roman Polanski et tant d’autres se complaisent à endosser le rôle. Le problème pour lui, cependant, c’est que le procès pourrait bien donner l’exemple d’une justice qui fonctionne, représentative d’une société qui – contrairement à lui – s’est regardée en face. Parce que, comme Marine Turchi l’observe dans le making-of de son enquête, ce qui rend celle-ci si « singulière », c’est que les gens ont accepté de témoigner, et même de le faire « à visage découvert » – alors que « [t]rop souvent encore dans ces affaires, les témoins se défilent devant leurs responsabilités, préférant le confort du silence ».
Le résultat est intéressant en ce que nous disposons ainsi d’un faisceau de sources qui étaye la véridicité du témoignage de la victime. Mais c’est aussi le processus pour arriver à ce résultat qui est intéressant, car il suppose que, durant l’enquête, plusieurs personnes ont pris le parti de cheminer avec Adèle Haenel. Des personnes du milieu du cinéma, en particulier. Des personnes qui se sont mises à se sentir coupables, nous dit Marine Turchi dans l’émission. Qui avaient été gênées autrefois par la relation instaurée par Christophe Ruggia avec Adèle Haenel, mais qui n’avaient pas pris la mesure de ce qui se passait. Et qui à présent prennent conscience douloureusement qu’elles se sont voilé la face [14].
Ce qui est en jeu ici relève d’une analyse et d’une critique des conditions qui contribuent à banaliser les abus sexuels à l’encontre des femmes. Le témoignage d’Adèle Haenel et l’enquête de Marine Turchi qui l’accompagne ont ce pouvoir en particulier de démasquer nos représentations culturelles. De quelque point de vue que ce soit, il s’agit toujours d’un dispositif, appelé « culture du viol », qui produit de l’aveuglement volontaire. Ce dispositif repose spécialement sur un pouvoir de naturalisation de l’art, à une époque où Lolita de Vladimir Nabokov est devenu un classique et un best-seller de la littérature mondiale. Dans un texte de 1967, Nabokov a pris ses distances avec la « pensée noble, bien qu’évidemment ridicule », du premier éditeur français de son roman en 1955, Maurice Girodias, selon qui l’« ouvrage était susceptible de provoquer un changement dans les attitudes de la société à l’égard du genre d’amour qui y était décrit » [15].
Or, suggère Adèle Haenel dans l’émission, l’écrivain a apparemment sous-estimé cette réception licencieuse de Lolita et son effectivité sociale, car en l’occurrence Christophe Ruggia n’a cessé de se comporter avec elle en s’inspirant du parfum de scandale du roman, quand ce n’était pas des ruses de son narrateur pédophile Humbert Humbert pour se disculper. Suivant son analyse, ce que montre le cas de Christophe Ruggia, c’est que l’on peut se nourrir de cette culture au point de se persuader soi-même du discours sur l’amour et la séduction dont on enrobe la réalité. De là est venue assurément « sa fable du “nous, ce n’est pas pareil, les autres ne pourraient pas comprendre” », qui cultivait la légende d’un amour transgressif. Mais de là aussi est venue sa manie culpabilisante de traiter l’adolescente de petite allumeuse – comme lorsqu’il lui a « dit d’arrêter [ce tic de passer la langue sur sa lèvre], sur le mode : “C’est trop sexy, tu ne te rends pas compte de ce que tu me fais.” » (ibid.).
Le pouvoir de naturalisation de l’art, cependant, concerne aussi la valeur conférée aux arts (notamment au cinéma) et, corrélativement, l’aura de l’artiste (notamment du cinéaste). Il concerne, autrement dit, les rapports de domination qui s’instaurent dans la production artistique, au sein du champ comme en-dehors. Ce que fait ressortir l’enquête de Marine Turchi, c’est que l’analyse qu’il convient de faire des violences commises par Christophe Ruggia ne doit pas s’abstraire de cette critique sociologique relative au « pouvoir et [aux] pratiques [des cinéastes], sur les plateaux et comme collectif », comme semble l’avoir compris la SRF. De fait, cette critique s’adresse aussi bien au cinéma d’auteur à petit budget et réputé de qualité qu’à l’industrie cinématographique des grosses productions.
Si l’on écoute bien les témoins oculaires avec qui Marine Turchi s’est entretenue [16], ce pouvoir et ces pratiques sont bien la raison essentielle pour laquelle, telle Véronique Ruggia, elles/ils ont vu sans voir. Pendant le tournage du film Les Diables, plusieurs témoins appartenant au monde du cinéma ont été dérangé·es par l’« emprise » de Ruggia, requalifiée parfois en « ascendant évident » ou en « manipulation », mais elles/ils se sont laissé impressionner par l’autorité du réalisateur, qui invoquait une relation nécessaire au tournage du film et qui interdisait à quiconque de s’y immiscer . Elles/ils ont situé ce qui se passait « au niveau de la fabrication d’un film de cinéma », ont pensé que l’adage du milieu selon lequel « [l]es metteurs en scène […] doivent être amoureux de leurs actrices » se confirmait aussi avec une actrice de 12 ans et qu’en tout état de cause il n’était pas question de « contester le metteur en scène », qui « est le patron » (ibid.).
Ce dernier argument d’autorité peut étonner, venant en particulier d’un milieu d’intermittent·es du spectacle aux convictions majoritairement de gauche. Mais tel est souvent le hiatus que l’on peut observer, dans bien des milieux, entre les opinions et les pratiques. À cet égard, le conservatisme propre à la corporation des professionnel·les du cinéma est en cause dans ce qui est arrivé à Adèle Haenel. Car Christophe Ruggia n’a pas été seulement protégé par la toute-puissance mythique de l’artiste relative à son processus de création. Il a aussi été protégé de façon pragmatique par son statut d’employeur, qui explique que certains « racontent avoir eu peur que leur contrat ne soit pas renouvelé ou d’être “blacklistés” dans ce milieu précaire » (ibid.).
En définitive, dans la galère du petit cinéma d’auteur, ce sont ainsi des relations d’interdépendance qui se tissent, où le discours du don que Ruggia a servi à Adèle Haenel pour tenter de la soumettre à sa volonté trouve une résonance collective. « [D]es connaissances communes siégeant à la SRF » ne se sont d’ailleurs pas privées de se faire l’écho de ce discours pour imposer le silence à la victime [17]. Quant à savoir « [ce] que faisaient les adultes sur ce tournage », dès lors, il en ressort que l’aveuglement volontaire a été aussi affaire de servitude volontaire, non pas seulement à l’égard de l’individu Ruggia spécifiquement mais encore à celui du collectif du cinéma et de ses pratiques d’omerta. C’est ce que Marine Turchi a tenu à faire apparaître dans le titre de son article du 3 novembre, lorsqu’elle énonce que « l’actrice Adèle Haenel brise un nouveau tabou » [18].
Mouvement social #MeToo et responsabilité testimoniale
Rendre justice au témoignage d’Adèle Haenel implique cependant de revenir sur l’autre partie du titre – « #MeToo dans le cinéma ». Comme y invite Marine Turchi, il importe en effet d’inscrire l’action de cette prise de parole dans la continuation du mouvement social féminin né à l’automne 2017 en réaction à l’affaire Weinstein aux États-Unis. Dans l’émission, Adèle Haenel a tenu dans ce sens à rendre hommage à toutes les femmes victimes de harcèlement et/ou d’agression sexuelle qui ont témoigné depuis lors. De fait, d’octobre 2017 à octobre 2018, elles ont été plusieurs millions à sortir de leur isolement en publiant sur les réseaux sociaux le récit, souvent rédigé avec soin, des violences qu’elles avaient subies ; rien que sur Twitter, suite à l’appel lancé par Alyssa Milano le 15 octobre 2017, le hashtag #MeToo a comptabilisé en un an 17,2 millions de tweets. « Si toutes les femmes qui ont été harcelées ou agressées sexuellement écrivaient “Moi aussi.” comme statut, nous pourrions donner aux gens une idée de l’ampleur du problème », avait suggéré l’actrice américaine.
Or l’action de publier son récit a aussitôt pris une valeur politique en s’inscrivant dans ce projet collectif, suivant l’esprit qui animait déjà depuis 2007 le me too Movement sous l’impulsion de Tarana Burke. Dans près d’une centaine de pays, le mouvement social a alors révélé que les violences faites aux femmes ne sont pas l’exception (à reléguer dans la rubrique journalistique des « faits divers ») mais la règle. Que partout le « problème » « n’épargne aucune classe sociale, aucun milieu » et concerne donc indifféremment toutes les femmes – et ce, dans toutes les situations de leur vie sociale, privée et publique.
À ce moment-là, Adèle Haenel n’était pas prête à porter témoignage, comme elle l’a confié à Marine Turchi [19]. Mais l’hommage qu’elle a rendu le 4 novembre équivaut à une reconnaissance de dette envers le mouvement, qui marque un tournant. Car c’est vraiment de cette action collective que l’on peut dater la construction sociale d’un intolérable relativement aux violences subies par les femmes. Ce n’est sans doute pas le moindre paradoxe de notre époque que, tandis que partout la défense des droits humains subit de sérieux revers [20], celle des droits des femmes ait connu un tel coup d’accélérateur. De façon générale, le fait de prendre la mesure d’une telle situation d’injustice à peine entrevue jusqu’alors est déjà en soi une transformation, en ouvrant une ère où le respect effectif des droits des femmes peut devenir la règle. Le problème est cependant que la prise de conscience a été contrastée d’un pays à l’autre. En France, on a eu coutume – comme l’a fait un collectif de femmes en janvier 2018 – de renvoyer dos à dos les victimes et les bourreaux en dénonçant dans le mouvement un féminisme pétri de « haine des hommes et de la sexualité ». Le bilan du mouvement que l’on pouvait dresser en France après un an était amer, par comparaison avec l’effet de révolution culturelle observé aux États-Unis [21]. Or c’est ce qu’Adèle Haenel s’est mis en tête d’essayer de corriger.
C’est peut-être dans sa façon de relever ce défi qu’Adèle Haenel a été la plus bluffante. On ne témoigne pas de la même façon d’une violence qu’on a subie si l’on sait ce cas exemplaire de la réalité. Dans ce sens, comme toutes les femmes qui ont participé au mouvement #MeToo, Adèle Haenel a pris la parole par délégation, au nom des autres; sachant que les violences dont elle témoignait sont représentatives de ce que d’autres ont subi – et pas seulement des femmes, d’ailleurs [22]. C’est une posture testimoniale à mille lieues de l’image que renvoie l’esprit de défiance lorsqu’il invoque un prestige de la victime contemporain. Les témoins sincères se soucient de vérité et de justice et pas de se mettre en avant. En même temps, cela ne signifie pas qu’ils/elles doivent faire preuve de naïveté, en faisant mine d’ignorer que des paramètres tels que leur classe sociale, leur couleur de peau ou leur notoriété peuvent favoriser l’écoute de leur témoignage. Adèle Haenel a été tout à fait lucide à cet égard.
Au demeurant, elle n’a fait en un sens que retenir la leçon de ce qui a propulsé le mouvement #MeToo aux États-Unis en 2017. D’abord, le fait que le mouvement « n[aisse] des classes sociales où les femmes sont socialement fortes et éduquées, pour se diffuser en direction des couches plus populaires – contrairement aux mouvements sociaux des XIXe et XXe siècles qui naissaient des couches sociales dominées, situées “en bas” de l’échelle des hiérarchies, et descendaient “dans la rue” pour tenter de faire remonter leur point de vue jusqu’au politique “d’en haut” » [23]. Puis, comme cet étayage d’un mouvement féminin par les classes dominantes ne suffit pas encore, le fait que, parmi celles-ci, des femmes témoignent qui « soient bien plus célèbres auprès du grand public que les accusés », telles « les actrices Alyssa Milano, Ashley Judd, Asia Argento, Rose McGowan ou Gwyneth Paltrow, la chanteuse Björk, mais aussi la gymnaste McKayla Maroney ». C’est apparemment ce qui manquait en France, où, telles Catherine Deneuve, Ingrid Caven ou Catherine Millet, les femmes célèbres avaient préféré « défend[re] une liberté d’importuner » . Or c’est maintenant chose réparée, grâce au fait qu’entre Christophe Ruggia et Adèle Haenel, « le rapport de force social […] s’est inversé » et que celle-ci est « puissante aujourd’hui socialement alors que lui n’a fait que s’amoindrir » (ibid.).
Quand elle dresse ce constat sur l’inversion du rapport de force, Adèle Haenel expose une autre condition de possibilité de son témoignage. Dans notre société patriarcale, le « rapport de force imprimé depuis la jeune adolescence » par Christophe Ruggia était tel qu’il lui a fallu attendre d’être « une actrice internationalement reconnue » pour franchir le pas de révéler les violences dont il s’est rendu coupable à son encontre. Or ce pas en avant a alors relevé pour elle d’une éthique de la responsabilité. Dans sa situation privilégiée, à l’ère ouverte par le mouvement #MeToo, il lui aurait paru insupportable de ne pas briser le silence à son tour. Insupportable de ne pas envoyer ce faisant un message de solidarité et de lutte à celles qui, bien qu’elles aient parlé, n’ont pas été entendues et à celles qui n’osent toujours pas parler ou qui ne l’osent plus. Insupportable de ne pas leur dire à toutes, qui subissent « une double peine » humiliante du crime et de sa négation, que celle-ci n’est pas une fatalité. Qu’il est encore possible de « remettre le monde dans le bon sens » en faisant en sorte que « la honte change de camp ».
Tel a été le pari d’Adèle Haenel, encouragé par les personnes qui ont commencé de cheminer avec elles durant l’enquête – dont son propre père. Le pari d’une libération de la parole des victimes désormais soutenue par une mobilisation sociale à leurs côtés, comme ce qui se construit sur le blog « Dans le sillage d’Adèle Haenel », où, « [p]lus qu’un nouveau #MeToo, [d]es récits révèlent un déclic de la responsabilité collective ». Les victimes qui témoignent sont des messagers, disait Fabien Didier Yene [24]. De fait, leur parole testimoniale si vibrante de foi dans l’humanité est précieuse – parce qu’elle ouvre une brèche dans laquelle il ne tient qu’à nous de nous engouffrer.
NOTES
[1] Cette critique de l’institution judiciaire par rapport aux violences faites aux femmes a été corroborée quelques jours plus tard par la sortie d’un rapport sur les féminicides. Le Journal du Dimanche du 17 novembre, qui dévoilait le contenu intégral de ce document commandé par la ministre de la Justice Nicole Belloubet, titrait ainsi sa Une sur « le mea culpa de la justice », étant donné « l’insuffisance des réponses judiciaires au fléau des violences conjugales ». Voir Marie Quenet, « Violences conjugales : la justice fait son mea culpa dans un rapport », JDD, 16.11.2019. Voir aussi : Michel Deléan, Michaël Hajdenberg, « Justice : la perte de confiance », Mediapart, 18.11.2019; Marie Barbier, « Face aux violences sexuelles, les “zones grises” des magistrats », Mediapart, 26.11.2019. [2] Au cinéma, un film exemplaire de cette démarche serait Sobibór, 14 octobre 1943, 16 heures (France, 2001, 95 min.). Claude Lanzmann entreprend d’y servir le témoignage de Yehuda Lerner, recueilli en 1979 dans le cadre de la préparation de Shoah mais qui n’a pas trouvé sa place dans ce film-ci. [3] Sur les trois fonctions – d’attestation, d’hommage et d’éducation – du témoignage, voir Frédérik Detue, Charlotte Lacoste, « Ce que le témoignage fait à la littérature », Europe. Témoigner en littérature, n° 1041-1042, janv.-fév. 2016, p. 3-15, disponible en ligne sur le site de la revue. [4] Sur la façon dont l’institution policière traite – ou plutôt ne traite pas – les plaintes des femmes victimes de violences conjugales, voir l’enquête récente de Nicolas Chapuis, Lorraine de Foucher, Jérémie Lamothe et Frédéric Potet, « Dans les affaires de féminicides, les alertes négligées par les forces de l’ordre », Le Monde, 21.10.2019. [5] Droit de réponse de Christophe Ruggia du 6 novembre, publié dans le prolongement de l’article de M. Turchi, « #MeToo dans le cinéma : l’actrice Adèle Haenel brise un nouveau tabou », art. cité, p. 17-18 en PDF. Comme Adèle Haenel le corrige avec fermeté dans l’émission, Christophe Ruggia l’a moins « découverte » qu’il ne l’a « détruite ». [6] M. Turchi, « #MeToo dans le cinéma : l’actrice Adèle Haenel brise un nouveau tabou »: « Pour moi, c’était une sorte de star, avec un côté Dieu descendu sur Terre parce qu’il y avait le cinéma derrière, la puissance et l’amour du jeu. » [7] Voir, pour l’expression de ce point de vue par une personne qui s’est pourtant dispensée de regarder l’émission du 4 novembre, Olivia Dufour, « Affaire Adèle Haenel : “Les médias fonctionnent sur l’émotion, la justice sur la raison” », propos recueillis par Lucas Bretonnier, Marianne, 07.11.2019. [8] Georges Perec, « Robert Antelme ou la vérité de la littérature » (1963), L.G. Une aventure des années soixante, Paris, Le Seuil, coll. « La Librairie du XXe siècle », 1992, p. 94. [9] Primo Levi, Appendice (1976), Si c’est un homme, trad. de l’italien par M. Schruoffeneger, Paris, Pocket, coll. « Presses Pocket », 2003, p. 278. [10] G. Perec, « Robert Antelme ou la vérité de la littérature », L.G., op. cit., p. 95. [11] Walter Benjamin, Images de pensée, trad. de l’allemand par J.-F. Poirier et J. Lacoste, Paris, Christian Bourgois éditeur, coll. « Titres », 2011, p. 182. [12] Jean Cayrol, « Témoignage et littérature », Esprit, avril 1953, 21e année, n° 4, p. 576. [13] Droit de réponse de Christophe Ruggia du 6 novembre, publié dans le prolongement de l’article de M. Turchi, « #MeToo dans le cinéma : l’actrice Adèle Haenel brise un nouveau tabou », art. cité, p. 18. [14] Celle qui le formule le mieux est peut-être Véronique Ruggia, sœur et collaboratrice du réalisateur, lorsqu’elle « concède un “trouble” dans ses souvenirs : “Ça m’a tellement choquée que j’ai certainement mis un mouchoir sur la mémoire de plein de choses. Moi, j’ai été traumatisée de cette histoire aussi, d’avoir été là sans voir des choses que peut-être il y avait.” » (M. Turchi, « #MeToo dans le cinéma : l’actrice Adèle Haenel brise un nouveau tabou »). [15] Vladimir Nabokov, « Lolita et M. Girodias » (1967), Partis pris, trad. de l’américain par V. Sikorsky, Paris, 10/18, coll. « Bibliothèques 10/18 », 2001, p. 307. [16] Voir les témoignages d’Hélène Seretti, « engagée comme coach des acteurs sur le tournage », et de « Laëtitia, la régisseuse générale du film », M. Turchi, « #MeToo dans le cinéma : l’actrice Adèle Haenel brise un nouveau tabou », art. cité, p.3-4. [17] Voir ibid., p. 12 : « Ce qui a aussi longtemps rendu la parole impossible, c’est qu’on me répétait, avant même que je dise quoi que ce soit, que Christophe était “quelqu’un de bien”, qu’il avait “tellement fait pour moi” et que sans lui je ne serais “rien” », relate Adèle Haenel. [18] Cette critique de l’omerta dans le milieu du cinéma français est corroborée par l’autre enquête réalisée par Marine Turchi et parue conjointement : « Dans le cinéma, des violences sexuelles systémiques », Mediapart, 03.11.2019. [19] Voir M. Turchi, « #MeToo dans le cinéma : l’actrice Adèle Haenel brise un nouveau tabou », art. cité, p. 14 : « “Je ne savais pas comment en parler, et le fait que cela se rapproche d’une affaire de pédophilie rendait la chose plus compliquée qu’une affaire de harcèlement”, explique aujourd’hui la comédienne ». [20] Voir Justine Lacroix, Jean-Yves Pranchère, Les droits de l’homme rendent-ils idiot ?, Paris, Le Seuil, coll. « La République des idées », 2019. [21] Quant au bilan amer en France, voir Sandra Muller, #Balancetonporc, Paris, Flammarion, 2018. L’effet retentissant du mouvement aux États-Unis se donne à lire par exemple dans la Une du Time du 18.12.2017 qui présente les « briseuses de silence » du mouvement élues « Person of the Year ». C’est le commentaire d’Edward Felsenthal, rédacteur en chef du magazine, qui donne l’idée d’une révolution culturelle : « [l]es actions galvanisantes des femmes de notre couverture, avec celles de centaines d’autres, et beaucoup d’hommes également, ont déclenché un des changements les plus rapides de notre culture depuis les années 1960 » (« Personnalités de l’année de “Time” : les femmes ayant “brisé le silence” des violences sexuelles », Le Monde avec AFP, 06.12.2017) [22] Un autre déclencheur du témoignage d’Adèle Haenel a été son visionnage du documentaire Leaving Neverland (États-Unis, Royaume-Uni, 2019, 236 min.), qui accuse Michael Jackson de pédophilie. Dans ce film de Dan Reed, ce sont des hommes, Wade Robson et James Safechuck, qui témoignent des violences sexuelles commises par la star lorsqu’ils étaient enfants. [23] Véronique Nahoum-Grappe, « #MeToo : Je, Elle, Nous », Esprit, 2018/5 (mai), p. 118, disponible en ligne sur cairn.info. Véronique Nahoum-Grappe rend hommage ici à la réflexion de Françoise Héritier, décédée peu après la naissance du mouvement, en novembre 2017. [24] Voir le film documentaire Les Messagers (France, 2014, 70 min.) d’Hélène Crouzillat et Laetitia Tura. Fabien Didier Yene, à qui le film est dédié, y témoigne de son expérience de migration au nord du Maroc.