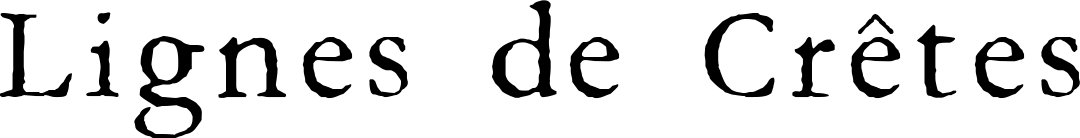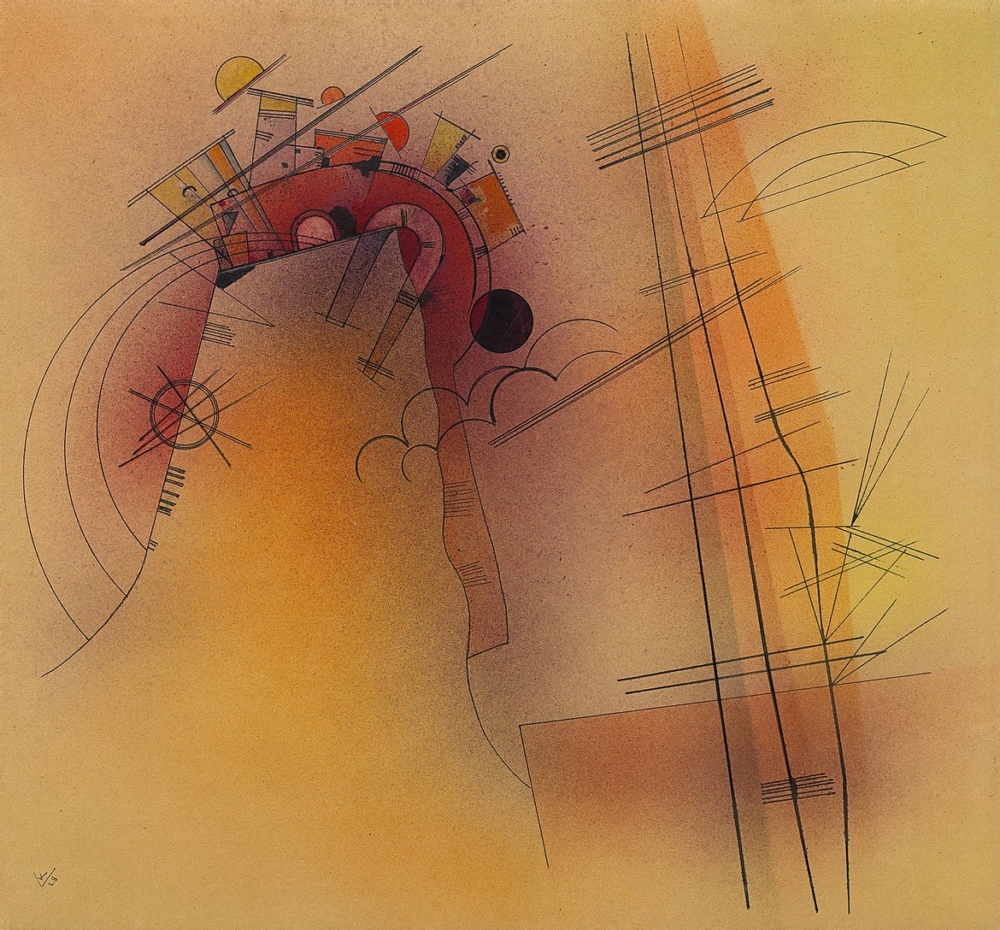En 1968, nous les jeunes militants révolutionnaires rêvions d’un autre monde et nous étions sûrs qu’il allait advenir. En pleine guerre froide alors que la décolonisation commençait à peine et que nous sortions de deux guerres coloniales sanglantes en Indochine et en Algérie, deux défaites pour la France, alors qu’au Vietnam les gouvernements américains s’enlisaient dans une interminable et terrible guerre contre les combattants de la liberté et que la jeunesse progressiste luttait à la fois pour les droits civiques et contre la guerre qui les décimait, nous rêvions de Révolution.
L’ « immigré »
Il n’y avait pas de jeunes immigrés ou « issus de l’immigration » dans les banlieues. Les immigrés qui venaient en France travailler dans les usines automobiles, vivaient pour la plupart seuls dans des foyers sordides, deux ou trois par chambres minuscules. Ils dormaient sur des lits superposés de métal et parfois lorsqu’ils faisaient les trois-huit, ils se partageaient le même couchage à des horaires différents. Ils préparaient collectivement leur nourriture dans des grands chaudrons sur des réchauds à gaz ou à alcool.
Le soir, ils se retrouvaient devant le couscous le plat de poisson ou au café. Sans femmes, sans enfants, ceux-là étaient au pays, dans leurs tribus ou leur bled aride et misérable. L’ouvrier immigré ne rentrait chez lui qu’une fois par an s’il avait pu économiser pour payer son voyage. Le regroupement familial n’existait pas. « L’immigré » était masculin, seul et adulte. D’ailleurs il n’y avait pas encore de barres d’HLM en banlieue, ou si peu. Par contre il y avait des bidonvilles sordides, où s’entassaient les familles quand elles avaient pu se rejoindre, juste après la guerre d’Algérie, dont nous venions de sortir et dont nous n’étions pas fiers, et des foyers sinistres, où vivaient dans une communauté tribale ou politique, parfois même les deux ensembles, les jeunes ouvriers de la métallurgie, de l’industrie automobile et de la construction et les quelques anciens qui étaient restés en France.
La sélection scolaire silencieuse
Le collège n’était pas unique, il y avait l’école professionnelle pour les classes populaires avec le CAP (certificat d’aptitude professionnelle) comme diplôme final, et le lycée pour les enfants de ce que nous appelions encore « la bourgeoisie ». Ceux-là seuls, bons ou mauvais élèves, ce qui n’avait pas grande importance alors, pouvaient passer le baccalauréat et entreprendre des études supérieures. Les facultés n’étaient pas surchargés, puisque seule 10% d’une classe d’âge postulait au baccalauréat. Les professeurs n’avaient aucun mal à faire régner la discipline dans des classes de quarante à cinquante élèves. En effet, nous étions nombreux, nous les jeunes du baby boom, mais sans aucune mixité, ni de sexe, ni de catégorie sociale, la discipline restait simple à appliquer : tout était interdit. Notre avenir professionnel était tout tracé, l’orientation n’existait pas et aurait été parfaitement inutile, d’ailleurs on ne demandait jamais aux adolescents ce qu’ils souhaitaient faire. Les garçons feraient ce que faisait leur père, les filles devaient se marier, elles n’avaient pas besoin de faire des études, trop poussées, un petit vernis suffisait et d’ailleurs c’est à la Faculté que la jeune fille devait rencontrer son futur époux si elle ne l’avait pas déjà connu dans une soirée ou un bal, sous la haute surveillance de sa mère.
Celles qui vraiment le souhaitaient pouvaient faire du droit, de la médecine, ou de l’enseignement. En dehors de certains concours très sélectifs depuis des générations, comme l’entrée à l’Ecole Normale Supérieure ou l’agrégation, les autres formations ne posaient aucun problème, il suffisait d’avoir une famille aisée pour soutenir sa progéniture le temps de ses études ; Les jeunes filles ne pouvaient rencontrer que des jeunes garçons issus de la même classe sociale, élevés avec les mêmes codes culturels, en principe de la même religion. Les écoles n’étaient pas mixtes, ni les collèges ni les lycées, ce n’était qu’à la Faculté que tous ces jeunes gens pouvaient vivre ensemble en dehors de leur famille. Mais à la Faculté, hélas, nous priment conscience que l’ennui, que nous avions supporté bravement pendant toute notre adolescence, allait nous engluer définitivement. Cette culture devenait insupportable, alors que nous avions espéré une liberté émancipatrice, avoir accès enfin à une réflexion vivante, guidés par des enseignants modernes et de haut niveau.
Le féminisme
La contraception n’existait pas plus qu’aux siècles précédents et l’avortement était criminel et mortifère, sauf pour celles dont la famille connaissait un circuit médical en Angleterre ou en Suisse. Si, par malheur, une grossesse survenait, ils n’avaient pas d’autre choix que de se marier en urgence. L’enfant qui naissait hors mariage était un petit batard dont l’avenir s’annonçait difficile et la jeune femme abandonnée devenait fille-mère, mise au ban de la société. Emancipée juridiquement de sa famille, elle devait interrompre ses études, se placer dans un foyer très maltraitant et après la naissance de son enfant qu’elle plaçait en nourrice si sa famille ne le prenait pas en charge, se débrouiller seule. Certaines mésalliances étaient tolérées, à condition qu’elles apportent un surcroît de fortune, de titre ou l’espoir d’une réussite sociale.
Le féminisme, celui de la deuxième vague qui allait éclore après 68, allait lutter non seulement pour les droits civiques et l’égalité économique des femmes, mais aussi pour la liberté et l’autonomie de nos corps et de notre parole de femmes. Il se préparait dans ces années là dans les réunions les amphithéâtres où nous n’avions pas le droit de parler, où les jeunes hommes se croyaient autorisés sous prétexte de libération sexuelle à nous harceler nous violenter et même nous violer en toute bonne conscience (la notion de « consentement « n’existait pas), dans les familles où nous étions contraintes à choisir des études peu valorisées et à nous marier pour ensuite mettre au monde des enfants non désirés bien qu’aimés et qu’il faudrait élever sans avoir le choix de vivre libres.
La « Culture »
La culture au sens actuel du terme, celle qui nécessite une large diffusion médiatique, n’existait pas encore et la télévision ne diffusait que le soir et le dimanche après-midi en noir et blanc pour les familles privilégiées qui avaient pu acquérir le poste.
La Culture était ce qui s’enseignait dans les lycées et les facultés : les Humanités d’autrefois, l’art et la littérature, les langues mortes ou rares, les mathématiques et la physique, la musique ancienne ou classique. Le cinéma, la photographie, le jazz ou la musique populaire, n’étaient pas encore considérés comme des éléments culturels et la culture elle-même n’était transmise que par les professeurs du lycée et par les familles qui avaient pu historiquement bénéficier de cette transmission. Le reste pouvait s’appeler culture populaire, mais n’avait de sens qu’étudié par des savants issus du sérail universitaire, des ethnologues ou des anthropologues.
Le général de Gaulle avait bien créé un ministère de la culture, en mettant à sa tête André Malraux que nous prenions pour un vieux réactionnaire à moitié sénile, d’abord parce qu’il avait rejoint la droite après avoir été combattant anti fasciste dans sa jeunesse pendant la guerre civile en Espagne du côté des républicains, ensuite parce qu’il avait accueilli au Panthéon Jean Moulin le résistant que nous admirions, seul avec un discours grandiloquent et sa voix tremblante devant tous les caciques mâles de la France gaulliste. Mais nous avions tort je pense, car la création des maisons de la culture ouvertes à tous et dans tous les départements étaient une vraie ouverture pour tous ceux qui en étaient exclus.
Le mythe des « les trente glorieuses »
Le monde des adultes ne nous concernait pas. Les parents ne parlaient pas à leurs enfants et les enfants ne leur posaient pas de question. Le grand silence de l’après-guerre, dirigé d’une main de fer par la statue du commandeur qu’incarnait le Général de Gaulle, étouffait la jeunesse. Malgré son héroïsme lors de la dernière guerre et de son courage pour imposer, contre son propre camp, la paix en Algérie et son droit à l’indépendance, il nous faisait l’effet d’un revenant, l’homme d’un autre âge. Et nous sentions cette oppression jour après jour au fur et à mesure que nous grandissions, nous les enfants du baby boom, des trente glorieuses, de la reconstruction nationale, des sales guerres de décolonisation, nous étouffer davantage. Nous sentions dans nos corps contraints naître une révolte qui bien que silencieuse encore, attendait son heure pour s’exprimer.
Nous devions nous réjouir de la paix retrouvée, du développement national et de la richesse de notre système économique, de la profusion des biens d’équipements, machines à laver ou aspirateurs qui devaient libérer la femme au foyer, celle qui venait de recevoir le droit de vote, mais pas encore celui d’avoir son propre compte bancaire si elle était mariée. Il n’y avait pas de chômage, chacun d’entre nous pouvait espérer trouver sa place, et seulement sa place, sans broncher, dans ce pays tranquille qu’était le nôtre, grâce au Général qui avait su mettre fin aux régimes désordonnés des partis politiques de la quatrième (République) et aux espoirs de coup d’état minables des militaires déçus de l’indépendance algérienne et de leurs clientèle de l’OAS.
Pas de chômage certes, des loyers modérés, même à Paris, la vie semblait facile mais la sélection de classe était inébranlable, le travail dans les usines presqu’aussi dur qu’au XIXe, les salaires misérables avant 68 et les aides sociales pratiquement inexistantes.
La télévision était sous le contrôle de l’état et la police surveillait tous les mouvements politiques et intervenait brutalement autant contre les Algériens lorsqu’ils tentaient de manifester que contre les gauchistes c’est à dire les jeunes révoltés que nous étions.
Le Parti Communiste
Le parti communiste encore très puissant organisait des grèves avec son syndicat affilié, la CGT, lorsque fermait une mine dans le Nord ou une usine de textile dans L’Est. Mais nous savions depuis longtemps qu’il était le satellite de l’Union soviétique. Contrairement à nos aînés « communistes » qui, en ce temps de guerre froide intensive, ne concevaient d’autre espoir révolutionnaire que venant de ce sombre régime soviétique, d’autant que toute critique signifiait l’exclusion immédiate du Parti et la mise au ban du monde communiste, nos regards se tournaient vers l’orient extrême, l’orient rouge, la Chine. Nous étions maoïstes, enfin certains d’entre nous. D’autres se nommaient trotskistes et luttaient avec la même intensité contre l’idéologie du parti communiste, mais avec des méthodes et des objectifs différents, ce qui bien sûr nous opposait farouchement. D’autres encore se nommaient situationnistes et méprisant les idéologies qui s’affrontaient violement, tout en restant communistes, critiquaient la société marchande et consumériste, la société du spectacle, dans laquelle nous avions grandi, et prônaient une société sans classe libertaire et sensuelle. Les anarchistes ou anars apparaissaient de temps à autre vêtus de noir et dramatiquement violents. Tous s’en méfiaient, car ils jouaient le rôle de provocateurs dangereux, en ces temps incertains où la police commençait à réagir contre cette frange de la jeunesse encore très inorganisée mais qui s’agitait dans le quartier latin, en dehors de toute structure connue des pouvoirs en place.
Le parti communiste dirigé par Georges Marchais qui n’avait pas été résistant ni même maquisard mais travailleur du STO, ce parti qui excluait ses contestataires, prônait « la paix en Algérie » ou « paix au Vietnam » sans dénoncer une violente guerre coloniale, et nous désignait comme ennemis de classe, petits bourgeois dévoyés et tout simplement « gauchistes » (en référence au texte de Lénine : le gauchisme, maladie infantile du communisme) ce qui était une insulte avant de devenir un nom commun.
Le rêve de révolution
Cette jeunesse qui se politisait intensément et sans que les aînés n’y prennent garde s’était formée, pour les plus âgés, pendant la fin de la guerre d’Algérie. La plupart de ces jeunes militants avaient connu d’intenses débats contradictoires et violents au sein de l’organisation étudiante du parti communiste, l’UEC, l’union des jeunesses communistes, et ils en avaient été exclus comme provocateurs ou « gauchistes ». Ceux-là libres désormais du carcan du Parti pensaient et agissaient à toute vitesse. Ils se formaient dans les séminaires d’Althusser à l’école normale supérieure ou dans des lieux plus secrets. Certains intellectuels, écrivains ou chercheurs, qui n’avaient pas de poste universitaire, car l’université avant 1968 s’était fermée à toute pensée progressiste, déçus du communisme et révoltés par les guerres coloniales et la répression intellectuelle et morale de l’époque, se rapprochaient de la jeunesse étudiante qui se morfondait dans les facultés. Et les étudiants les plus avides de cette réflexion nouvelle suivaient les séminaires de Michel Foucault, Roland Barthes, et même de Lacan, hors des murs de l’université. Ils se retrouvaient dans les cafés du quartier latin ou dans les petites librairies révolutionnaires qui commençaient à se développer, ou même dans la grande librairie Maspero au quartier latin à Paris qui fournissait toute la littérature des penseurs des luttes d’indépendance nationale et des révolutionnaires du monde entier.
La lutte serait violente, tous étaient d’accord. Il fallait briser le carcan du vieux monde, et faute d’alternative nous voulions la Révolution.
La laïcité, la religion et le religieux
Nous ne pouvions imaginer qu’un jour de notre vivant nous verrions la religion prendre à nouveau le pouvoir sur la société et la politique. Notre siècle était athée, la religion que nous n’imaginions pas autre que catholique avait perdu tous ses combats depuis la fin du XIXe : la loi de séparation de l’église et de l’état, l’affaire Dreyfus et sa réhabilitation, l’échec du fascisme avec la fin de la guerre, le concile de Vatican II qui venait d’avoir lieu en 1962 censé apaiser les tensions entre l’église catholique et les juifs en cessant de les traiter de meurtrier du Christ et mettre à l’écart les plus farouches intégristes.
L’école privée catholique, celle des jésuites surtout pour les garçons, était certes encore puissante et les pensionnats ou écoles catholiques éduquaient nombre de jeunes gens filles et garçons en uniforme bleu marine, mais les barrières sociales et idéologiques étaient si fortes que nous n’avions jamais l’occasion de nous rencontrer et de débattre à ce sujet. Il y avait ceux qui allaient à la messe et les autres. Mais l’école laïque étant certainement d’un meilleur niveau à l’époque que la catholique, à partir du lycée, des classes préparatoires et de la faculté en tout cas les enfants de la bourgeoisie se retrouvaient là.
L’Etat était laïque et l’école aussi, du moins pour ceux qui la fréquentaient. Laïque et égalitaire mais pour qui ? Certainement pas pour les filles qui n’avaient accès qu’aux études de seconde classe, ni pour les enfants des classes populaires qui s’arrêtaient au certificat d’études, ni pour les enfants issus de l’immigration qui n’avaient pu encore pour la plupart rejoindre leur père en France et les jeunes descendants d’harkis qui étaient parqués dans des centres de rétention dans le sud ouest de la France (ce que nous ignorions). Les enfants des « départements d’outre mer » exilés de force par l’état français encore colonial étaient placés dans des familles en tant qu’ouvriers ou paysans dans le centre de la France et bénéficiaient à peine d’une scolarité (ce que nous ignorions également). L’injustice de classe la discrimination, le racisme, la misogynie et l’homophobie n’étaient même pas évoqués à l’école. L’enseignement civique se limitait à une vague connaissance des institutions de la République, quant à l’éducation sexuelle elle était impensable avant 68, on ne parlait pas de sexualité à l’école ou au lycée, les classes n’étaient pas mixtes, les pantalons étaient interdits aux filles ainsi que le maquillage et nous portions tous une blouse sur nos vêtements. Il en était naturellement ainsi dans ces années d’après guerre, que l’on soit catholique ou pas, le carcan patriarcal et colonialiste était le même pour tous. J’avoue que nous ne savions pas comment classer les protestants, très discrets (les mouvances évangéliques ne s’étaient pas encore implantées en France) ; je pense que nous les assimilions aux athées. Quant aux juifs ils faisaient profil bas, peu religieux après le traumatisme de la Shoah (qui ne se définissait pas ainsi et dont on ne parlait pas) et avant l’intégration des communautés sépharades venues d’Algérie après 1962.
Et l’islam, nous n’en entendions jamais parler, les immigrés d’Afrique du Nord devaient pratiquer leur foi en silence, relégués dans leurs foyers et sans famille donc sans fêtes ni cérémonies familiales ou communautaires. Ce mot d’ailleurs n’existait pas pour désigner des groupes religieux. Les Algériens qui sortaient de leur guerre d’indépendance étaient en général très politisés et plus préoccupés par leur lutte et leurs conditions dramatiques de vie, surveillés par une police redoutable dirigée par le préfet Papon de sinistre mémoire que par l’islam, et les Tunisiens moins nombreux vivaient dans leur pays une révolution laïque.
L’explosion de mai 68 ne fut pas religieuse, loin de là, même si nous étions, sans le savoir, messianiques avec notre idéal de pureté révolutionnaire à laquelle malgré nos divergences nous croyions tous dur comme fer.
Entre nous les jeunes militants de cette époque nous n’évoquions jamais le sujet, nous ne parlions jamais de notre histoire ni de notre origine familiale encore moins de sa religion.
Nombre d’entre nous étions juifs et les dirigeants de nos groupuscules aussi. Mais un révolutionnaire marxiste léniniste maoïste ou trotskyste se devait d’avoir rompu avec toute religion. Au mieux c’était une « névrose obsessionnelle », au pire « l’opium du peuple ». Alors personne ne l’évoquait, c’eut été indécent et même dangereux. Je pense que le traumatisme de l’Histoire récente et de nos histoires particulières était encore vivace dans des familles meurtries par l’extermination, l’exil la spoliation et l’humiliation, même si nos pères avaient été résistants comme c’était le cas pour le mien et le déni de nos particularités nous semblait exigé par l’engagement « révolutionnaire ». En outre nous étions du côté des « peuples opprimés » et parmi eux les Palestiniens qui à l’époque vivaient en exil ou dans des camps en Jordanie et au Liban. Et par nécessité ou par peur d’être dans le mauvais camp, nous nous prétendions « antisionistes ».
L’esprit du temps n’était pas religieux mais contestataire et révolutionnaire. Le passé ne comptait plus, ni la famille ni la fidélité ni l’amour ni la tradition ni la transmission. Seul l’avenir pourrait être radieux et nous guérir de nos blessures. Nous étions messianiques en ce sens et nous étions prêts pour beaucoup à suivre une voie christique, tout quitter famille, amis, études, projets d’avenir pour apporter la bonne parole révolutionnaire et permettre l’avènement d’un monde nouveau de paix de justice de prospérité d’égalité, que nous ne verrions pas nous mêmes.
Mais si le silence religieux règne dans ces années, le travail de l’Histoire poursuit son œuvre et les conflits jusque là refoulés surgissent avec plus de force lorsque nous les avons crus réglés.
« Le XXIe siècle » sera religieux disait Malraux, nous trouvions cette phrase ridicule, et évidemment nous ne pouvions imaginer que le religieux reviendrait en effet sous cette forme politique violente et destructrice dès l’aube de ce XXIe siècle. Nous en étions encore bien loin et si à la fin des années 70 des militants maoïstes purs et durs, les plus marxistes léninistes les plus instruits et nos « chefs » de surcroit, devinrent progressivement talmudistes orthodoxes, ce fut en toute intimité intellectuelle sans jeter l’anathème sur ceux qui avaient été leurs disciples mais qui restaient athées incroyants et laïques.
Le terrorisme
Nous étions les enfants de l’après guerre et ceux de la guerre d’Algérie, nous n’avions pas connu la Résistance et nous en étions nostalgiques. Nous étions aussi les enfants ou plutôt les petits enfants de la Révolution russe de 1917 et pourquoi pas les descendants des communards de 1870. Nos parents ne parlaient jamais de ce qui s’était passé pendant ces sombres années mais pour la plupart d’entre nous dans ce monde figé et silencieux nous nous identifions aux résistants : ceux de la guerre contre le nazisme, du fascisme ceux des luttes anticoloniales et ces combattants là étaient des « terroristes ». Ils n’hésitaient pas à tuer pour vivre libres, poser des bombes dans des lieux publics faire sauter des voies ferrées, des bâtiments militaires ou administratifs. Se venger aussi des collabos des traîtres et de ceux qui opprimaient le « peuple ».
Certains d’entre nous étaient attirés par le terrorisme, pas tous, car nous appartenions à des groupuscules ou des mouvements qui s’affrontaient verbalement avec violence mais sans passer à l’acte. En réalité je crois que nous n’étions pas si violents malgré nos slogans meurtriers. Pourquoi, alors que nos camarades allemands et italiens de la Fraction armée rouge et de Lotta continua choisissaient la voie du terrorisme le plus radical et n’hésitaient pas à mettre en jeu leur vie et celle de leurs concitoyens honnis, à enlever, séquestrer, torturer ou assassiner leurs « ennemis », nous les maos radicaux de la Gauche Prolétarienne avons résisté au terrorisme tout en étant en parole du moins attirés par les actions violentes, la « vengeance populaire » la lutte révolutionnaire qui n’était pas un dîner de gala comme disait notre guide, le président Mao ? Alors pourquoi ?
L’on a dit que l’histoire de la France son rapport au fascisme au nazisme n’était pas la même, c’est vrai, que les enfants perdus de la révolution que nous étions ont pu se ressaisir avant de sombrer dans la Terreur, (sauf quelques nihilistes absolus d’Action Directe qui ont continué jusqu’à la destruction finale). Je me souviens de ce moment de basculement ou nos dirigeants, qui deviendraient talmudistes, ont appelé à rendre les armes. C’était après l’assassinat devant les usines Renault de notre camarade Pierre Overney abattu de sang froid par un sbire de la direction. C’était après la prise d’otages de Munich perpétré par un groupe terroriste palestinien à l’encontre de sportifs israeliens pendant les jeux olympiques et leur assassinat. C’était aussi juste après la révolution pacifique des ouvriers de Lip à Besançon et leur créativité joyeuse pour reprendre leur usine et remettre en marche sa production dans un désir d’autogestion transcendant les hiérarchies et les partis. On arrête cette guerre ont-ils dit et nous avons tous ou presque rendu les armes (symboliques car nous n’étions pas armés). En outre nous venions de créer un journal Libération et l’aventure devait continuer autrement.