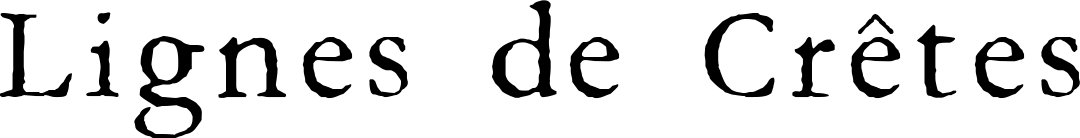Beaucoup de choses ont été dites, écrites, pensées à propos de l’évènement de Nanterre : violences policières, racisme institutionnel, révolte populaire, etc. Je me propose ici même d’apporter une tentative d’éclaircissement, plus ou moins exhaustif, plus ou moins iconoclaste – selon le point de vue –, s’appuyant sur différents travaux, prises de position, et de mes réflexions personnelles sur le sujet.
§ 1. Le monde vu par la police – Si l’on se rapporte à la « présentation générale » que propose le Ministère de l’intérieur, les différentes fonctions de la police s’avèrent être les suivantes :
« Dans cet esprit républicain, la loi d’orientation et de programmation relative à la sécurité de janvier 1995 a énoncé les missions prioritaires de la police nationale, confirmées par la loi d’orientation et de programmation pour la sécurité intérieure d’août 2002 : La sécurité et la paix publiques, consistant à veiller à l’exécution des lois, à assurer la protection des personnes et des biens, à prévenir les troubles à l’ordre public et à la tranquillité publique ainsi que la délinquance ; La police judiciaire, ayant pour objet, sous la direction, le contrôle et la surveillance de l’autorité judiciaire, de rechercher et de constater les infractions pénales, d’en rassembler les preuves, d’en rechercher les auteurs et leurs complices, de les arrêter et de les déférer aux autorités judiciaires compétentes ; Le renseignement et l’information, permettant d’assurer l’information des autorités gouvernementales, de déceler et de prévenir toute menace susceptible de porter atteinte à l’ordre public, aux institutions, aux intérêts fondamentaux de la Nation ou à la souveraineté nationale. Les missions assignées à la police nationale mettent en œuvre l’ensemble de ses composantes. »[1]
Assurer la « sécurité » et la « paix publique », veiller à « l’exécution des lois », garantir la « protection des personnes et des biens », lutter contre les « troubles à l’ordre public », « l’intranquillité publique » et la « délinquance ». La simple énonciation de ces quelques prérogatives nous dévoile déjà la « vérité » de ce qu’est l’institution policière, en tant qu’elle pose l’idée d’un monde particulier. Quel est-il ce monde ? Si les objectifs de cette institution sont de garantir tous ce qui a trait à la « sécurité », à la « paix », au « maintien de l’ordre », etc., c’est qu’elle suppose que sans elle, cette perspective semble impossible et impensable – ou tout du moins, fortement compromise. Donc, la police – et en vérité, l’État – pose et suppose un « monde mauvais » a priori. Un monde dans lequel, sans eux, règnerait insécurité, chaos, désordre, violence, crimes et délits. Or, comment faire obstacle à ce monde dangereux ? La réponse nous est directement donnée dans le texte officiel : rechercher et constater les infractions pénales ; arrêter les coupables et les déférer devant la Justice ; se renseigner et informer afin de déceler et prévenir d’éventuelles menaces à l’ordre public et à l’intérêt de l’État. En somme, et essentiellement : surveiller, traquer, capturer, punir. Ce qui implique la possibilité légale de la surveillance, de la traque, de la capture, et de la punition ; donc, de la violence prédatrice et de la violence destructrice. La police suppose un monde dangereux, un monde anarchique que seule la force étatique, donc policière, peut contraindre à prendre forme, à discipliner, à s’enraciner dans et par une assise solide. Cependant, certains échappent à cette mise-en-forme, cette mise-en-ordre, cette mise-en-Loi, ils sont donc hors-la-Loi. Comme le rappelait Jacques Derrida :
« Pour la représentation courante, à laquelle nous nous référons pour commencer, le souverain et la bête semblent avoir en commun leur être hors-la-loi. C’est comme si l’un et l’autre se situaient, par définition, à l’écart ou au-dessus des lois, dans le non-respect de la loi absolue qu’ils font ou qu’ils sont mais qu’ils n’ont pas à respecter. L’être-hors-la-loi peut sans doute, d’une part, et c’est la figure de la souveraineté, prendre la forme de l’être-au-dessus-des-lois, et donc la forme de la Loi elle-même, de l’origine des lois, du garant des lois, comme si la Loi, avec un grand L, la condition de la loi, était avant, au-dessus et donc en dehors de la loi, extérieure, voire hétérogène à la loi ; mais l’être-hors-la-loi peut aussi, d’autre part, et c’est la figure de ce que l’on entend le plus souvent par l’animalité ou la bestialité, [l’être-hors-la-loi] peut situer le lieu où la loi n’apparaît pas, n’est pas respectée, ou se fait violer. »[2]
Commentant les travaux de Carl Schmitt, le philosophe de la différance met en évidence ici-même certaines spécificités du concept de « souveraineté », consistant à exclure d’un bout à l’autre du champ de la Loi, à la fois son producteur, de même que celui qui en est exclu de facto parce qu’indigne vis-à-vis d’elle, ou, transgresseur avant même toute transgression effective. Le « souverain », comme le « bandit », ont pour trait commun d’être hors-la-Loi ; or, seul le souverain peut se permettre en toute légitimité d’être exclu du système normatif qu’il a lui-même édicté. Que faire alors contre l’illégitime hors-la-Loi en puissance ou en acte ? L’observer, le soupçonner, le porter à son regard, le chercher, le traquer, le pourchasser, d’une part ; et c’est là la violence prédatrice qui s’inscrit dans le dispositif de surveillance, de renseignement, de prévention – « La police, c’est l’institution chasseresse, le bras chasseur de l’État, chargé pour lui de traquer, d’arrêter et d’emprisonner »[3] écrit à juste titre Grégoire Chamayou. D’autre part, le capturer, le museler, le neutraliser, le réprimer voire l’éliminer ; et c’est là la violence destructrice, qui se décline dans les procédures de répression physique et matérielle – « L’État [et donc, sa police, N.D.A] (…) revendique avec succès pour son propre compte le monopole de la violence physique légitime »[4].
§ 2. De la violence policière – La « violence » est donc inexorablement consubstantielle de l’activité policière – on pourrait même dire qu’elle en est son fondement et sa fin véritable ; il n’y a de police que par et pour la violence, celle-ci y est systématique, elle « combat le crime avec les armes du crime »[5]. Le terme même d’« excès » de violence n’a donc tout simplement aucun sens, puisque cela supposerait qu’il puisse exister une violence en soi non-excessive. Or, la violence commence dès la simple et banale interpellation, puisqu’elle intime à la volonté de l’interpellé de s’assujettir – de s’effacer, de se retirer, de se suspendre, de se soumettre, de s’aliéner –, bon gré mal gré, à celle de l’interpellant, provoquant par l’injonction, la nécessité d’un arrêt, d’un retournement, d’une fixation, indépendamment des volitions propres de l’individu désormais sujet de la parole de l’Autre[6] : « cette action se déroule comme si les dominés avaient fait du contenu de cet ordre, en tant que tel, la maxime de leur action (‘‘obéissance’’). »[7] – et ce, quand bien même cette injonction n’eût pas été obéie, car l’impératif persiste toujours en son être. Pis encore lorsque l’injonction est accompagnée d’une menace de sanctions effectives, physiques ou pénales. Voilà pourquoi Geoffroy de Lagasnerie a parfaitement raison d’écrire que : « Tout est violent dans la police, mais nous n’appelons pas tout ni ne percevons tout comme violent. Nous appelons ‘‘violent’’ ce qui sort du cadre, ce qui nous semble illégal, irrégulier. »[8] L’« excès » de violence n’est donc en vérité « excès » que lorsque celle-ci innove – au sens quasi théologique d’une bid’a[9] – dans la violence légale. Il ne s’agit pas d’un dépassement, d’un outrepassement, d’une surabondance de violence par rapport à une situation ou un état de « normal » de non-violence, mais bel et bien d’une innovation (bid’a) de la violence par rapport à la violence déjà légalement instituée et consacrée par la Loi, toujours déjà permanente. La question n’est donc jamais de savoir si les forces de l’ordre peuvent ou non faire usage de la violence – ils le doivent –, mais plutôt de quels types de violences sont autorisés ou non dans telles ou telles circonstances, selon telles et telles procédures. Pour s’en convaincre, il suffit d’écouter le procureur de Nanterre suite à la mort du jeune Nahel (17 ans) et la mise en examen pour homicide volontaire du policier en question : les « conditions légales » de l’usage d’une arme « n’étaient pas réunies », déclare-t-il ; ce qui signifie tout aussi bien que : si les « conditions légales » avaient été « réunies », ici, l’usage de l’arme à feu aurait été licite. La question n’est donc que purement procédurale ; le policier n’a pas – supposément et suffisamment – respecté à la lettre la procédure en vigueur, il a donc innové dans la violence permise, s’est octroyé une ‘‘liberté’’ que la Loi n’énoncerait pas clairement, d’où sa faute – et on fera passer cette faute soit pour un « manque de discernement », un « abus de pouvoir » ou encore une « omnipotence »[10].
§ 3. L’illusio policière – Étant donné ce que je viens d’énoncer plus haut à propos du « monde mauvais » perçu et construit par l’institution policière, il convient désormais de rentrer plus en avant dans la raison d’être intime qui structure et anime la police. En tant qu’elle doit œuvrer dans un « monde mauvais » mais de façon toute négative, puisque contrairement à l’institution scolaire (savoir, diplôme) ou hospitalière (santé) elle ne produit rien de substantiel, « ce défaut de contenu appelle un surcroit de valeurs, explique Dominique Monjardet, et par là la police est vraisemblablement de toutes les institutions celle qui s’entoure le plus d’exposés normatifs »[11]. Et parmi ces valeurs ou idéaux, évidemment, l’idée et l’idéal d’incarner la figure héroïque du protecteur de la cité contre toutes les menaces et les troubles éventuels – empêcher la mise-à-mal et la mise-à-mort d’autrui faite en toute illégalité, tout comme la fitna ; donc, préserver l’ordre étatique –, de même que le fidèle et probe garant des droits et libertés du citoyen – « la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression » (art 2. DDHC). Ici consiste son illusio au sens de Bourdieu, à savoir sa raison d’être, sa motivation, tout autant que son illusion. Car, précisément, c’est en vertu de cette belle illusion que nombre de dérives surgissent également. Si le monde est en proie à la méchanceté, et que l’institution policière en est censée la préserver, la défendre, voire la délivrer du Mal, sa mission est donc de part en part sotériologique, c’est-à-dire, relative au salut et à la rédemption[12] – en l’occurrence ici de la communauté nationale. Un salut et une rédemption qui, pour la police française, passe nécessairement par le « maintien de l’ordre » – quasi à tout prix – notent Stéphane Roché et Alain Bauer, au risque s’il le faut, de la mort.
D’où un écueil majeur : si, théoriquement, le monde est mauvais, ou du moins, constamment menacé par le Mal, quid de la réalité d’un monde où le Mal s’avèrerait, in fine, bien moins omniprésent qu’il ne devrait l’être ? Un tel hiatus provoquerait assurément une dissonance psychique difficilement acceptable entre le fantasme d’une vie mêlant tantôt sainteté et légitimité morale, tantôt aventure, courage, combat contre les méchants ; et la réalité d’un quotidien finalement jonché par une plate banalité, l’ennui et l’ankylose d’une administration kafkaïenne aliénante. Pis encore lorsqu’en plus, pèsent sur l’institution des exigences de performance dans une logique managériale propre au néolibéralisme. Dès lors, comment résoudre ces contradictions ? Et bien, de la même manière que le Christ s’aventurant dans le désert pour ‘‘provoquer’’ la provocation du diable et sa tentation ; bref, susciter le Mal – voire, parfois même, peut-être, le créer s’il le faut. De là ces situations ubuesques que décrivait Didier Fassin dans son étude sur les forces de l’ordre, où précisément, il ne se passe rien[13]. Or, à un moment donné, il faut bien que quelque chose se passe plutôt que rien. Donc, il tombe sous le sens que lors de certaines patrouilles de la BAC par exemple, cette dernière puisse se laisser aller à tout l’arbitraire dont elle peut et se sait jouir, forte de sa philosophie « proactive », qui, comme le rappelle Mathieu Rigouste, « est basé[e] sur sa capacité à créer les situations qui justifient son existence, à favoriser les conditions de sa reproduction et de son extension. Une unité de police proactive crée les menaces qu’elle est censée réduire en suscitant, en laissant faire, en provoquant voire en fabriquant des désordres pour mieux s’en saisir. »[14] La pression de la culture du chiffre y aidant, il faut pouvoir trouver quelque chose, n’importe quoi ; donc, contrôler les identités des mêmes, inlassablement, en attendant une bévue, une opportunité, une prise. La logique de la « variable d’ajustement » obligatoire, de la disette, voire de la perversité que peut provoquer le sentiment d’inutilité sociale, va même jusqu’à pouvoir user du droit comme une arme : « Tiens, je suis content, j’ai trouvé un moyen de coincer les mecs qui roulent avec la musique à fond dans leur bagnole (…) Je l’ai noté là : ça s’appelle atteinte à la tranquillité publique. C’est l’article 48-2 du Code de santé publique et ça peut donner lieu à des poursuites au pénal. » Un autre : « T’as vu les 130 euros pour un bâtard qui avait craché par terre en public ? (…) C’est super ce truc-là. Si j’en vois un qui crache, je lui colle un PV et, avec un peu de chance, ça se termine en rébellion. » ; « C’est pas Boudjema là-bas ? Je le croyais en taule. Il vient pas d’être jugé ? (…) Il perd rien pour attendre. On va bien lui trouver quelque chose pour lui faire sauter son sursis. T’inquiète, il va la faire, sa peine. »[15] Patrouille, contrôle d’identité de vendeurs à la sauvette, de migrants sans-papiers, de ‘‘shiteux’’, etc. Tout ceci ne fait pourtant pas illusion pour les plus lucides d’entre les fonctionnaires de police : « Si c’est pour ramasser des shiteux, c’est pas pour ça que j’ai fait ce travail. Moi, je suis entré dans la police pour attraper des voleurs. Je me rends compte que ce qu’on fait, ça sert à rien. Tout ce qui compte, c’est de faire du chiffre. Un gars avec une boulette de shit, c’est une interpellation : les chefs sont contents. »[16] On comprend dès lors que les cibles policières puissent être si souvent les mêmes. Que les « jeunes des quartiers populaires » soient davantage pris pour cible tient en grande partie au fait qu’ils sont, bon gré mal gré, assimilés aux « classes dangereuses », et que, de fait, effectivement, ils représentent statistiquement le contingent le plus nombreux de délinquants ou criminels condamnés et incarcérés ; en ce sens, ils constituent un papegai facile, quasi ‘‘naturel’’, adéquat au sens commun policier, permettant d’allier l’utile à l’agréable, le rationnel et le fantasme, principe de plaisir et principe de réalité : l’exigence des chiffres et, comme l’énonçait un policier, l’éventualité d’une « rébellion », réalimentant ainsi une justification sociale d’exister mise en difficulté par la morne quotidienneté.
§ 4. « Racisme institutionnel » ? – On en arrive à un point fondamental que trop mis en avant par certains militants et intellectuels antiracistes, à savoir l’idée selon laquelle la police serait, de façon indubitable, structurée par un « racisme institutionnel », comme le pense par exemple Paul Rocher[17]. En cause, les contrôles aux faciès, les interpellations, les violences et ‘‘bavures’’ policières touchant majoritairement les personnes dites racisées. Or, cette appellation ne résiste pas à une analyse sérieuse et dépassionnée. Pour qu’une pratique puisse, au sens strict, être considérée comme « institutionnelle », il faut nécessairement, comme l’explicitait finement Frédéric Lordon, qu’il y ait « une inscription formelle – déposée dans un texte d’institution »[18]. Or, de textes officiels consacrant une vision et une pratique explicitement raciste de l’activité policière n’existent pas – que ces militants le veuillent ou non. Donc, le terme de « racisme institutionnel » est impropre et faux. Lordon préfère le terme de « systémique », dans la mesure ou le « systémique », « à l’inverse de ‘‘systématique’’, qualifie, comme son nom l’indique, un effet de système, c’est-à-dire un effet produit par la composition d’une multiplicité de mécanismes sociaux informels, sans pôle ou sujet organisateur global – là où le ‘‘systématique’’ renvoie au contraire à une organisation consciente, délibérée, donc localisable »[19]. Cependant, là encore, le terme même de « systémique » ne l’est pas davantage, puisque « systémique », comme l’expose Lordon, suppose au fond un « procès sans sujet » (propre à une veine structuraliste), c’est-à-dire, sans conscience, sans volonté, sans décision localisable. Ce qui revient à postuler des effusions de racisme bien réels produites in abstracto par pur « effet de système ». Cette idée implique donc que le racisme puisse se produire sans même que les agents aient l’intention concrète de l’être ; le racisme se diffuserait donc au travers de normes et comportements de façon informelle et quotidienne au sein d’une institution, indépendamment de la conscience et de la volonté des individus.
Or, qu’on le veuille ou non, le racisme comme idée et pratique ne peut être qualifié comme tel que par son caractère intentionnel et conscient, sans quoi il ne s’agit que d’une pure conjecture dont le sujet accusé d’un tel blâme pourra de bon droit brocarder d’un revers de main, arguant qu’il n’en est rien et invoquant d’autres raisons très éloignées de tout racisme. En somme, pour avoir la certitude que les contrôles aux faciès soient animés par des mécanismes racistes et non d’autres mobiles, il faut nécessairement que les motifs que se donnent les acteurs soient implicitement ou explicitement racistes, quand bien même nous ne puissions pas le savoir en tant que les intentions sont par définition invisibles, cachées dans les poitrines – sauf lorsqu’elles sont ouvertement exprimées et soutenues dans le discours. En ce sens, et quand bien même il soit difficile de l’accepter, on ne peut en toute rigueur inférer de la surreprésentation des altercations des personnes racisées par la police, d’un indubitable racisme – encore moins institutionnel ou systémique –, car d’autres raisons (ou causes) peuvent être invoquées pour rendre compte de cette logique. En l’occurrence j’ai déjà donné quelques éléments de réponse plus haut : la police doit surveiller et arrêter les délinquants ; or, la délinquance se trouverait hypothétiquement – de façon réelle ou fantasmatique – dans les zones les plus précarisées ; ces zones sont massivement habitées par des populations « jeunes » et « racisées » ; donc, il y aurait une corrélation voire un lien de causalité entre zones précarisées, délinquance et jeunesse racisée ; donc, il serait ‘‘justifié’’ que la police exerce un contrôle tacite d’autant plus accru de ces espaces et de ces individus particuliers. Mathieu Rigouste au travers de la parole des ‘‘baqueux’’ ratifie cette idée, puisque ces derniers ont parfaitement conscience de se concentrer sur les mêmes types de profils :
« Q : Ben, la critique, c’est plutôt de dire, ‘‘la police elle tape sur les pauvres’’… – R : Mais y en a. Ça, c’est la facilité. On tape sur les pauvres… Y a une délinquance, c’est que des pauvres… Enfin, y a la grande délinquance financière, qui nous échappe complètement, c’est pas notre domaine. Mais c’est souvent des gens qui sont pauvres à la base, qui sont délinquants. Les trois-quarts, ils sont sans emploi, ils sont sans niveau d’étude, ils ont un casier judiciaire qu’a commencé tout petit parce que y avait pas d’encadrement familial, parce que les parents étaient complètement à l’ouest (…) Et ça, ça s’apprend petit à petit. Après, il y a des choses que t’apprends par exemple, même si faut pas faire du délit de faciès, etc., t’as des gens, des catégories… comment dirais-je ? de personnes qui font telle ou telle délinquance, et puis d’autres qui font telles ou telles choses. Ça ça s’apprend. T’as notamment les pickpockets, les tireurs, c’est souvent des gens, tu vois, des « blédards » on appelle, des gens qui viennent du Maghreb, c’est des mecs qui sont en situation irrégulière en France. Les mecs, pour te situer en général, c’est des mecs qui ont entre 25 et 40 ans et ils font que de la tire, c’est leur spécialité, je dis pas que t’auras pas un Black qui va pas faire de la tire, mais en général, c’est eux, ils font de la tire, ils font du vol à la tire, c’est leur spécialité. Donc… Ceux qui vendent la came, ceux qu’on appelle les ‘‘modous’’, c’est des Blacks, généralement, ce sont des Sénégalais, des Ivoiriens, des Zaïrois. Eux, ils vendent la came. Alors les “modous”, ils travaillent dans le métro, c’est-à-dire qu’ils parcourent les lignes de métro, ils ont des clients, des exemples, c’est des petits jeunes de cité qui ont entre 15 et 18 et qui sont spécialisés dans le vol arrache de téléphone portable, ou de sac à main, ou de tout ce qui peut se chourrer ou ce qui peut s’arracher. Ça, c’est les jeunes ça. […] En gros, ça te permet, quand tu vois dans la rue des choses comme ça, de dire ‘‘ah ben tiens, lui, il est peut-être à la tire’’, ‘‘lui c’est peut-être un cambrioleur’’, c’est juste pour te donner… Et ça, ça s’apprend à force d’en faire »[20]
Et tandis que Rigouste assimile nécessairement ces dires pour une évidente mentalité raciste et classiste propre à l’institution, il ne met pas en évidence que l’enquêté dévoile ici les catégories même de l’entendement policier structuré par cet a priori de la méchanceté du monde et cet illusio sotériologique de lui apporter protection, sécurité, ordre et salut.
§ 5. Racisme moral et perversité – Non seulement le syntagme de « racisme institutionnel » ou « structurel » est mauvais, mais surtout, il empêche de penser la réalité du racisme qui peut s’exprimer au sein de l’institution policière. Parce que ces militants antiracistes ont voulu faire une distinction fumeuse entre « racisme politique » et « racisme moral » à des fins de radicalité rhétorique et politique, et non conceptuelle, ils ont recouvert la réalité du racisme d’un halo d’idéologèmes sensationnalistes et assurément forts mobilisateurs à partir desquels toute pensée devient vaine ; et que, par ailleurs, les défenseurs de l’ordre établi peuvent aisément renvoyer à la nullité et l’inexistence. Je le rappelle, pour ces militants, il faut distinguer « racisme moral » et « racisme politique ». Le premier serait individuel et flagrant, le second serait collectif, adossé aux institutions, et beaucoup plus subtil. C’est justement cette « subtilité » qu’oblitèrent ces militants dans leur pensée du racisme. Je disais plus haut que, d’une part, il n’y a pas au sens strict de racisme institutionnel en tant que le racisme n’est pas formellement inscrit à mêmes les institutions – contrairement par exemple à l’inscription capitaliste ou républicaine – ; d’autre part, j’affirmais que, pour qu’il y ait véritablement racisme, il faut qu’il y ait conscience et intention raciste de la part d’acteurs agissant en connaissance de cause – fût-ce cette connaissance renvoyée dans la mauvaise foi. Qu’est-ce à dire ? Que c’est précisément parce qu’il n’y a pas de racisme institutionnel, que le racisme peut s’exprimer de façon aussi fourbe, pernicieuse, dissimulatrice, subtile en somme. C’est parce que le racisme n’existe pas formellement qu’il peut avoir cours informellement par des voies insoupçonnées et tortueuses. Ne pas admettre cela, c’est se condamner à ne pas voir le caractère foncièrement pervers du racisme – au sens clinique – en régime démocratique, républicain et libéral. D’où ce que j’avançais, à savoir que le racisme doit être intentionnel et conscient. Et, parce qu’il est et ne peut qu’être intentionnel et conscient, il (le racisme et le sujet-raciste) doit, pour pouvoir outrepasser la censure formaliste libérale-égalitaire de la Loi républicaine – explicitement antiraciste sur bien des points –, passer par le mensonge, c’est-à-dire, la dissimulation des intentions réelles à autrui. Comme l’exprime Jean-Paul Sartre : « le menteur a l’intention de tromper et il ne cherche pas à se dissimuler cette intention ni à masquer la translucidité de la conscience »[21]. Même dans la « mauvaise foi », persiste en réalité une unité de la conscience qui précisément détourne volontairement et en connaissance de cause son regard de la vérité, « je dois savoir très précisément cette vérité pour me la cacher soigneusement »[22].
Ici commence le caractère pervers de l’entreprise raciste du sujet, au sein des institutions. Car, qu’est-ce qu’être pervers, ou agir perversement ? C’est d’une part, faire le mal pour le mal, c’est même faire « pire que le mal » selon le mot de Pierre-Henri Castel[23], c’est-à-dire penser une sophistication et un perfectionnement dans l’agir mauvais ; mais aussi, jouir d’un acte dont on sait qu’on ne pourra prouver pleinement la culpabilité du suspect présumé, faute de preuve irréfutable ; bref, jouir des effets réels du mal causé tout en laissant la victime dans l’impossibilité de pouvoir répliquer et accuser en toute justice, en toute vérité, en toute certitude. Par exemple, lorsque j’évoquais plus haut (§ 3) l’usage par les policiers du droit comme arme punitive, chacun rivalisant d’ingéniosité pour aller aussi loin que possible dans l’escalade de la sanction, il s’agissait là d’un comportement pervers. Assurément, cette perversion n’a rien d’extrêmement effroyable, il n’en reste qu’elle épouse la forme classique d’une perversion. De la même manière, lorsque bon nombre de brigadiers de la BAC se permettent de « s’affranchir jusqu’à un certain point de la légalité pour imposer leur loi, avec cette idée que leur fin légitime justifiait leurs éventuels irrégularités » ; de telle sorte que, souvent, écrit Didier Fassin, « ils me confiaient avec satisfaction que, lorsqu’une opération de la police en tenue se passait mal, leur arrivée calmait immédiatement les individus concernés. Ils n’hésitaient pas à user de la force bien plus que ne le faisaient leur collègue (…) leur dureté faisait peur : ils le savaient et s’en flattaient. »[24] C’est en vertu de leur statut même de fonctionnaires de police, leur permettant de s’affranchir relativement de la Loi, qu’ils peuvent ainsi se permettre toutes sortes d’« excès » conventionnellement acceptés sous couvert de sécurité et de respect de l’ordre. Par conséquent, le sujet-pervers virtuel a toute la latitude – accordée par le droit lui-même – pour pouvoir jouir de ses propres exactions en toute impunité et surtout, toute indiscernabilité. En ce sens, le racisme exprimé et exercé par certains policiers est bel et bien pervers, comme l’exprimait la policière Sihem Souid :
« Un jour, je surprends la brute en train de s’en prendre à un sans-papiers. Il le fait comme à son habitude : en outrepassant ses droits et en abusant de son pouvoir. J’ai toujours pensé que le racisme n’expliquait pas à lui seul le comportement de ce genre d’individu. Je crois qu’ils éprouvent une espèce de plaisir pervers à s’acharner ainsi sur quelqu’un à leur merci. Il doit être conforté dans sa virilité en écrasant les autres »[25]
Les violences policières à l’endroit des personnes racisées ne sont donc pas le fait d’un racisme institutionnel mais bel et bien d’un usage et d’une exploitation raciste des outils institutionnels, un usage qui abuse, jusque dans ses limites les plus reculées, de ce que les normes permettent de faire. De là la perversité de la chose : pouvoir être raciste tout en étant dans son « droit ». Car, lorsqu’il y a excès univoque sur le droit, on est dans la « bavure », dans l’illégalité – du moins, tant qu’on ne s’est pas fait prendre ; d’où la pratique du « faux en écriture » par exemple. Mais le comble de la perversité (raciste), consiste précisément dans cette habileté à pouvoir épouser au plus près les contours de la norme ; pousser au plus loin les limites de la légalité ; voire, profiter des silences de la Loi, pour faire plier celle-ci dans le sens sadique désiré sans qu’il puisse y avoir de condamnation explicite et univoque puisque le sujet pervers joue de cette légalité, de son équivocité, de son interprétabilité, et de l’indiscernabilité de l’intention – en plus de sa position de pouvoir.
C’est par ce dispositif pervers que le racisme peut s’exprimer impunément tout en étant dénié de façon absolument justifiée. Toute pratique raciste pourra toujours, peu ou prou, être recouverte par la caution idéologique des fonctions, finalités, normes et valeurs de l’institution policière, et ce, en toute légitimité : le racisme potentiel étant effacé comme racisme ouvert et déclaré, substitué par la lutte contre la délinquance et la criminalité. Ainsi, les pratiques racistes pourront (toujours ?) se dissimuler insidieusement dans l’ensemble des pratiques institutionnelles sans crier gare. Raison pour laquelle il n’y a pas de racisme institutionnel ou systémique, mais bel et bien un racisme moral et individuel ; d’une ‘‘moralité’’ ô combien perverse ; s’exprimant non pas de façon systémique ou systématique, mais bel et bien sporadique. Moral car il relève d’une décision éthique délibérée en vue du « mal ». Individuel parce qu’il engage une conscience, une volonté et une intentionnalité déterminée et non pas un principe impersonnel – ce qui ne signifie pas que l’individu ne puisse qu’être isolé, il peut tout à fait rencontrer d’autres subjectivités partageant ses opinions morales, et ainsi constituer des collectifs. Sporadique, car il s’agit d’un phénomène disséminé, disparate, évanescent, qui surgit évènementiellement par la grâce d’une ou plusieurs volontés singulières, puis disparait dans l’anonymat collectif des rites institutionnels.
§ 6. Eichmann à Nanterre – S’il existe un effet de système ou d’institution propre à la police ce n’est pas tant le racisme que l’usage constant de la violence en toute légalité et légitimité (§ 2). Une chose m’avait particulièrement frappé au moment de l’affaire George Floyd. On a à juste titre considéré cet incident comme un crime raciste. Le meurtrier était connu pour ses opinions suprémacistes. Cependant, ce qui est sidérant dans cette scène, c’est le calme et l’imperturbable sérénité avec lesquels l’agent de police Derek Chauvin effectue cette mise-à-mort. Qu’on s’en souvienne, le policier exerça un plaquage ventral à la victime pendant près de neuf longues minutes. Ce plaquage fut effectué et poursuivi de façon méticuleuse, assurée, imperturbable, sous le regard de ses deux collègues lui passant les menottes, des téléphones portables des passants, et même de sa propre camera corporelle. Floyd répète pourtant à 27 reprises « Je ne peux pas respirer ! ». Rien n’y fait. Chauvin maintient Floyd au sol, le genou sur son cou. A aucun moment, ces deux collègues ne pesteront de quoi que ce soit. Chauvin ne laissera transparaitre aucune émotion, aucun trouble, aucun doute. Et pour cause : il a suivi la procédure. Du moins en apparence. Sa faute, en réalité, n’est pas tant d’avoir « violé les règles » comme le suggère le chef de la police de Minneapolis, mais d’avoir mal appliqué ces règles, ou de s’être égaré dans l’application de celles-ci – il a « innové », d’une innovation blâmable, à défaut de poser son genou sur le haut du dos, il la poser sur le cou ; d’où sa faute dans la violence : la violence à l’égard du dos était permise, celle du cou ne l’était pas. En vérité, à la question de savoir si l’agissement de Chavin était conforme à la règle « 5-300 », le chef de la police répond : « Non. (…) C’est, c’est… il faut que [l’usage de la force] soit objectivement raisonnable », cependant, il apparait qu’au moment de l’incident, la chose paraissait fort raisonnable aux yeux de l’« objectivité » de ses collègues, qui à aucun moment ne dirent mot. « Nous devons prendre en compte les informations sur les circonstances » ajoute-t-il ; justement, quelles sont-elles ces circonstances ? Floyd est manifestement dans un état second sous l’effet de stupéfiant, la police est appelée par l’un des gérants du magasin dans lequel il vient d’acheter un paquet de cigarette. Au moment de son interpellation il est quelque peu agité et apeuré, la police essaye de le faire rentrer dans la voiture de fonction ; ce dernier, tétanisé, s’y refuse, expliquant qu’il est « claustrophobe » ; il se débat, résiste, crie – refus d’obtempérer donc, voire même tentative de dérobade aux yeux des autorités. Jusqu’au moment où les policiers finissent par le plaquer au sol pour lui passer les menottes. Afin de le maintenir à terre, Chauvin effectue un plaquage ventral, bel et bien conforme à la règle « 5-300 ». Floyd s’époumone, « I can’t breath » ; que se disent sans doute Chavin et ses collègues qui persistent ? « Bah voyons. Après le coup du ‘‘Je suis claustrophobe’’, on a le droit au fameux ‘‘Je ne peux pas respirer !’’ A d’autres. » Donc la procédure se poursuit, inexorablement. Et, puisque l’homme est Noir, et que Chauvin n’en raffole pas vraiment, on forcera la pression sur le cou, le dos et les côtes, ni vu ni connu, histoire qu’il se fasse dessus. Ils peuvent bien me filmer et m’épier tous ces passants, les caméras de surveillance, le Soleil et Dieu lui-même, je suis dans les clous, dans les règles, dans l’amour de la Loi du comté de Minneapolis.
Il en va de même pour le cas du jeune Nahel. Qu’a fait le policier si ce n’est appliquer cet article de loi de 2017 du Code de la sécurité intérieure stipulant que :
« (…) les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale peuvent (…) faire usage de leurs armes en cas d’absolue nécessité et de manière strictement proportionnée : 1° Lorsque des atteintes à la vie ou à l’intégrité physique sont portées contre eux ou contre autrui ou lorsque des personnes armées menacent leur vie ou leur intégrité physique ou celles d’autrui ; 2° Lorsque, après deux sommations faites à haute voix, ils ne peuvent défendre autrement les lieux qu’ils occupent ou les personnes qui leur sont confiées ; 3° Lorsque, immédiatement après deux sommations adressées à haute voix, ils ne peuvent contraindre à s’arrêter, autrement que par l’usage des armes, des personnes qui cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations et qui sont susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d’autrui ; 4° Lorsqu’ils ne peuvent immobiliser, autrement que par l’usage des armes, des véhicules, embarcations ou autres moyens de transport, dont les conducteurs n’obtempèrent pas à l’ordre d’arrêt et dont les occupants sont susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d’autrui »
Après plusieurs signalements, plus de deux sommations à haute voix furent faites à l’égard du jeune adolescent, dont une menace tout à fait claire : « Je vais te tirer une balle dans la tête ! ». Dans des circonstances où un mineur sans permis de conduire à bord d’une imposant bolide, signalé pour de nombreux excès de vitesse ayant mis en danger certains riverains, et, n’étant pas légalement autorisé à conduire, aurait pu mettre en danger la vie d’autrui. Qui, de plus, après ordres réitérés de couper le moteur, de coups et de menaces, voient l’individu ne pas explicitement obtempérer, et, pis encore, voient le véhicule avancer avec à son bord des occupants « susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d’autrui »… la Loi, dans ces conditions générales, permettait effectivement aux policiers de « faire usage de leurs armes » puisque la « nécessité » s’y trouvait réunies au travers des points 1, 2, 3 et 4. Quant à la « proportionnalité », la Loi ne le précisait pas plus, elle était donc laissée à la libre appréciation de l’agent de police qui, dans le cas présent, jugea qu’il était préférable pour le bien commun et la sécurité de tous d’exécuter un adolescent de 17 ans non-armé d’une balle en pleine poitrine à bout portant, plutôt que de le laisser filer.
Le policier était donc bel et bien dans son « droit » – ne fût-ce que textuellement. Quoi qu’en disent ses contempteurs, dont le préfet de la ville de Nanterre lui-même – qui, en vérité, n’a fait que céder à la vox populi et à l’émotion que suscita une vidéo particulièrement virale et choquante ; mais combien de ‘‘Nahel’’ furent tués exactement de la même manière sans ces précieuses images pour témoigner de cette ignominie, et sans condamnation aucune ? L’agent de police a été rigoureusement conforme à ce permis de tirer, voire de tuer, pour refus d’obtempérer. Il a pharisiennement respecté la Loi du sang pour désobéissance. Son acte est donc licite, légal, parfaitement juste et justifié aux yeux de la Loi. Pour reprendre Hannah Arendt, « il est incontestable que [ce crime fut] commis dans le cadre d’un ordre ‘‘légal’’. »[26] Le bon policier, en son âme et conscience, accomplit son devoir en obéissant à la Loi des « crimes légalisés par l’État ». Et, à la manière du « petit homme », le bon policier eut considéré qu’il faille « faire plus qu’obéir à la loi », qu’il faille même « aller au-delà du simple impératif d’obéissance et identifier sa propre volonté au principe qui sous-tend la loi – la source d’où jaillit la loi »[27], la volonté de l’État et de sa police, ayant à neutraliser les « nuisibles ». « Obéir à la loi signifie non seulement obéir aux lois, mais aussi agir comme si l’on était le législateur des lois auxquelles on obéit. »[28] Raison pour laquelle, il dut sans nul doute se répéter à maintes reprises dans le creux de son cœur : « Je vais le faire un jour, je vais le faire. J’vais en buter un. » Peut-être même qu’il confessa ce désir à ses collègues, peut-être qu’ils partagèrent cette lubie : « Ah moi, c’est sur un jour j’vais m’en faire un. J’te le dis, j’en peux plus. J’en ai marre de ces petites merdes qui foutent le bordel partout où ils vont ! Faut leur montrer ça se passe comment ici ! » – peut-être que des « sales arabes » furent ajoutés ci-et-là. Et effectivement, il nous a bel et bien montré comment ça se passe ici. C’est dire combien il l’eut tant attendu ce moment. Combien il eut tant désiré cette Loi. Combien il eut tant fantasmé de cette rencontre opportune (kairos) du moment et de la Loi. Sa jouissance ne fut pas dans la transgression de la Loi mais bien dans l’application de celle-ci.
§ 7. Justice, souveraineté et violence – La décision du saint policier, aussi choquante qu’elle puisse paraître était « juste » – ou tout du moins légitime. En quel sens ? Comme l’expliquait Derrida, pour qu’une décision de justice soit considérée comme « juste », il convient qu’elle soit entreprise, décidée, effectuée par une volonté, une pensée, une conscience libre, autonome et responsable de son action, tout en se conformant au suivi scrupuleux d’une loi, d’une prescription, d’une règle préétablie. Mais cela ne saurait suffire ; pour qu’une décision soit juste, il faut « non seulement suivre une règle de droit ou une loi générale mais elle doit l’assumer, l’approuver, en confirmant la valeur, par un acte d’interprétation réinstaurateur, comme si à la limite la loi n’existait pas auparavant, comme si le juge l’inventait lui-même à chaque cas. (…) Bref, pour qu’une décision soit juste et responsable, il faut que dans son moment propre, s’il y en a un, elle soit à la fois réglée et sans règle, conservatrice de la loi et assez destructrice ou suspensive de la loi pour devoir à chaque cas la réinventer, la re-justifier, la réinventer au moins dans la réaffirmation et la confirmation nouvelle et libre de son principe. »[29] Il convient donc que le juge fasse constamment œuvre d’herméneute à partir de la Loi et du cas particulier afin de décider l’indécidable bon gré mal gré. Le juge est donc libre interprète du couple Loi/cas. Il doit, pour être « juste », au sens de la légalité et de la légitimité, procéder à un perpétuel effort d’interprétation renouvelé – proprement, un ijtihad au sens du droit musulman –, réalisé dans l’immédiateté du moment, sous la pression de l’urgence[30]. On le comprend, la police agit de la même manière qu’un juge. Elle dispose d’un pouvoir « discrétionnaire », c’est-à-dire, le pouvoir « de décider s’il faut intervenir et comment »[31]. Ce qui implique également qu’elle est, bon gré mal gré, législatrice. Elle s’appuie bien sur une Loi existante, certes, mais se doit constamment de la ré-interpréter, de l’actualiser, voire même, le cas échéant, de l’inventer tout bonnement dans le feu de l’action, en cas d’absence, de silence ou d’imprécision de la norme. La police, comme le mettait en évidence Walter Benjamin, mêle ainsi deux types de violence : la violence fondatrice du droit, et la violence conservatrice de celui-ci, disposant alors du pouvoir de vie et de mort sur les sujets de droit. La violence policière est certes « employée à des fins légales (avec droit de disposition), mais en même temps munie du pouvoir d’étendre cette violence de larges limites (avec droit d’ordonnance). »[32] Or, il n’y a pas de séparation entre ces deux types de violence (fondatrice et conservatrice) : « Toute violence en tant que moyen fonde le droit et le conserve ». La violence est donc à la fois l’archè et le conatus du droit : « Le ‘‘droit’’ de la police, écrit Benjamin, désigne bien davantage, au fond, le point où l’État, soit par impuissance, soit à cause de la logique immanente à tout ordre juridique, ne peut plus garantir avec les moyens de cet ordre les fins empiriques qu’il veut atteindre à tout prix. Ainsi, pour ‘‘garantir la sécurité’’, la police intervient dans d’innombrables cas où n’existe aucune situation juridique claire, quand elle n’accompagne pas le citoyen comme une contrainte brutale, sans aucune relation avec des fins légales, à travers une vie réglée par des ordonnances, ou simplement le surveille. »[33] En d’autres termes, la police est souveraine, car, comme l’expose Giorgio Agamben, le « paradoxe de la souveraineté » consiste précisément dans le fait que le souverain « est dans le même temps, à l’extérieur et à l’intérieur de l’ordre juridique »[34]. Ainsi, le « souverain » en ayant le pouvoir légal de suspendre la validité de la Loi, se pose légalement en-dehors de celle-ci. Et, puisqu’il est en-dehors de la Loi, dans son commencement comme dans sa fin, il peut en toute légitimité agir comme bon lui semble. Sa parole et sa praxis feront force de Loi. De là la facilité avec laquelle la police peut « interpréter, donner du sens, resignifier les règlements censés encadrer son activité » note pertinemment Geoffroy de Lagasnerie. Car, « les termes censés encadrer les pratiques de la police et ses modes d’intervention, comme ‘‘proportionnée’’, ‘‘strictement nécessaire’’, ‘‘susceptible d’avoir commis un délit’’, ‘‘aux abords immédiats’’, ‘‘menace’’, ‘‘indice’’, sont suffisamment (et volontairement) flous pour donner à la police le droit de les interpréter en situation comme elle le veut. La police est cette administration qui détient le monopole de la violence interprétative. »[35] Et ce sont ses attributs de souveraineté qu’elle partage en commun avec l’État qui le lui permettent.
§ 8. Le bandit, l’immigré et la faute – Comment rendre compte de cette vague immense de soutien à l’égard du policier inculpé pourtant pour homicide volontaire ? Comment comprendre ce nombre effarant de dons, pour une somme atteignant plus de 1,6 millions d’euros ? Comment saisir le si peu d’émotion et d’empathie du plus grand nombre vis-à-vis du jeune Nahel ? On peut, comme le font Kaoutar Harchi, Fatima Ouassak et bon nombre d’intellectuels et militants, invoquer l’idée d’une société majoritairement – voire totalement, « structurellement » – éprise par des idées, affects et pratiques racistes. On peut, effectivement, avancer que si Nahel a été tué, c’est parce qu’il était déjà « tuable » de façon a priori. Pesait sur lui « l’histoire française de la dépréciation des existences masculines arabes », pesait sur lui « le racisme (…) Il était exposé à ce risque », en tant que la « domination raciale tient toute entière à ce risque »[36]. On peut, à juste titre, expliquer le processus de « désenfantisation » des enfants racisés, à l’œuvre parmi les franges dominantes et racistes de la population, consistant « à n’accorder aucune indulgence particulière aux enfants appartenant à un groupe discriminé, à les traiter aussi violemment que les adultes de ce groupe » ; et ainsi se demander : « Combien de nos enfants sont morts à cause de cette désenfantisation ? Combien de nos enfants ont été tués par la police en toute impunité ? Combien de mères ont pleuré leurs enfants victimes de crimes racistes dans les tribunaux ? »[37]. Assurément. Que le racisme tue ou puisse tuer, il n’y a guère que les aveugles, les hypocrites et les pervers pour oser prétendre le contraire – et ils sont nombreux. Cependant, je pense qu’on ne peut réduire cette haine à une histoire de racisme ; encore faut-il entendre le discours des acteurs. Que nous disent ces contempteurs ? : un « lascar » de moins, qui s’en plaindra ? « Eux » y voient une raclure, une vermine, un « nuisible », comme dirait le syndicat de police Alliance :
« Face à ces hordes sauvages, demander le calme ne suffit plus, il faut l’imposer ! Rétablir l’ordre républicain et mettre les interpellés hors d’état de nuire doivent être les seuls signaux politiques à donner. (…) Nos collègues comme la majorité des citoyens, n’en peuvent plus de subir le dictat de ces minorités violentes. L’heure n’est pas à l’action syndicale mais au combat contre ces ‘‘nuisibles’’. »
C’est d’abord et avant tout, en tant que « ban-dits » que ces « hordes sauvages » doivent être réduites « hors d’état de nuire ». La bonne conscience de gauche s’écrira à coup sûr : « Fumisterie ! Ce n’est qu’une diversion pour cacher leur racisme. Que les racisés soient innocents ou coupables, ils les haïssent de tout leur cœur. » Peut-être bien. Mais cela n’est que conjecture. Une conjecture faisant fi du discours, de la réflexivité et de la pratique des acteurs, de telle sorte à leur imputer des intentions cachées qu’ils ne formulent pas, ne revendiquent pas, ne connaissent pas. Pourtant, ils parlent, ils pensent, ils sentent, ils agissent bel et bien selon des motifs qui leur sont propres et qu’ils revendiquent. On ne peut donc évacuer d’un revers de main les raisons que ces acteurs donnent et posent comme fondement de leur pensée et de leur agir – sans quoi, on se retrouverait face aux mêmes absurdités que ceux qui pensent que le port du voile par les jeunes femmes musulmanes est causé par le patriarcat, la misogynie religieuse et l’aliénation dont elles seraient les victimes. Puisque les acteurs mettent en avant la catégorie de « bandit », il faut donc penser celle-ci. D’ordinaire, le bandit est un personnage souvent mythifié, idéalisé et apprécié du « peuple ». Historiquement, selon Éric Hobsbawm, le bandit incarne « une forme primitive de protestation sociale organisée »[38] très appréciée des petites gens, au point de finir par les protéger, les défendre, les couvrir, les admirer. Comment devient-on un bandit ? : « Un homme devient un bandit en se livrant à des actes qui ne sont pas considérés comme criminels au regard des usages locaux, mais qui le sont par les autorités locales et par l’État »[39]. Mais qu’en est-il lorsque les actes auxquels se livre le bandit s’avèreraient également « criminels » aux yeux des populations locales majoritaires ? Et bien, le bandit se voit lâché par ses protecteurs : on le dénonce aux autorités, on le livre, on le conspue, car « les victimes habituelles du bandit sont [et doivent être] les ennemis du pauvre »[40], mais dès lors où le hors-la-Loi contrevient à cette règle, il devient le paria de tous et de toutes. Dans cette perspective, on comprend combien le fameux « lascar » de banlieue puisse devenir la figure honnie des « honnêtes gens » – même au sein de leur propre « groupe social » dont ils sont organiquement reliés – en plus des tenants-lieux traditionnels du Pouvoir. C’est que, en orientant le principal de leurs exactions vers les plus faibles à défaut des seuls puissants, ils s’aliènent ceux qui auraient été les plus susceptibles de les défendre, provoquant chez ces derniers, colère, agacements, ressentiment, dégout et peur. Agacement et peur qui s’expriment par exemple dans « l’attachement des milieux populaires à la propriété de biens matériels (notamment l’automobile et le logement) souvent durement acquis et de ce fait hautement symboliques, qui ne peut que donner prise à l’obsession sécuritaire face à la montée de la petite délinquance. »[41] Obsession sécuritaire d’autant plus accrue qu’elle se pare de tous les fantasmes paranoïaques de « Grand Remplacement », « Décivilisation », « Décadence », « Séparatisme islamiste », et autres lubies alimentant plus encore une panique morale psychotique.
Le « racisme » n’est donc qu’un facteur aggravant de cette défiance et révulsion généralisée. Ne pas comprendre l’hostilité envers la « délinquance », c’est être aussi aveugle et malhonnête que ne peuvent l’être les chantres de l’extrême droite à l’égard des personnes racisées. Car, non, il faut le dire et le répéter, contrairement à ce qu’avançait Fatima Ouassak au lendemain du drame de Nanterre : la praxis policière n’a pas pour vocation d’« empêcher de circuler » les jeunes garçons noirs et arabes du simple fait qu’ils soient Noirs et Arabes. Le petit Nahel n’a pas été interpellé parce qu’il circulait innocemment dans son quartier d’un point A à un point B. Il a été interpellé par deux agents parce qu’il roulait à toute vitesse dans une voiture de course sans permis de conduire mettant en danger les passants. Ceci est un fait. Et il a été tué à bout portant, sans pitié aucune, d’une balle en plein cœur des mains de la police pour un délit qui, aux yeux de la moralité la plus élémentaire – et, peut-être, de la Loi –, ne méritait aucunement un tel déferlement de cruauté et d’inhumanité. Ceci est un fait. Abdelmalek Sayad, contrairement à ses prétendus continuateurs, ne perdait jamais ceci de vue. Pèse sur l’immigré et le descendant d’immigré une double culpabilité, et donc, une double peine. Sayad comprenait que la « délinquance » était l’élément clef pour comprendre le rapport entre l’immigration et la perception et la gestion que pouvait en faire l’État. La délinquance de l’immigré (et du descendant) ne relève pas seulement du délit classique, mais d’un délit de « situation », un délit « statutaire », en tant que « l’étranger (le non-national) n’est soumis à la compétence et à l’autorité de l’État dont il ne participe pas mais sur le territoire duquel il réside, vit et travaille, qu’en raison de sa présence et pour le temps de sa présence »[42], d’une présence donc toute contingente et accidentelle. Dès lors, le fait d’être immigré ou perçu comme tel est donc un facteur aggravant, non neutre, dans l’appréciation que l’on se fait de la délinquance perpétrée par de tels individus. Le prédicat d’« immigration » constitue une faute additionnelle, un « délit supplémentaire » s’ajoutant au délit réel. En ce sens, « Tout procès d’immigré délinquant est un procès de l’immigration essentiellement comme délinquance en elle-même et secondairement comme source de délinquance. Ainsi, avant même que l’on puisse parler de racisme ou de xénophobie, la notion de double peine est contenue dans tous les jugements pris sur l’immigré (et pas seulement les jugements des juges des tribunaux). »[43] Le « problème » de l’immigré, de l’étranger, du point de vue de l’hôte, c’est son « intrusion », son caractère et stigmate d’« intrus » ; son introduction soudaine, sans en avoir le « droit » légitime – ou perçu comme tel –, dans un lieu, une place, un antre, un oikos ; et toute la question est de savoir jusqu’à quand, il reste « étranger » à la terre d’accueil ; comme si sa venue ne cessait pas, se prolongeait indéfiniment, explique Jean-Luc Nancy, « il continue à venir, et elle ne cesse pas d’être à quelque égard une intrusion (…), un dérangement, un trouble dans l’intimité. »[44] tout autant que dans la « pureté » homogénéisante de la nation – le Même rassure. L’étranger, l’immigré, l’immigration est « faute » dans la mesure où elle met-à-mal, met-en-défaut autant l’hôte que celui qui arrive ; et que, de ce fait, elle entraine d’autres fautes, d’autres maux, pour une société peu ou mal préparée à l’hospitalité – ou tout simplement, se refusant purement et simplement à l’hospitalité. De là que l’immigration est une « faute générative » nous dit Sayad, car que faire de l’intrus ? Devant l’intrus on est nécessairement pris au dépourvu. Comment gérer sa présence indésirable – l’éradiquer, la contenir, l’écarter aux marges, l’exploiter – ? ou, si elle ne l’est pas, comment s’occuper de lui, comment dignement accueillir l’Autre – on a-t-on la volonté, la capacité, les moyens ? Et plus encore, devant l’intrus, devant l’étranger, existe également la peur (ou la curiosité). En l’occurrence ici, la peur de ce qui n’est pas soi, d’une part ; et la peur de ce qui est structurellement dépourvu, démuni de tout ou presque tout, d’autre part – puisqu’initialement non-Nôtre, non-Même, celui dont on sait au fond qu’il constitue le laissé-pour-compte volontaire et dont on craint la révolte. Donc, plane sur cette horde d’étrangers le spectre de la constitution d’une nouvelle classe dangereuse à même d’ensauvager la précieuse maisonnée.
Que le fils de l’immigré puisse hériter du même fardeau que son père tombe sous le sens, dans la mesure où on lui pardonne mal d’avoir fait dérailler la chaine de la reproduction traditionnelle et consacrée de l’être-en-commun ayant pour fin de produire du Même. Les descendants d’immigrés constituent le « comble de l’impolitesse », en tant que bâtards, hybrides, anomalies, ne partageant pas « totalement les propriétés qui définissent idéalement l’immigré intégral, l’immigré accompli, conforme à la représentation qu’on s’en fait (…) : ils sont des ‘‘immigrés’’ qui n’ont émigré de nulle part »[45], bref, qui ne sont pas des étrangers au sens strict du terme. Ils brouillent donc les frontières symboliques de l’entendement stato-national. Et, tandis que leurs parents s’évertuaient tendanciellement à faire preuve d’« exigence de politesse » – c’est-à-dire, à rester discrets, retirés, soustraits de la vie de la cité, tant au niveau social, culturel que politique –, ces énergumènes ne se privent pas de s’afficher et de gesticuler dans l’espace public, faisant de l’« exigence d’impolitesse » – au sens figuré comme au sens strict – leur signifiant-maître. L’autochtone est donc quelque peu désemparé devant ce type de créature. L’immigré savait se tenir, il devait savoir se tenir, sous peine d’expulsion immédiate, consacrant ainsi la souveraineté de l’État et de sa nation – réitérant ainsi le « rappel de position » entre le sujet légitime et celui qui ne l’est pas. Mais comment expulser celui qui désormais, bon gré mal gré, est des « nôtres » ? On comprend ainsi qu’à chaque « évènement traumatique » dans lequel sont impliqués les fils d’immigrés, revienne sur le tapis l’inéluctable question de la « déchéance de nationalité ». Car, à l’endroit du descendant d’immigré « non seulement toute faute, toute infraction, est interdite, mais quand elle advient, elle est alors punie en conséquence, c’est-à-dire pour ce qu’elle est incontestablement, mais aussi souterrainement et secrètement, pour ce qu’en est l’auteur, ce type d’auteur qu’on continue à regarder, bien que l’immigré qu’il est ait changé par rapport au modèle antérieur, comme étant toujours illégitime, non autorisé à commettre des infractions, comme interdit de faute, comme n’ayant pas droit au délit »[46] – au point même où les chantres d’une certaine gauche finiraient presque, risiblement, par défendre, applaudir et encourager ladite délinquance immigrée. Qu’on ne s’étonne donc pas si, pour expliquer les violences urbaines de ces derniers jours, les uns et les autres – à droite –, allèrent chercher dans l’ensemble de l’imaginaire de la pathologisation territoriale, de l’anomalie nationale, de l’impossibilité d’une greffe, du défaut d’intégration, du conflit des loyautés et autres fantaisies du même type, le principe générateur de telles exactions : « C’est pas nouveau que des déracinés deviennent violents et nihilistes, c’est pas nouveau » ; « Il y’a une haine de la France chez ces jeunes », pouvait-on entendre. Il y’a surtout un « haine » chez ceux qui, désormais entièrement submergés par l’angoisse et la psychose que l’abolition de la frontière symbolique entre le « eux » et le « nous » génère, persistent à tenir pour illégitimes ceux qu’ils désirent absolument et arbitrairement retrancher dans les marges de l’illégitimité. Et qu’est-ce qu’être « illégitime » ? C’est n’avoir d’existence et de nécessité à l’existence que sous conditions de – sous conditions d’être davantage « Français » par exemple – ; c’est ne point être nécessaire d’une part, et d’autre part, exister malgré tout, mais sous forme dégradée, secondaire, profane, non-consacrée[47] – ou peut-être que si, justement, que trop « sacré ».
 § 9. Qui peut être tué ? – Mais revenons à la question du « bandit ». Comment passe-t-on de la double peine propre à la figure de l’immigré et de son descendant, au « meurtre » pur et simple ? Sur ce point, Agamben nous a livré une explication ô combien éclairante. Le bandit est celui qui est retranché dans le lieu du ban, proprement la ban-lieue. La vie humaine qui est capturé dans le « ban souverain » est celle qui est exposée au meurtre licite sans qu’elle ne puisse être mise-à-mort dans les formes sacrées, c’est-à-dire sacrifiable, il y a dans cette vie, celle de l’homo sacer, impunité de l’homicide et exclusion du sacrifice[48]. Comme expliqué plus haut (§ 1), le souverain est celui qui peut décréter l’état d’exception en tant qu’il se situe à l’extérieur de la Loi de la même façon que le bandit. Sur le bandit peut donc s’exercer pleinement la suspension de la Loi, en toute légitimité. En somme, l’homo sacer est l’homme sur qui pèse une double exclusion : exclu de la Loi, exclu du sacré, tout en y étant capturé ; sa vie est laissée à l’a-ban-don, exclu de la communauté tout en y étant inclus, concomitamment à l’intérieur et à l’extérieur de la société. Il peut donc impunément être mis-à-mort sans que l’on commette d’homicide à son égard. C’est là toute l’idée exprimée par un pan de l’opinion publique et de l’institution policière à propos du « combat contre ces nuisibles ». Les « nuisibles » peuvent être mis-à-mort sans aucuns griefs puisque banni symboliquement – et physiquement – de la communauté légitime. Ni véritablement citoyen, ni totalement étranger, le bandit immigré, doublement fautif, se voit en puissance exposé à la vendetta hors de tout droit. Car, in fine, c’est aussi bien de cela dont il s’agit dans cette affaire de Nanterre. Le fonctionnaire de police investi de toute l’autorité légale, aura usé de son pouvoir non pas seulement pour faire respecter la Loi, mais bel et bien également pour jouir perversement d’une forme de vendetta, censée, peut-être, répondre au dommage que subissent les « siens » quotidiennement – et, le soutien populaire dont il fut gratifié ne peut que laisser songeur –, de façon démesurée, disproportionnée – un meurtre en bonne et due forme, placide et maitrisé –, engageant une relation personnelle avec la victime fût-elle renvoyée à une figure idéale-typique de « bouc-émissaire » – il paiera pour les « autres » –, et mettant en jeu un ensemble d’affects mêlant jouissance et passions tristes[49].
§ 9. Qui peut être tué ? – Mais revenons à la question du « bandit ». Comment passe-t-on de la double peine propre à la figure de l’immigré et de son descendant, au « meurtre » pur et simple ? Sur ce point, Agamben nous a livré une explication ô combien éclairante. Le bandit est celui qui est retranché dans le lieu du ban, proprement la ban-lieue. La vie humaine qui est capturé dans le « ban souverain » est celle qui est exposée au meurtre licite sans qu’elle ne puisse être mise-à-mort dans les formes sacrées, c’est-à-dire sacrifiable, il y a dans cette vie, celle de l’homo sacer, impunité de l’homicide et exclusion du sacrifice[48]. Comme expliqué plus haut (§ 1), le souverain est celui qui peut décréter l’état d’exception en tant qu’il se situe à l’extérieur de la Loi de la même façon que le bandit. Sur le bandit peut donc s’exercer pleinement la suspension de la Loi, en toute légitimité. En somme, l’homo sacer est l’homme sur qui pèse une double exclusion : exclu de la Loi, exclu du sacré, tout en y étant capturé ; sa vie est laissée à l’a-ban-don, exclu de la communauté tout en y étant inclus, concomitamment à l’intérieur et à l’extérieur de la société. Il peut donc impunément être mis-à-mort sans que l’on commette d’homicide à son égard. C’est là toute l’idée exprimée par un pan de l’opinion publique et de l’institution policière à propos du « combat contre ces nuisibles ». Les « nuisibles » peuvent être mis-à-mort sans aucuns griefs puisque banni symboliquement – et physiquement – de la communauté légitime. Ni véritablement citoyen, ni totalement étranger, le bandit immigré, doublement fautif, se voit en puissance exposé à la vendetta hors de tout droit. Car, in fine, c’est aussi bien de cela dont il s’agit dans cette affaire de Nanterre. Le fonctionnaire de police investi de toute l’autorité légale, aura usé de son pouvoir non pas seulement pour faire respecter la Loi, mais bel et bien également pour jouir perversement d’une forme de vendetta, censée, peut-être, répondre au dommage que subissent les « siens » quotidiennement – et, le soutien populaire dont il fut gratifié ne peut que laisser songeur –, de façon démesurée, disproportionnée – un meurtre en bonne et due forme, placide et maitrisé –, engageant une relation personnelle avec la victime fût-elle renvoyée à une figure idéale-typique de « bouc-émissaire » – il paiera pour les « autres » –, et mettant en jeu un ensemble d’affects mêlant jouissance et passions tristes[49].
§ 10. Haine du prochain et Stasis – Dans un tweet succédant au drame de Nanterre, l’intellectuel et militant d’extrême droite, Julien Rochedy, s’exprimait ainsi :
« Il est clair maintenant qu’il y a deux France. Chacune a désormais ses propres morts. L’une pleure des petites filles assassinées, des professeurs martyrs, des bébés poignardés et des victimes du terrorisme. Elle fait des marches blanches et s’indigne sur Twitter. Mais c’est déjà trop. C’est de la récupération d’extrême-droite. L’autre gémit quand des délinquants meurent de la main d’un policier. Elle brûle, casse, attaque : elle montre sa force. Ce n’est pas de la récupération, c’est de la juste indignation de gauche. Nous n’avons déjà plus les mêmes morts, nous n’aurons plus les mêmes enfants. Nous n’aurons donc aucun avenir en commun. »
Rien de nouveau sous le soleil. Dans d’autres lieux, on nous explique en quel sens une « communion des larmes » entre « eux » et « eux », s’avère impossible : comment pourrait-on pleurer les victimes d’un peuple de bourreau, tandis que les victimes des peuples de victimes, elles, ne font l’objet d’aucunes larmes ? Charlie ? On en est pas. Il n’y aura pas de larmes pour eux, et ce n’est que justice pour ceux qui ne furent jamais pleurer.
Quand un adolescent de 17 ans se fait assassiner d’une balle en plein cœur par un agent de police, Rochedy y voit la juste rétribution d’un « délinquant ». Pourquoi pleurer ? Quand des journalistes et dessinateurs se font mitrailler dans leurs locaux, c’est la juste rétribution des injustes, le karma en somme – le « retour de flamme » de Kamelancien. Qui est mort ? Ni un enfant, ni des innocents. Pour les uns, un agent de la voyoucratie, de la décivilisation et du « Grand remplacement ». Pour les autres, des fonctionnaires de l’Empire, de la blanchité raciste, paternaliste et islamophobe.
Jésus pourtant dit : « Vous avez appris qu’il a été dit aux anciens : Tu ne commettras pas de meurtre ; celui commettra un meurtre en répondra au tribunal. Et moi, je vous le dis : quiconque se met en colère contre son frère en répondra au tribunal ». Il dit également : « Vous avez appris qu’il a été dit : œil pour œil et dent pour dent. Et moi, je vous dis de ne pas résister au méchant. Au contraire, si quelqu’un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l’autre. A qui veut te mener devant le juge pour prendre ta tunique, laisse aussi ton manteau. » Il ajouta : « Quiconque vit par l’épée, périra par l’épée. » Il dit enfin : « Vous avez appris qu’il a été dit : Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Et moi, je vous dis : Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d’être vraiment les fils du Père qui est aux cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et les injustes. Car si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense allez-vous en avoir ? ».
Quiconque ne pleure pas du malheur ou de la mort du prochain, c’est comme s’il avait déjà tué son propre frère dans son cœur. Et cela fait bien longtemps que le prochain tout comme le frère sont morts dans le cœur des hommes de cette nation. Cette « impossible communion des larmes » signifie la fin même de ce peuple. Agamben nous rappelle ce que signifie stasis (guerre civile) pour les grecs : « la guerre civile assimile et rend impossibles à distinguer le frère et l’ennemi, le dedans et le dehors, la maison et la cité. Dans la stasis, le meurtre de ce qui est le plus intime ne se distingue pas du meurtre de ce qui est le plus étranger. »[50] La stasis est l’entrée – la politisation – du familier (l’oikos) dans la cité, dans le politique (polis), et de la polis (liens politiques) dans la famille : « la maison s’excède en cité et la cité se dépolitise en famille ». Ainsi nait la mise-à-mort du prochain, qui, initialement, était frère en cité, par cette érection et infiltration de la « famille » dans la cité, la « famille privée » se politisant, universalisant son caractère privé, ferraillant contre d’autres volontés privées s’universalisant elles aussi ; et, réciproquement, la cité politique (polis) se dépolitisant, n’agissant plus comme un ordre politique digne de ce nom – impartial, universel et souverain –, se pervertissant en se familiarisant, agissant comme une famille lambda, un oikos privé comme les autres, tout en persistant à vouloir préserver illusoirement les apparences d’un État fort et sûr de lui-même ; se présentant comme ‘‘rassurant’’, ‘‘protecteur’’, ‘‘gestionnaire’’, simulant (encore) la légitimé de la polis en voie, pourtant, de total délitement.
§ 11. Régression vers les origines françaises – Le patron des sénateurs LR, aux lendemains de ces quelques nuits d’« émeutes », tenta de rendre compte de ces violences urbaines à partir d’une grille de lecture qui lui est propre : « Certes, explique-t-il, ce sont des Français, mais ce sont des Français par leur identité et malheureusement pour la deuxième, troisième génération, il y a comme une sorte de régression vers les origine ethniques ». J’ai déjà parlé plus haut de ce lieux-commun renvoyant constamment le descendant d’immigré à ses origines sous prétexte de délits commis (§ 8.). Ce qui est intéressant serait de voir si, effectivement, les violences urbaines dont ces jeunes furent les principaux acteurs, témoigneraient d’une irrépressible « régression vers [leurs] origines ethniques ».
Que reproche-t-on en particulier à ces jeunes émeutiers ? Non pas vraiment le fait qu’ils se soient attaqués à des policiers, des commissariats, voire des mairies. Car, après tout, n’importe qui peut concevoir qu’en pareil cas, il pouvait s’agir de « bonne guerre ». Non, ce qu’on a moins pardonné en réalité, c’est bien davantage le vandalisme, le vol, le pillage de magasin. Après tout, les Arabes et les Noirs ne sont-ils pas voleurs et casseurs dans l’âme, comme pourrait le laisser suggérer ce bon vieux Zemmour ? Pourtant, à y regarder de plus près il semblerait davantage que toute cette barbarie soit plus française qu’il n’y parait. Dans un texte hautement subversif, Français, encore un effort si vous voulez être Républicain, Sade s’en va en guerre contre les idées des Droits de l’Homme en radicalisant ces dernières. L’égalité de tous apparait pour le divin Marquis comme une abomination faite contre la nature et la vie : « c’est une injustice effrayante que d’exiger que des hommes de caractères inégaux se plient à des lois égales : ce qui va à l’un ne va point à l’autre », écrit-il. Mais admettons l’« égalité », jusqu’où pourrait nous amener l’implication conséquente d’un tel principe ? Sade, jusqu’auboutiste exaspérant, répond :
« J’oserai demander, sans partialité maintenant, si le vol, dont l’effet est d’égaliser les richesses, est un grand mal dans un gouvernement dont le but est l’égalité. Non, sans doute : car, s’il entretient l’égalité d’un côté, de l’autre il rend plus exact à conserver son bien. Il y avait un peuple qui punissait non pas le voleur, mais celui qui s’était laissé voler, afin de lui apprendre à soigner ses propriétés (…) Je vous demande maintenant si elle est bien juste, la loi qui ordonne à celui qui n’a rien de respecter celui qui a tout. Quels sont les éléments du pacte social ? Ne consiste-t-il pas à céder un peu de liberté et de ses propriétés pour assurer et maintenir ce que l’on conserve de l’un et de l’autre ? (…) de quel droit celui qui n’a rien s’enchaîne-t-il sous un pacte qui ne protège que celui qui a tout ? (…) Un serment doit avoir un effet égal sur tous les individus qui le prononcent ; il est impossible qu’il puisse enchaîner celui qui n’a aucun intérêt à son maintien, parce qu’il ne serait plus alors le pacte d’un peuple libre : il serait l’arme du fort sur le faible, contre lequel celui-ci devrait se révolter sans cesse… »[51]
A la manière de la critique marxiste à venir, pour Sade, l’égalité juridique, formelle, doit donc être accomplie par l’égalité réelle, vitale, celle qui permet d’étancher la soif et rassasier la faim. Ainsi, conclut-il : « ne prononcez aucune espèce de peine contre celui qui vole ; songez que votre serment l’autorise à cette action et qu’il n’a fait, en s’y livrant, que suivre le premier et le plus sage des mouvements de la nature, celui de conserver sa propre existence, n’importe aux dépens de qui ». Dès lors, parmi les émeutiers, comment en vouloir aux voleurs de denrées alimentaires ? ils n’exprimaient là que leur complexion française, dans un pur esprit sadien.
Mais, en réalité, Sade ne s’arrête pas seulement au nécessaire besoin de conservation et de persistance de l’existence. Il étend sa démonstration au principe même de jouissance. Pour lui, toute jouissance est libre : nous sommes libres de jouir de tout et de tous, en tant que sujet libre et en tant qu’il ne saurait exister de propriété irréfragable : « Jamais un acte de possession ne peut être exercé sur un être libre ». Il écrit : « Je n’ai nul droit à la propriété de cette fontaine que je rencontre dans mon chemin, mais j’ai des droits certains à sa jouissance ; j’ai le droit de profiter de l’eau limpide qu’elle offre à ma soif ; je n’ai de même aucun droit réel à la propriété de telle ou telle femme, mais j’en ai d’incontestables à sa jouissance ; j’en ai de la contraindre à cette jouissance si elle me la refuse par tel motif que ce puisse être »[52]. En ce sens, pour Sade, la jouissance que peut procurer un corps quel qu’il soit relève de l’ordre du commun, du bien public. Dès lors, nul n’est réellement propriétaire de la jouissance qu’un étant peut procurer, pas même mon propre corps ; qu’en serait-il alors d’une banale marchandise ? Le désir est donc « tout aussi naturel que la faim ou la soif et [il] serait criminel de l’interdire », commente Bernard Edelman. Par conséquent, comment blâmer les pilleurs de marque de luxe et autres caprices ? tandis qu’ils ne faisaient qu’appliquer ici, à sa juste mesure, le principe de démesure sadien, dans la plus pure tradition française du marquis.
§ 12. Pulsion de mort et simulacre – On ne peut donc que souscrire à ce que pouvait en dire Raphael LLorca, lorsqu’il expliquait dans l’une de ses chroniques récentes que : « Dans une société des marques qui impose une fiction par laquelle les individus peuvent, grâce à des actes de consommation, renforcer, modifier ou réparer une identité qui est conçue comme essentiellement incomplète, voire blessée, qu’en est-il des exclus de la consommation ? Après avoir été biberonné à l’idée qu’il y avait des produits qu’ils ne pouvaient pas ne pas avoir, le fait d’en être privé entraîne une vraie souffrance symbolique – d’où l’idée d’une ‘‘cocotte-minute consommatoire’’, qui ne peut qu’exploser. Ainsi, concluait Benoit Heilbrunn, ‘‘la constante séduction marchande s’opérant sur des groupes sans pouvoir d’achat peut conduire à terme à une explosion sociale qui serait l’exutoire naturel d’une frustration consommatoire’’ »[53]. Comment ne pas comprendre cette tentation donc, que de pouvoir « péta » ce qu’il y a à « péta » dans un moment d’euphorie collective, d’éclipse et d’indifférenciation du culturel, pour reprendre René Girard ? Après tout, « le voyou, le casseur, etc., écrivait à juste titre Mehdi Belhaj Kacem, est, bien entendu, du point de vue qui est le sien, celui qui sait qu’il ne peut avoir accès aux biens du capitalisme par la voie légale ; et prend, de sang chaud, le chemin le plus court pour s’en emparer. (…) Pourquoi est-ce que quelqu’un dont les conditions d’existence interdisent de pouvoir jamais accéder au luxe capitaliste par la voie légale ne s’essaierait-il pas, quand il peut, à la voie qui lui soit praticable ? »[54] Car, in fine, « il n’y a jamais eu d’autre réel du marxisme, dans la lettre stricte du texte, que celui-là : le communisme est un capitalisme pour tous. »
Mais, et c’est bien là tout le problème, ceux qui ont volé n’ont, au fond, pas grand-chose à voir avec les véritables miséreux de ce siècle peuplant le globe. Non. Ils appartiennent de fait aux plus nantis d’entre les « pauvres ». Leur manque n’est pas dans le pain, leur souffrance n’est pas dans le travail harassant, leur détresse n’est pas la contingence de l’existence matérielle, mais bel et bien dans le désir fétichiste du dernier IPhone, de la nouvelle paire de requins, ou du jogging Lacoste. Bref, le désir (vital) de la marchandise. Un désir qui, parce que castré, frustré, empêché par leurs conditions et positions sociales basses ou moyennes, régresse en pulsion – pure complexion consommatrice, et donc destructrice de l’objet. Une « pulsion de mort »[55] qui s’est ouvertement exprimée en ces quelques jours d’émeutes par un déferlement de violence, de saccage et de rapts.
C’est également pour cette raison que le caractère foncièrement « politique », « révolutionnaire », « subversif », de ces mouvements est quelque peu douteux, quoi qu’on en dise. Que les premiers moments de cette révolte puissent être politiques, contestataires, indignées, assurément. Et, c’est pour cette raison que les premières cibles des émeutiers furent les commissariats, les policiers voire les mairies, soit, les lieux et les personnes de pouvoir. Cependant, le fait que ces heurts finirent très rapidement par s’estomper et s’orienter vers des objets tout à fait hors de propos de la stricte lutte contre l’injustice et l’oppression, ne peut que laisser perplexe quant au caractère intrinsèquement et consciemment politique que veulent absolument y voir un certain pan de la gauche. Or, force est de constater, comme le fait implacablement Ivan Segré, que « dans cette affaire, les émeutiers, le gouvernement et les syndicats de la police sont parfaitement homogènes à l’ordre idéologique dominant ici, à l’Ouest [à savoir l’ordre néolibéral et capitaliste]. A vrai dire, ils en sont des rouages, chacun jouant sa partition, que ce soit celle du bourreau ou de la victime, du policier ou du bandit, du riche ou du pauvre. Ou pour le dire autrement, le véritable refus d’obtempérer, c’est celui qui vous situe à une autre place que celle que l’ordre dominant vous assigne. Or, à mon sens, ces émeutes situent la jeunesse révoltée des ‘‘banlieues’’ à la place qui lui est assignée. Pour preuve, il n’y a eu strictement rien d’imprévisible lors de ces émeutes : ni les cibles, ni les modes opératoires, ni les participants. La retenue policière elle-même était prévisible. Comme sont prévisibles la répression judiciaire impitoyable qui va s’abattre sur les ‘‘interpellés’’ et les mesures gouvernementales d’aides aux quartiers sinistrés. Bref, tout était prévisible. Et c’est là le signe que rien ne s’est passé. »[56]
__________________________________________________________________________________
[1] https://www.police-nationale.interieur.gouv.fr/Presentation-generale
[2] Jacques Derrida, La bête et le souverain, Volume 1, Galilée, Paris, 2008, p.38
[3] Grégoire Chamayou, Les chasses à l’homme, La fabrique, Paris, 2010, p.128
[4] Max Weber, Le Savant et le Politique, Pocket, Paris, 1959, p.113 ; en vérité, la police ne détient jamais totalement le « monopole » de la violence.
[5] Dominique Monjardet, Ce que fait la police. Sociologie de la force publique, La découverte, Paris, 1996, p.22
[6] La fameuse interpellation qu’a thématisée Althusser dans son texte « Idéologie et appareils idéologiques d’État ».
[7] Max Weber, La domination, La découverte, Paris, 2015, p.49
[8] Geoffroy de Lagasnerie, Assa Traoré, « Qu’appelle-t-on ‘‘violence policière’’ », in Le Combat Adama, Stock, Paris, 2019, p.133
[9] La bid’a dans la théologie musulmane consiste dans la production d’innovations religieuses, que ce soit dans l’ordre du culte ou du dogme ; elle est considérée dans une large partie des cas comme blâmables – bien qu’il puisse exister également, ci-et-là, des innovations non-blâmables.
[10] Xavier Crettiez, Les formes de la violence, La découverte, Paris, 2008 p.48
[11] Dominique Monjardet, opus cité, p.22
[12] L’institution judiciaire participe en ce sens pleinement de cette mission, assurément.
[13] Didier Fassin, La force de l’ordre. Une anthropologie de la police des quartiers, Seuil, Paris, 2015, p.101-115
[14] Mathieu Rigouste, La domination policière, La découverte, Paris, 2021
[15] Didier Fassin, La force de l’ordre, opus cité, p.120-21
[16] Ibid., p.129
[17] Paul Rocher, « Mort de Nahel : le non-dit du racisme institutionnel », L’Obs, 1er juillet 2023
[18] Frédéric Lordon, Figures du communisme, La fabrique, Paris, 2021, p.236
[19] Ibid., p.235
[20] Mathieu Rigouste, La domination policière, opus cité, p.250-54
[21] Jean-Paul Sartre, L’être et le néant. Essai d’ontologie phénoménologique, Gallimard, Paris, 1943, p.82
[22] Ibid., p.83
[23] Pierre-Henri Castel, Pervers, analyse d’un concept, Les Éditions d’Ithaque, Montreuil-sous-Bois, 2014, p.28 ; on pourrait résumer tout ceci par la formule suivante : « Ton mal, mon bien », slogan de la perversion.
[24] Didier Fassin, La force de l’ordre, opus cité, p.103
[25] Mathieu Rigouste, opus cité, p.258
[26] Hannah Arendt, Eichmann à Jerusalem. Rapport sur la banalité du mal, Gallimard, Paris, 2002, p.499
[27] Ibid., p.258
[28] Idem.
[29] Jacques Derrida, Force de loi, Galilée, Paris, 2005, p.50-51
[30] Ibid., p.57
[31] Didier Fassin, La force de l’ordre, opus cité, p. 243 et 416
[32] Walter Benjamin, Critique de la violence, Payot & Rivages, Paris, 2012, p.74
[33] Ibid., p.75
[34] Giorgio Agamben, Homo sacer, Tome I, Seuil, Paris, 1998
[35] Geoffroy de Lagasnerie, Assa Traoré, « Qu’appelle-t-on ‘‘violence policière’’ », opus cité, p.134
[36] Kaoutar Harchi, « ‘‘Si eux vont sans honte, nous n’irons pas sans révolte’’ », Télérama, 29 juin 2023
[37] Fatima Ouassak, La puissance des mères, La découverte, Paris, 2023, p.18-19
[38] Éric Hobsbawm, Les primitifs de la révolte dans l’Europe moderne, Pluriel, Paris, 2012, p.40
[39] Ibid., p.43
[40] Ibid., p.51
[41] Alain Bihr, « L’extrême droite à la conquête du prolétariat », Le Monde diplomatique, décembre 1995
[42] Abdelmalek Sayad, « Immigration et ‘‘pensée d’État’’ », in La double absence, Seuil, Paris, 2015
[43] Ibid.
[44] Jean-Luc Nancy, L’intrus, Galilée, Paris, 2010, cité in Michel Agier, L’étranger qui vient, Seuil, Paris, 2018
[45] Abdelmalek Sayad, opus cité.
[46] Ibid.
[47] Abdelmalek Sayad, L’immigration ou les paradoxes de l’altérité. La fabrication des identités culturels, tome 3, Éditions Raisons d’agir, Paris, 2014, p.47
[48] Giorgio Agamben, Homo sacer, Tome I, Seuil, Paris, 1998, p.91-93
[49] Définition que proposent Thomas d’Aquin et Robert Nozick, synthétisée par Didier Fassin, in Didier Fassin, Punir. Une passion contemporaine, Seuil, Paris, 20120, p.44-45
[50] Giorgio Agamben, La guerre civile. Pour une théorie politique de la stasis, Seuil, Paris, 2015, p.22
[51] Sade, Français, encore un effort si vous voulez être Républicain, cité in Bernard Edelman, Sade, le désir et le droit, L’Herne, Paris, 2014, p.21-24
[52] Ibid., p.26
[53] Raphael Llorca, « Emeutes urbaines et frustration consommatoire », L’Opinion, 3 juillet 2023
[54] Mehdi Belhaj Kacem, La psychose française, Gallimard, Paris, 2006, p.25-26
[55] Sigmund Freud, Malaise dans la culture, GF Flammarion, Paris, 2019
[56] Ivan Segré, « Où situer ‘‘l’extrême gauche’’ ? », Lundimatin, 11 juillet 2023