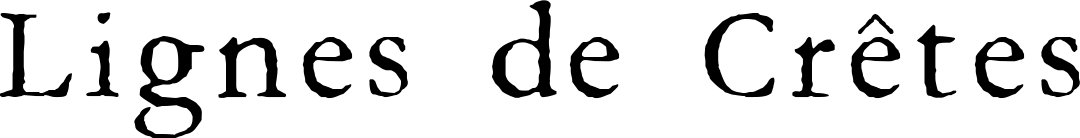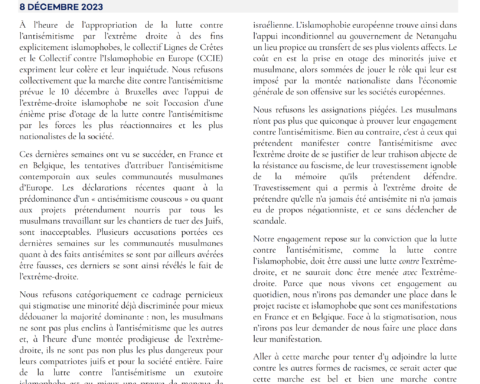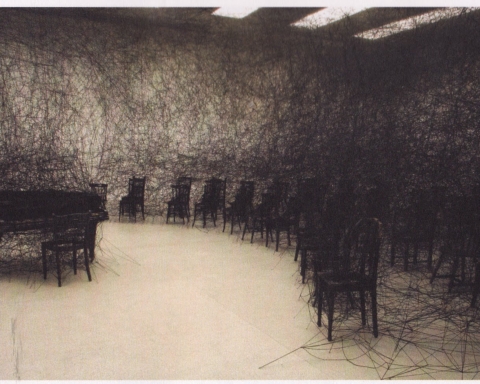Le premier volet de la conversation entre Hamza Esmili et Nadia Meziane, consacré à la révolution syrienne, se trouve ici.
L’immigration, la gauche.
Tu situes ton engagement à l’intersection d’une condition sociohistorique, l’immigration et le collectif qu’elle fonde, et d’un espace, celui de l’extrême-gauche française. Comment la rencontre de l’un et de l’autre s’éprouve pour toi ?
Nadia Meziane :
J’ai grandi dans une gauche en perdition, qu’on appelait banlieue rouge, au début des années 80.La gauche radicale, pour moi, c’est d’abord l’identité de la défaite injuste.
Ma banlieue était calme. En tout cas au sens capitaliste du terme. Dévastée par le chômage, l’alcoolisme, l’héroïne, la laideur architecturale, l’ennui, celui des jeunes et celui des adultes. Mais il n’y avait pas d’émeutes et d’ailleurs même pas de commissariat. Il y avait aussi un grand port industriel en bord de Marne et la mairie communiste bénéficiait de l’impôt sur les sociétés, Du grand rêve révolutionnaire, il restait aux barons locaux du PCF, quelques éléments de social: donc on avait un petit cinéma, deux bibliothèques, des vrais terrains de sport, des colonies de vacances pas chères. Dans les villes de droite ou socialistes à côté, il n’y avait rien. Mais c’était le PCF. Des amoureux de l’ordre qui identifiaient les jeunes issus de l’immigration coloniale au «lumpenproletariat » . Donc, mon premier conflit idéologique avec la gauche radicale, c’est vers mes dix ans, quand les gros bras de la mairie dégagent les « toxicos » comme ils disent, d’abord à coups de barre de fer des halls des HLM et puis ensuite en mettant des interphones. Un souvenir confus, mais extrêmement fort et fondateur, un truc de gosse, je suis du côté de ces jeunes qui sont juste là, sans doute aussi, parce que ma mère, qui pourtant, vote toujours communiste dit son écœurement aussi.
Mais moi aussi, à ce moment là, je ne les appelle pas des arabes et je ne m’appelle pas comme ça non plus. A cette époque, dans ma banlieue en tout cas, il y a un métissage entre prolos, pas du tout celui de SOS Racisme. Je précise ça avec une certaine rancœur que je n’ai pas contre eux forcément sur tout, mais alors leur conte de fées sur les couples métissés qui, chacun, découvrent la culture de l’autre, à travers les soirées au cinéma d’auteur et les voyages, quelle connerie bourgeoise.
En réalité, le métissage de la fin des années 70 et du début des années 80, en banlieue, c’est juste l’endogamie sociale, les jeunes de la deuxième génération et les jeunes blancs qui se rencontrent dans leur jeune vie de prolos, dehors, dans des discothèques merdiques, et entament ensuite une vie de prolos en HLM . Et puis c’est la ” crise” et le parti socialiste qui trahit absolument tout dès 1983, et là pour les couples mixtes, c’est encore plus difficile que pour les autres, parce que les hommes d’origine maghrébine, comme on disait, sont évidemment plus bas dans l’échelle sociale que les blancs. Et dans ce contexte, le métissage, ce n’est pas la fête de la Musique de Jack Lang, c’est l’expérience double de la dureté du capitalisme et de la dureté du racisme .
Alors d’extrême gauche, pour nous qui sommes à la fois issus de parents ouvriers, précaires, employés et en partie issus de l’immigration, ce n’est pas un choix, c’est une évidence, on ne peut pas être de droite. La droite, c’est la police et la répression, c’est grandir avec un père qui doit faire attention à la police. Expérience traumatisante et fondatrice. Les pères blancs n’ont pas à avoir peur de la police à trente cinq ans en allant bosser. Mon père était taxi, et travaillait de nuit, et plusieurs fois, il n’est pas rentré, et rentré ensuite avec des traces de coups, et on te disait brièvement les choses, c’est la police, c’est le racisme.
L’extrême-gauche à l’époque, vue d’une banlieue morne et sans mémoire, ce sont de vieux rêves qui traînent encore. La rébellion contre tout, un peu nihiliste. Je suis l’héritière d’une mémoire traumatique oubliée, on a enterré ceux qui m’ont transmis le sens de la révolte, les grands frères et les grandes sœurs toxico qui traînaient en bas de chez moi. Ces garçons et ces filles qui étaient pour l’ado que j’étais, le symbole de la liberté : ils refusaient le travail salarié, ils refusaient de rentrer sagement le soir, et surtout ils te transmettaient la mémoire de l’extrême-gauche, en passant. L’anarchisme, ils étaient tous plus ou moins anarchistes. Et la majorité étaient issus de l’immigration et cela, il m’a fallu des années pour les voir comme ça. Et me voir comme ça . Il a fallu qu’on les oublie, que tout le monde les réduise soit à des victimes, soit au danger absolu.Qu’on oublie leurs morts prématurées notamment à cause de l’épidémie de SIDA. Et ça, ça fait partie de ma colère contre la gauche, exactement pour les mêmes raisons que j’ai été en colère contre les jeunes musulmans. Comme s’ils avaient trahi la mémoire et prétendaient, que nous, nous l’avions trahie. C’est étrange, ces projections réciproques sur la “trahison” d’ailleurs, de génération en génération, où à l’intérieur d’une même génération, il me semble que nous sommes nombreux à avoir ce trait là dans nos imaginaires politiques: l’autre de la communauté est toujours celui, qui par son récit et ses choix politiques et religieux, montre qu’il a oublié l’histoire de nos ” vraies” origines.
L’épidémie de SIDA a frappé de plein fouet les jeunes issus de l’immigration , bien plus que les autres, comme toutes les épidémies, vas tu me dire. Oui mais, cette épidémie là a donné lieu à des combats, et à la création d’une identité positive, en France, le militant d’Act Up. Blanc. La mort des nôtres a été effacée des mémoires, par un double mouvement. D’une part, la geste héroïque réelle du mouvement homosexuel qui impose l’épidémie comme un sujet de société. Mais à de rares exceptions militantes, personne n’a vraiment évoqué la réalité spécifique de l’épidémie pour les racisés, qui ne pouvaient incarner qu’une figure négative. D’autre part par notre propre silence, parce que pour nous, l’oppression était telle qu’on ne pouvait pas en faire un sujet de combat positif. Le fils usager de drogues, malade, en plein milieu d’une crise économique et raciste, sa mort, c’était quelque chose à oublier, pour survivre et ne pas périr écrasé sous la honte.
Et pourtant, on devrait être fiers d’eux. Mais la honte, c’est quelque chose de consubstantiel à l’histoire de notre immigration, et aussi à l’histoire de ceux d’entre nous qui ont choisi de se battre dans la gauche radicale.
Notamment parce que la gauche radicale est ce lieu où partout existent des récits déjà finis sur les luttes de l’immigration. Et sur nous. C’est un espace social assez particulier à ce niveau là. Au sens où contrairement à d’autres sphères sociologiques, les gens s’y vivent comme l’avant-garde de l’antiracisme. Sauf qu’absolument tous les courants politiques qui s’y croisent et s’y affrontent ont leur représentation figée de l’arabe (ou du noir, mais je ne peux parler qu’en tant qu’arabe ). Et il n’y a que peu de places pour ta diversité, pour ton expérience propre. Chaque chapelle a ses « représentants », ses expériences passées à mettre en avant.
En vingt ans j’ai vu défiler tellement de figures en deux dimensions, tellement de moules avec l’injonction d’y correspondre absolument ou de n’être personne. La beurette façon SOS Racisme, puis la dévalorisation de la beurette par les milieux décoloniaux. J’ai vu la fascination/ répulsion pour le jeune musulman, essentialisé comme le Sujet révolutionnaire ou au contraire comme le danger absolu pour la lutte de classe. J’ai vu la période, toujours en cours, où 90 pour cent des débats antiracistes portaient sur « la fille qui porte le voile », en pour et en contre, est-ce une oppressée ou incarne-t-elle au contraire la résistance au patriarcat blanc ? Ou est elle l’agente du complot ? J’ai vu la nostalgie pour les bons travailleurs immigrés d’antan qui eux, étaient vraiment de gauche et la ramenaient pas avec des questions raciales mal tournées et mettaient la lutte de classe en premier. J’ai vu aussi l’espèce d’engouement malsain pour les figures médiatiques féminines de l’antiracisme, les espèce de fan clubs de camarades horriblement gênants qui passent leur temps à défendre telle ou telle figure en mode chevalier blanc.
Concrètement, la réalité, c’est que nous sommes comme les camarades blancs, c’est à dire que nous sommes tous un peu de tout ça, mais aussi autre chose, et souvent en même temps.
Mais le racisme structurel fait que beaucoup d’entre nous ne se sentent jamais autant assignés à être que dans une famille politique qui devrait, au nom de ses principes, nous aider simplement à exister. L’intersection du collectif socio-historique de l’immigration et de la gauche radicale, en négatif , c’est de perdre les deux sécurités à la fois, celle de l’identité historique, et celle de l’identité politique. Ne plus se sentir personne, pas « vraiment arabe » parce que tu ne corresponds pas aux figures choyées de ta tendance politique, et plus vraiment de gauche radicale, parce que tu as l’impression de ne pas avoir ce choix tout le temps, parce que ton identité historique va de toute façon te mettre en porte à faux avec le racisme structurel de ton camp politique.
Et en supplément, tu as tendance à le vivre seule. Les mécanismes collectifs sont tels que de toute façon, individuellement, tu vas être amené à te conformer à un modèle ou à un autre en grande partie et à regarder avec hostilité celles et ceux qui correspondent à une autre figure. Ces dernières années, j’ai beaucoup réfléchi là dessus, notamment à cause des différentes figures de la « militante issue de l’immigration arabe ». A cause du débat politique qui a pris la forme maintes et maintes fois, d’un affrontement scénarisé, où des blancs se jettent à la tête leur arabe préférée, pour en descendre une autre. Où sur la laïcité, le communautarisme, l’antisémitisme, l’islamophobie, nous étions toutEs ,absolument toutes piégées dans les mêmes mécanismes, angélisées ou diabolisées, harcelées ou instrumentalisées, et à quel point on nous faisait monter sur le ring, comme des championnes de catch féminin, et j’aime bien les championnes de catch féminin, sauf que c’est un métier, du théâtre autant que du sport et pas de la politique. Dans le réel, le racisme structurel nous a toutes amenées à être excessives et enragées, divisées entre nous, en concurrence même pas choisie. Et je ne le dis pas pour me chercher des excuses ou pour en chercher à des femmes que je considère comme des ennemies politiques. Mais le destin commun existe, tout bêtement. Tu finis souvent par le reconnaître le jour où celles que tu n’aimes pas sont lâchées par leurs entraîneurs et entraîneuses, parce que c’est le moment où tu te vois toi-même à terre, finalement, où tu comprends le mieux l’instrumentalisation politique et la réification que tu subis aussi et où tu espères, secrètement, que ce n’est qu’un moment, et que la revanche va être terrible. Parce qu'” on” le vaut bien, et ce “on” ressenti à propos d’ennemies politiques et impossible à mettre en œuvre, et même pas forcément souhaitable est sans doute l’expression de la solidarité antiraciste la plus évidente, et un début d’autonomie politique.
Après on peut voir la bouteille à moitié vide ou à moitié pleine. Nous sommes à la fin d’un cycle politique. La gauche est à terre, de toute façon, la gauche radicale et l’extrême-gauche aussi. Je suis arrivée dans les milieux militants à la fin des années 90, et jusqu’en 2002, il y avait dans ma famille politique, l’extrême-gauche radicale, la croyance qu’on n’allait pas cesser de grandir. L’idée que le fascisme français puisse être un jour dominant culturellement et même politiquement nous semblait totalement absurde. Aujourd’hui, c’est absolument le contraire, les débats dans mon camp sont tous d’un pessimisme absolu , et d’une violence extrême car nous sommes totalement divisés et nous n’avons pas fini de nous attribuer mutuellement la responsabilité de nos défaites.
Mais d’un autre côté, du mouvement des sans-papiers jusqu’à l’antiracisme politique, des expériences de syndicalisme menées par tellement et tellement de précaires issus de l’immigration, dans le nettoyage, dans la restauration, dans l’éducation nationale, dans le bâtiment jusqu’à l’irruption d’une vraie classe moyenne d’intellectuels dont tu fais partie, nous, finalement on n’a pas chômé . Et c’est notamment vrai en ce qui concerne les femmes, il y a une chose qui me semble absolument évidente à ce niveau là. Les paternalistes racistes et islamophobes peuvent nous donner toutes les leçons qu’ils veulent, quelle que soit notre tendance politique, nous sommes numériquement et proportionnellement plus nombreuses à avoir réussi à nous hisser à des positions politiques importantes et pas seulement médiatiques ou sociales que les non issues de l’immigration. Aujourd’hui , la femme issue de l’immigration musulmane est une figure de la gauche, incontournable. Dans toutes les sphères , dans toutes les chapelles. Haïes ou pas, on s’en fiche, parce que même la haine démesurée à notre égard est aussi un signe du pouvoir que nous avons pris.
Et je crois qu’il y a une manière très positive de vivre l’intersection , finalement. Depuis quinze ans, nous avons vécu un drame historique atroce, à mon sens en tout cas. L’incapacité de la gauche et de l’extrême-gauche française à surmonter ses tares racistes a amené une partie de ma génération à chercher sa liberté à droite et chez les fascistes. Égalité et réconciliation, disaient-ils. Je ne vais pas revenir ici sur le naufrage, que j’ai combattu de toutes mes forces , avec une incrédulité et une rage absolue, issue de mon histoire militante antifasciste notamment. Mais finalement, la défaite politique a été collective, de toute façon, nous qui étions restés dans la gauche universaliste l’avons vu se transformer en sphère raciste assumée, pas forcément moins nationaliste que les nationalistes de droite, et de la même manière l’antisémitisme de gauche n’a rien à envier à celui de l’extrême-droite.
Mais il y a un point extrêmement important. Pour choisir pleinement, il faut avoir la liberté de choix. Pendant des décennies, nous étions de gauche naturellement, qui d’autre aurait cherché à nous instrumentaliser ou à nous récupérer ? L’engagement politique était décidé d’avance. Plus jeune j’étais évidemment très anti-communiste, pour les raisons que j’ai évoquées plus haut, la violence extrême de la gestion municipale du PCF dans les banlieues rouges. Mais pour autant, concrètement, il n’y avait ni possibilité de militantisme de droite, encore moins d’extrême-droite et pas non plus de communauté politique musulmane.
Aujourd’hui, nous avons toutEs le choix, être de gauche ou pas du tout. Être de droite, ou être autre chose. Comme les autres. Et par conséquent, les camarades non racisés ne peuvent plus nous dire « C’est nous ou rien ». A vrai dire, nous avons désormais le pouvoir de leur dire « C’est nous, comme nous sommes ou rien ».
Et paradoxalement, dans ce moment où nous sommes confrontés à la fois à l’effondrement de la gauche et à une offensive raciste et islamophobe d’une brutalité sans fards, parfois je me sens plutôt optimiste pour l’avenir. Une partie d’entre nous pourrait bien décider non pas de rejoindre telle ou telle famille de gauche constituée, mais de l’incarner et de la construire tranquillement, en toute autonomie. D’ailleurs, le seul vrai grand mouvement de rue post confinement en France a été la mobilisation antiraciste , une mobilisation extrêmement jeune, et née d’une identification transnationale qui n’avait pas grand chose à voir avec la gauche spécifiquement française et ses débats.
Et puisque nous avons parlé ensemble de ce qui s’est passé récemment sur Lignes de Crêtes, où j’ai fait le choix de publier quelques camarades très différents, où cela a notamment pris la forme inévitable de textes où nous nous attaquions entre nous, je pense qu’aujourd’hui, pour moi, l’intersection définie dans ta question trouve cette minuscule réponse là. A propos de tel ou tel texte, beaucoup de camarades m’ont dit ” Jamais tu n’aurais accepté de publier ceci ou cela s’il n’était pas arabe et musulman”. Et c’est l’exacte réalité. Mais la gauche est cet endroit qui avait promis de nous accueillir tous et de nous protéger du racisme, non ? Puisque la gauche, c’est aussi nous, c’est ce que nous allons faire, front antiraciste et plus si affinités, dans les rares interstices où nous avons un peu de pouvoir. Les promesses n’engagent que ceux qui les réalisent, nous n’avons plus besoin d’être “accueillis”,seulement d’être ensemble, nous sommes chez nous.
Tu situes ton engagement à l’intersection d’une condition sociohistorique, l’immigration et le collectif qu’elle fonde, et d’un espace, celui de l’extrême-gauche française. Comment la rencontre de l’un et de l’autre s’éprouve pour toi ?
Hamza Esmili:
Mon immigration n’a pas l’intensité de la tienne et de l’histoire dont tu hérites. Je me sens pourtant pleinement engagé par ton récit, pas simplement parce que nous sommes l’un et l’autre « arabes » – selon un terme qui parait, comme tu dis, n’être que le creux des précarités existentielles –, mais également parce que la rencontre a bel et bien eu lieu : entre toi et moi, certes, mais surtout entre une variété d’histoires collectives connexes. C’est ce que j’entends quand tu dis cette « manière très positive de vivre l’intersection » : si le moment historique que nous vivons est bien né d’une gauche en durable perdition et d’une trame contemporaine résolument nationaliste, celui-ci est pourtant pourvoyeur d’un considérable renouvellement de nos horizons politiques. Il ne s’agit même pas d’un souhait, mais du constat placide de ce qui s’impose avec la force de l’évidence.
Je n’appartiens pas à l’immigration, j’ai immigré, c’est-à-dire que je suis venu seul, à destination des « études » en vertu desquelles on quitte tout comme pour un geste initiatique et de la préfecture qui délivre ma carte de séjour tous les six mois ou tous les ans selon les gages que je donne au moment où j’en fais la demande – mon record étant de trois ans pour le moment. Cela parait terriblement banal : des étudiants étrangers arrivent et repartent, qui pense à les appeler des « immigrés » ? Je me souviens du descendant d’une imposante figure intellectuelle du XIXe siècle – auteur d’un célèbre récit de voyage en Amérique – qui m’avait énoncé l’air de rien une impressionnante vérité sociologique : « d’habitude, je n’aime pas les Arabes, mais toi ça va ». Le constat était juste, par-delà sa formulation : ma trajectoire n’était pas celle de ce que l’on nomme « l’immigration », et même quelqu’un qui pourtant « n’aime pas les Arabes » le ressentait avec surprise. Ainsi peut-on avoir immigré sans être immigré.
Je suis issu d’une famille marocaine d’universitaires de gauche. Mes parents appartiennent l’un et l’autre – quoiqu’assez différemment – à la génération qui a cru à l’indépendance nationale1 comme promesse d’émancipation ainsi qu’à sa fine articulation à l’idéal socialiste et communiste. Après leurs études en France, tous deux ont choisi de rentrer « construire » et ainsi de prendre part à l’effervescence universitaire et politique de l’époque au Maroc. Leur rapport à la France est tout à la fois teinté d’une méfiance réelle à l’égard de l’ancien colonisateur et d’une admiration également non feinte, en particulier vis-à-vis de la production intellectuelle et artistique d’alors. Je me rappelle ainsi d’un proche ami de mes parents qui, universitaire et résident en France, m’avait confié régulièrement aller au Café de Flore à la recherche des traces de Jean-Paul Sartre et de Simone de Beauvoir. Tout cela semble un peu hors du temps et il est vrai que l’une des caractéristiques de l’immigré, notamment lorsqu’il est réputé intellectuel, est d’être toujours en retard de son temps. Plus tard, encore étudiant, j’ai souvent ressenti – comme bien d’autres partageant cette condition – ce décalage avec mes condisciples : pour les étrangers, le détachement ordinaire – voire l’anti-intellectualisme – des héritiers français de la culture n’est guère possible.
Le plus étrange est que le durcissement des politiques migratoires françaises et la précarisation subséquente de ceux et celles – certes de plus en plus rares – qui venaient malgré tout n’ont que peu entamé l’éclat de la France vue depuis le Maroc et sa frange de gauche. On fustige « l’impérialisme », la Françafrique ou le soutien aux dictatures de nos pays mais cette forme très particulière d’immigration intellectuelle et militante a ainsi continué, longtemps après l’indépendance, de faire reposer sa quête d’émancipation sur une forme de « rattrapage » de ce qui aurait été atteint ailleurs – la modernité, la démocratie voire, de manière parfois explicite, la « civilisation ». Je me souviens ainsi d’une amie militante de gauche qui avait décidé d’émigrer en France tardivement dans sa vie pour, disait-elle, y reprendre des études – évidemment, son immigration allait au-delà de cela, elle troquait une vie pour une autre. Mon amie s’était très vite heurtée, à peine quelques mois plus tard, à la réalité préfectorale de la France. Mais elle n’avait pas pu admettre son vécu au sein même de ce qui était l’inexpugnable horizon de tous ses espoirs (la France, la démocratie, les droits humains etc.) et avait donc attribué à un complot ourdi par le Makhzen – l’État marocain, que la gauche distingue ainsi par son nom même de la vérité générale de tout État – la violence des refus de carte de séjour et des OQTF qu’on lui adressait. La France était ainsi moralement préservée, par-delà sa compromission avec le Makhzen.
Mon immigration est ainsi bien moins réflexive que la tienne. Il me semble que cela tient au fait qu’elle n’a rien de collectif. Les étudiants, les militants « exilés » (pour le Maroc, il s’agit le plus souvent d’un auto-exil, pas moins douloureux cependant) ou les ouvriers qui ne se sont pas établis en ménage dans la société d’accueil, tous ceux-là constituent une sorte de reliquat de l’immigration – selon l’usage commun que l’on fait de ce terme, c’est-à-dire d’un collectif dont le nom est précisément « l’immigration ». Cette sorte de reste du collectif a pour condition une solitude durable, même parmi les groupes de pairs – qui ne sont jamais que la somme d’individus aussi épars que précaires. Tout cela n’a jamais été si visible qu’au temps de la pandémie : par-delà des conditions absolument inégales, le fil rouge de l’anomie relie les vieux ouvriers à la retraite demeurés en foyers de travailleurs (je pense par exemple à celui de Gennevilliers où le COVID-19 a été particulièrement meurtrier) aux mineurs isolés de Barbès et passant par les étudiants coupés de leurs familles.
Ces deux histoires, celle de l’immigration comme collectif et celle des immigrés demeurés seuls aussi longtemps résidaient-ils pourtant dans la société d’accueil2, sont certes voisines mais leurs devenirs radicalement différents fondent une durable incompréhension. Je me souviens ainsi de très nombreux hiatus et fautes commises (le plus souvent de mon côté) à l’égard de ceux et celles qui étaient des sortes de doubles. Je me rappelle par exemple d’une étudiante française d’origine algérienne qui suivait les mêmes classes préparatoires que moi et d’autres de mon profil sociologique. Elle vivait de front toute la violence sociale d’une ascension par les études (tout le monde dans la prépa savait qu’elle était issue d’un programme « de la diversité ») et pensait trouver en nous (les « Marocains ») des alliés naturels. Nous ne lui avons offert que l’exacte même violence bourgeoise.
Il me semble pourtant qu’une terre commune est malgré tout envisageable. Si tout est évidemment inscrit dans des parcours de vie qui ne peuvent être réduits à une « prise de conscience », il m’apparait que, rétrospectivement, ce qui a fondé mon intérêt pour l’expérience historique de l’immigration en cité est la désillusion de plus en plus marquée à l’égard du discours – du programme – de la gauche marocaine. À mesure que je j’éprouvais la trahison de la promesse de modernité, les avanies ordinaires du « ici, on est pas au bled ! » et la violence de la précarité organisée, c’est-à-dire tout ce qui ne correspondait que peu au récit de l’émancipation-rattrapage, mon intérêt à l’égard de ceux et celles qui étaient venus avant moi s’affirmait. D’autres ont opéré cette sorte de rattachement par d’autres canaux, via un – rare – type de militantisme assumant le déclassement ou par le rapport à la religion.
Pour moi, ce n’était cependant pas encore la prise en compte d’une réalité dans la singularité de ses coordonnées historiques. Un peu schématiquement, il s’agissait d’aborder le fait de l’immigration en cité comme l’envers de la promesse moderne. L’expérience s’est alors doublée d’une étude : jeune sociologue, je voulais, à l’instar des vieux mao établis en usine, aller toucher du doigt les frontières – matérielles et symboliques – de la société française. Je me suis installé à Clichy-sous-Bois, parce qu’il s’agit – avec Grigny – de la ville la plus pauvre d’Ile-de-France et que les révoltes de 2005 y ont commencé. Cependant, si la pauvreté et le racisme – notamment mais non exclusivement policier3 – étaient de fait une réalité aussi permanente qu’évidente, il m’est cependant apparu au fil des mois et des années que le cœur de ce que j’observais était tout autre chose – et moins facile à percevoir depuis l’extérieur, même avec les meilleurs intentions politiques.
Une expérience positive avait la cité comme cadre d’existence : celle de la constitution du collectif – il faudrait dire, pour être plus précis, du sous-collectif – des immigrés et de leurs enfants. S’il est pourtant vrai que la cité est le lieu d’une marginalité protéiforme (rappelons ainsi la vieille étymologie de banlieue, le lieu du ban), une telle caractérisation n’épuise absolument pas la vie collective qui s’y déploie. Les immigrés et leurs enfants sont ainsi désormais liés les uns aux autres par un ordre moral qui leur est entièrement immanent – c’est-à-dire qu’ils et elles ont établi. D’autres sociologues ont appelé cela une quête de respectabilité, comme si l’on ne se voyait jamais qu’à travers les yeux des autres. Il me semble pourtant que la réaffiliation à l’œuvre est moins réactive et identitaire que fondée par l’expérience intime des solidarités déjà-là en cité et de la reconstitution des liens intergénérationnels mis à mal par la précarité inhérente à l’immigration postcoloniale et qu’aggrave tant l’effritement du monde ouvrier et le chômage généralisé. À l’évidence, une importante partie de cette refondation collective s’atteste dans le réinvestissement contemporain de la tradition islamique : s’il n’est pas exclusif et demeure en dialogue permanent – tout fan de rap s’en convaincra aisément – avec les autres formes de réaffiliation qui existent dans la cité, un sentier aussi intime – c’est-à-dire constitué par une forme de travail sur soi – que collectif était cependant tracé. À Clichy-sous-Bois, cela n’était jamais aussi évident que dans le récit des soirs d’octobre et novembre 2005 que faisaient les anciens – les ouvriers qui ont construit la mosquée – et tous ceux et celles qui se sont évertués à « faire rentrer les jeunes ». Contrairement à ce que l’on dit si facilement, y compris dans le champ militant, il ne s’agissait pas de « raser les murs » mais, très bêtement, de l’impossibilité absolue pour le collectif de voir de la chair à canon dans ses enfants – comme c’est bien souvent la relation qu’entretient cyniquement l’extrême-gauche avec les enfants d’immigrés.
Faut-il le dire ? La refondation collective parmi les immigrés et leurs enfants n’a cependant rien à voir avec le « séparatisme » que l’on se plait à débusquer – très paradoxalement – dans chacune des sphères de la vie sociale. À Clichy-sous-Bois comme ailleurs, l’État est agissant par une multitude de voies (si l’on pense spontanément à la police, comment ne pas voir également l’hyper-présence de l’école, de la CAF, de la préfecture et de l’ensemble des institutions qui régulent et contrôlent la vie sociale ?). Similairement, puisqu’il n’est pas séparé, le collectif est traversé d’une multitude de mobilités, parfois ascendantes via les études, le plus souvent horizontales – c’est-à-dire d’une position sociale à une autre relativement équivalente dans la stratification propre au monde du travail. Tout cela est d’une banalité affligeante mais le contexte oblige à le dire : les gens travaillent, envoient leurs enfants à l’école et espèrent qu’ils et elles y « réussissent ».
Pour autant, les uns et les autres se réfèrent bien à l’existence d’une communauté. Il me semble que le fait est de première importance : moins qu’une réalité stable et figée, il s’agit de la marque d’un collectif qui se pense et pense son rapport au reste de la société. Une telle réflexivité – c’est-à-dire la lucidité sur soi – est, me semble-t-il, remarquable : elle est la conscience historique du déplacement qui a été réalisé. Un « nous » s’est fondé, paradoxal, tout à la fois lié à une expérience historique – la cité, l’immigration, l’usine, la pauvreté, le racisme – et à son investissement positif – c’est-à-dire actif – par les immigrés et leurs enfants. Au plus grand malheur de certains sociologues « critiques », la condition marginale n’agit pas qu’en creux d’un manque que des sachants bien-intentionnés auraient la charge de localiser.
J’ai suivi avec beaucoup d’intérêt les débats que tu as accueillis – et auxquels tu as pris part – sur Lignes de Crêtes. Il me semble que cette réflexivité collective doit nous – selon un nous dont la règle est d’être toujours en cours de réalisation – inciter à un rare optimisme dans la séquence de réaffirmation nationaliste que l’on traverse. Nous pensons, et notre pensée est peut-être le seul lieu où émerge la possibilité de la politique. Cela devrait aussi nous inciter à de la mesure dans les jugements que nous proférons les uns à l’égard des autres : l’exercice de la pensée qui prend forme dans de tels débats est le produit historique inespéré des solidarités qui se sont constituées dans la cité. Tu parles à raison de « l’irruption d’une vraie classe moyenne d’intellectuels » parmi nous : chacun et chacune doit être conscient qu’il et elle n’est que l’explicitation – certes nécessaire – des options intellectuelles et politiques qui existent de facto dans le collectif. Gardons-nous de l’esprit d’avant-garde, qui n’aboutit inévitablement qu’à l’aigreur militante ou pire, au dandysme d’une radicalité esthétique. Si tous les débats qui existent entre nous doivent être pris au plus haut sérieux – ils indiquent la variété des devenirs possibles –, la réalité du collectif qui pense et se pense doit primer dans l’appréciation que nous avons de nos divergences.
Il me semble que l’attachement à l’expérience historique qui est la nôtre nous autonomise aussi considérablement à l’égard de tous les prétendus sauveurs – ce que l’on a pu appelé dans certains cercles militants « le glacis blanc ». Comme tu le dis très justement, « pour choisir pleinement, il faut avoir la liberté de choix », et c’est vrai tant s’agissant de la gauche nous comptant nécessairement comme siens que du discours sociologique incapable de faire place au fait de la pensée des gens. À l’évidence, une telle perspective est de plus en plus pénible à maintenir : l’intégration a déjà eu lieu et n’est pas à venir. En plus de la cité, des musulmans, des arabes, des enfants d’immigrés existent dans l’ensemble des arcanes de la société. L’un des points de focalisation les plus frappants de l’offensive islamophobe actuelle est d’ailleurs la thématique de l’entrisme : comme souvent, l’islamophobie n’est ici que la traduction complotiste d’une réalité sociologique. À l’université, à la RATP, à l’hôpital ou dans les clubs de sport, nous existons.
Mais la réflexivité est également synonyme de responsabilité. Il me semble qu’il s’agit alors de refuser toute ligne de fuite – par opposition à une ligne de crête ? –, c’est-à-dire toute tentation d’une politique qui s’abstrait de la réalité du collectif tel qu’il est déjà. Ce n’est pas en proclamant ce que l’on est ou non – un geste qui condamne au retard et qui court donc le risque grave de la fétichisation – que l’on fera advenir une politique alternative mais, à l’inverse, en ayant pour premier horizon la préservation du collectif et de ses solidarités réelles – tant contre l’offensive libérale que néo-nationaliste, l’une étant évidemment liée à l’autre. Il me semble que c’est en ce point que l’on retrouve la promesse d’émancipation dans cette modernité tardive qui est la nôtre : pour paraphraser un philosophe dont l’œuvre est cruciale pour penser la politique moderne, l’émancipation n’est pas la fin de tout héritage, c’est hériter autrement4. Au bout de ce qui n’est pas le récit de l’inexorable l’assimilation – a-t-il jamais été opérant pour quiconque ? –, l’émancipation est d’abord et avant tout la conscience de ce qui manque toujours – c’est-à-dire des modalités par lesquelles il s’agit de participer au contemporain depuis l’expérience pratique du collectif et des idéaux de justice et de solidarité qui y ont cours.
Le socialisme auquel je crois est ainsi celui de la somme des expériences historiques qui font société – à l’inverse de l’irénique récit du face-à-face entre l’État et l’individu abstrait de la pensée juridico-libérale ou nationaliste. Ce n’est pourtant pas la quête d’une reconnaissance sans cesse ajournée ni l’éloge du multiculturalisme, mais simplement le postulat que dans la société où existent des trajectoires historiques si diverses, tout doit être soumis au libre examen depuis la position déterminée des uns et des autres. Il me semble que l’universalisme ne peut être que cela : un travail nécessairement en cours que l’on réalise chacun de son côté ou ensemble, depuis la réalité des collectifs tels qu’ils sont. Par un paradoxe qui n’est qu’apparent, je crois que ce n’est que parmi nous – les immigrés et leurs enfants – qu’un tel renouvellement de la politique moderne est possible.
1 Emblématiquement, la langue arabe ne distingue pas le national du nationaliste : l’un et l’autre sont watani. Une telle superposition est bien plus qu’étymologique : si elle n’est pas moins nécessaire qu’ailleurs, la critique du nationalisme est ainsi bien plus ardue dans un pays né de la décolonisation.
2 Les foyers de travailleurs immigrés sont à cet égard particulièrement parlant. Il y demeure jusqu’à aujourd’hui les ouvriers à la retraite qui n’ont pas opéré de regroupement familial ou ne se sont pas établis en ménage en France. Ceux-ci sont ainsi restés tragiquement étrangers – y compris administrativement – tant à la société dans laquelle ils ont pourtant passé l’essentiel de leur vie qu’à celle qu’ils ont quitté. C’est ce que le sociologue Abdelmalek Sayad nomme la double absence.
3 À ceux qui l’auraient oublié, c’est à Clichy-sous-Bois que les adolescents Zyed et Bouna avaient préféré se réfugier dans un transformateur électrique plutôt que de tomber entre les mains de la Brigade anticriminalité qui les poursuivaient sans aucun motif explicite. Comme le dit le slogan militant, « Théo et Adama nous rappellent pourquoi Zyed et Bouna courraient ».
4 KARSENTI, B. 2017. La question juive des Modernes. Philosophie de l’émancipation, Paris : Presses universitaire de France. Voir également KARSENTI, B. LEMIEUX, C. 2017. Socialisme et sociologie, Paris : Éditions de l’EHESS