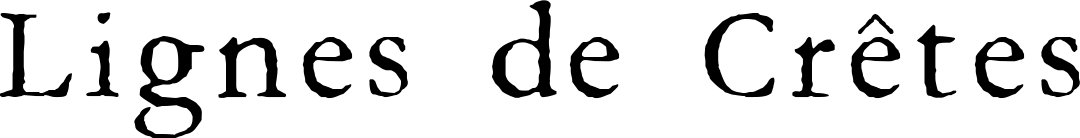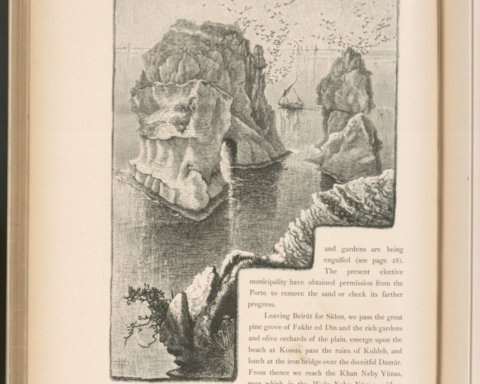L’une des caractéristiques du pouvoir actuel est d’utiliser à tout propos les mots du libéralisme politique pour en travestir le sens, tout en détruisant les fondements de la démocratie libérale, notamment les droits civils, pour réprimer toute contestation de sa politique économique néolibérale. Nous reproduisons ici, avec son autorisation, le texte d’Alain Policar, initialement paru le 25 décembre dans Libération, texte qui remet à sa juste place le concept d’universalité qu’osent utiliser les imposteurs du macronisme.
On parlera désormais, pour évoquer l’usage des mots par l’actuel pouvoir, de la «langue de la macronie». Langue dévoyée qui mobilise de grands principes pour en détourner le sens.
L’universalité est ainsi confondue avec l’uniformité. Il faudrait, au nom de la justice sociale, appliquer un système unique, dit universel, à des situations diverses. L’idée sous-jacente est d’imposer, par l’usage d’un terme consensuel, la conviction de la nécessité de la réforme : ce qui est universel serait nécessaire. Nommer les choses (en l’espèce, mal nommer), c’est performativement chercher à imposer une réalité. De quelle nécessité est-il ici question ? Celle de la compétitivité de l’économie française en contexte néolibéral. Dans cette perspective, il faut en finir avec l’Etat-providence et, pour y parvenir, intervenir massivement : ne plus se contenter de laisser faire mais dessiner un autre avenir dans lequel, comme l’écrit suggestivement Barbara Stiegler sur AOC, la retraite serait devenue un archaïsme, et où l’objectif serait de travailler jusqu’à la mort.
Or, alors que l’on nous vante la valeur de l’égalité, on refuse de considérer l’explosion des inégalités, la première d’entre elles étant précisément celle de l’espérance de vie. Si l’on souhaitait vraiment bâtir un système égalitaire, il devrait se fonder sur la durée de la retraite. Et, dès lors, l’équité, dont on se gargarise, recommanderait des âges différenciés de fin de la vie active selon les classes sociales. Si cette exigence élémentaire n’est pas invoquée, c’est largement parce que l’on cherche à nous convaincre que nous sommes rétribués en fonction de notre mérite (voir la métaphore des «premiers de cordée»).
Mais peut-on, à la fois, invoquer la justice sociale et glorifier le mérite ? Il suffit de se pencher sur les travaux de John Rawls ou de Ronald Dworkin, pour savoir que l’appréciation du mérite est liée à l’utilité sociale accordée à un ensemble de performances dont la réalisation dépend d’atouts (en particulier, un milieu familial favorable) distribués de façon moralement arbitraire (voir notamment Rawls, Théorie de la justice, traduction française 1987, page 134). La justice sociale exige, au contraire, que ce qui dépend des circonstances et non des choix soit compensé. En conséquence, l’équité impose de substituer à la conception uniformisante de l’universel la considération du particulier et de sa richesse. C’est cette richesse que l’existence de régimes dits spéciaux reconnaît et à laquelle le gouvernement est aveugle.
On pourrait m’objecter que je ne tiens pas compte des promesses de revalorisation de certaines professions dont on admet qu’elles auraient tout à perdre à l’instauration du système par points. Mais comment imaginer que les mesures nécessaires pour rétribuer correctement les enseignants puissent être prises alors que prévaut une logique fondamentalement financière ? Si cela est désormais jugé souhaitable, pourquoi a-t-il fallu attendre l’actuel projet pour y songer ?
La question n’est pas seulement rhétorique. Elle est révélatrice d’un profond mépris social. Les citoyens sont implicitement considérés comme incapables de percevoir le sens de leurs intérêts. Il convient donc de les guider : approche paternaliste en totale rupture avec le principe d’autonomie individuelle, fondement de la démocratie libérale. Il faut s’attendre à ce que l’on cherche des moyens pour détourner la légitime colère des salariés : la question de l’immigration devrait donc ressurgir violemment dans le «débat» politique.
Il n’est sans doute pas insignifiant que l’inhospitalité à l’égard de l’étranger, au nom de la sauvegarde de l’identité nationale, entretienne des affinités électives avec l’indifférence, à l’aune de la «nécessaire» compétitivité, vis-à-vis des perdants de la globalisation, impuissants à améliorer leur sort, et désormais réduits à l’inutilité. De cette réalité, entièrement occupé à son entreprise de falsification du sens des mots, le pouvoir politique n’a cure. Il n’est pas totalement exclu qu’il ait à le regretter.